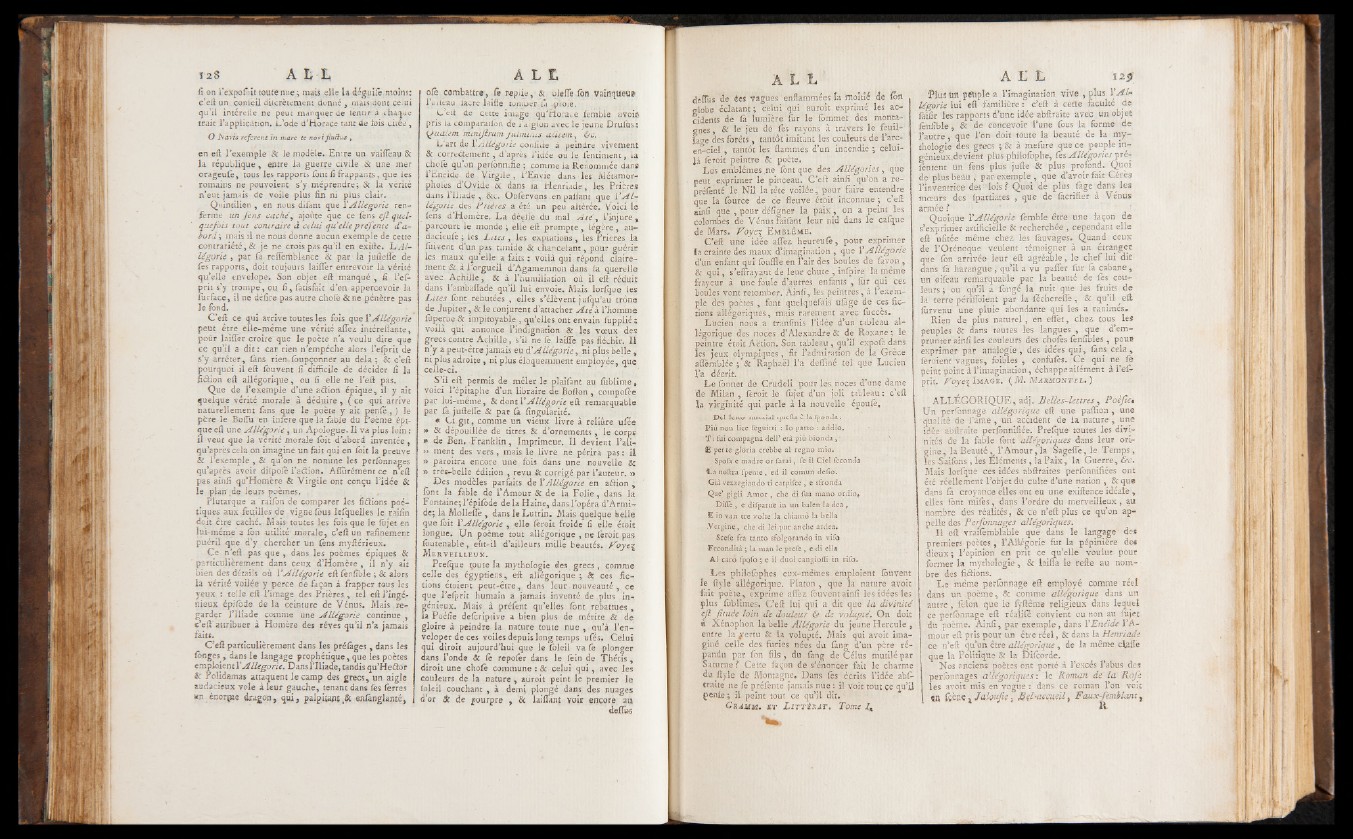
iss A L L
fi on l’expofèit toute nue ; mais elle la déguile.moins:
c’eft un. conieil dilcrètement donné , mais-,dont ce-ui
qu’il intérelle ne peut manquer de tèncir à chaque
traie l'application. L ’ode d’Horace tant de lois citée
O & avis refirent in mare te novi fluctus ,
en eft l ’exemple & le modèle. Entre un vaiflèau &
la république, entre la guerre civile & une mer
orageufè, tous les rapport* font fi frappants , que les
romains ne pouvoient s’y méprendre; & la vérité
n’eut jamais de voile plus fin ni plus clair.
Quintilien , en nous difant que Y Allégorie renferme
un fens caché, ajoute que ce fens eft quelquefois
tout contraire à celui qu'elle préfente d'abord
; mais il ne nous donne aucun exemple de cette
contrariété, & je ne crois pas qu’il en exifie. L,Allégorie
y par (à reflèrfiblance & par la jufteiîe de
lès rapports, doit toujours laifler entrevoir la vérité
qu’elle envelope. Son objet eft manqué , fi l’efè
prit s’y trompe, ou fi, (àtisfait d’en appercevoir la
fiirface, il ne délire pas autre choie &ne pénètre pas
le fond.
C ’eft ce qui arrive toutes les fois que l ’Allégorie
peut être elle-même une vérité aflez intéreffante,
pour laiflèr croire que le poète n’a voulu dire que
ce qu’il a dit : car rien n’empêche alors l’elprit de
s’y arrêter, (ans rien.lôupçonner au delà; & c’eft
pourquoi il eft louvent fi difficile de décider fi la
fi&ion eft allégorique, ou fi elle ne l’eft pas.
Que de l’exemple d’une action épique, il y ait
quelque vérité morale à déduire , ( ce qui arrive ;
naturellement (ans que le poète y ait penfé, ) le ;
père le Boflu en inféré que la fable du Poème épi- !
que eft une Allégorie, un Apologue. Il va plus loin :
il veut que la vérité morale (bit d’abord inventée,
qu’après cela on imagine un fait qui en fôit la preuve
& l’exemple, & qu’on ne nomme les perfènnages
qu’après avoir dilpofé l’adion. Aflurément ce n’eft
pas ainfî qu’Homère & Virgile ont conçu l ’idée &
le plande leurs poèmes.
Plutarque a raifèn de comparer les fidions poétiques
aux feuilles de vigne fous lefquelles le raifîn
doit être caché. Mais toutes les fois que le fijjet en
lui-mêipe a (bn -utilité morale, c’eft un rafinement
puéril que d’y chercher un fèns myftérieux.
Ce n’eft pas que , dans les poèmes épiques &
particulièrement dans ceux d’Homère , il n’y ait
bien des détails où Y Allégorie eft fènfîbie ; & alors
la vérité voilée y perce de façon à frapper tous les
yeux : telle eft l’image des Prières, tel eft l ’ingénieux
épifède de la ceinture de Vénus. Mais regarder
l’Iliade comme une Allégorie continue ,
c’eft' attribuer à Homère des rêves qu’il n’a jamais
faits.
C ’eft particulièrement dans les préfàges , dans les
longes , dans le langage prophétique, que les poètes
emploient Y Allégorie. Dans l ’Iliade, tandis qu’Hedor
& Polidamas attaquent le camp des grecs, un aigle
audacieux vole à leur gauche, tenant dans fès (erres
un énorme dragon, qui, palpitant,JSt enlânglanté,
A L L
ofè combattre, fè repue, & blefie (cm vainqueur
i’u/Ieau (acre laifie tourner-fit proie.
L ’eit de cette image qu’Hara<-e femble avoia
pris la comparaifen de fa.gton avec le jeune Drulus s
ualem nunijlrum fitlmims alitent, <5v.
L'art de Y Allégorie confide à peindre vivement
& correctement , d’après l’idée ou le (enriment, la
chofè qu’on perfènntfie ; comme la Renommée dans
l’Eneide de Virgile , l’Envie dans les Métainor-
pholes d’Ovide tx. dans la Henriade, les Prières
dans l’iljade , &c. Obfèrvons .en paffant que Y A l légorie
des f r ie res a été un peu altérée. Voici le
fens d’Homère. La décile du mal A té y l’injure ,
parcourt le monde ; elie eft prompte , légère, audacieuse;
les L t i e s y les expiations , les Prières la
drivent d’un pas timide & chancelant, pour guérir
les maux qu’elle a faits : voilà qui répond clairement
& à l’orgueil d’Agamemnon dans (a querelle
avec Achille, & à l’humiliation où il eft réduit
dans l’ambafïade qu’il lui envoie. Mais lorfijue les
Lites (ont rebutées , elles s’élèvent j ulqu’au trône
de Jupiter, &le conjurent d’attacher A té à l’homme
(uperbe & impitoyable , qu’elles ont enyain (ùpplié s
voilà qui annonce l ’indignation & les voeux des
grecs contre Achille, s’il ne fe laide pas fléchir. Il
n’y a peut-être jamais eu ét Allégorie, ni plus belle ,
ni plus adroite, ni plus éloquemment employée, que
celle-ci. •
S’il eft permis de mêler le plaifènt au (ùblime #
voici l ’épitaphe d’un, libraire de Bofton , compofée
par lui-même, & dont Y Allégorie eft remarquable
par (à juftefie & par (à Angularité.
« Ç i.git, comme un vieux livre à reliure ufée
» & dépouillée de titres & d’ornements, le corps
» de Ben. Franklin, Imprimeur. Il devient l’ali-
» ment des vers , mais le livre ne périra pas : il
» paroitra encore une fois dans une nouvelle &
» très-belle édition , revu & corrigé par l’auteur. »
Des modèles parfaits de Y Allégorie en a&ion ,
fènt la fable de l’Amour & de la Folie, dans la
Fontaine;l’épifôde delà Haine, dans l ’opéra d’A rmi-
de; la Molleflè, dans le Lutrin. Mais quelque belle
que (oit Y Allégorie , elle fèroit froide fi elle étoit
longue. Un poème tout allégorique , ne (croit pas
fèutenable, eût-il d’ailleurs mille beautés. Voyc\
M e r v e il l e u x .
Prefque toute la mythologie des grecs , comme
celle des égyptiens, eft allégorique ; & ces fictions
étoient peut-être, dans leur nouveauté , ce
que l ’elprit humain a jamais inventé de plus ingénieux.
Mais à préfènt qu’elles (ont rebattues ,
la Poéfie delcriptive a bien plus de mérite & de
gloire à peindre la nature toute nue , qu’à l ’en-
yeloper de ces voiles depuis long temps ufés, Celui
qui diroit aujourd’hui que le (bleil va fe plonger
dans l’onde & Ce repofer dans le (èin de Thétis ,
diroit une chofè commune : & celui q u i, avec les
couleurs de la nature , adroit peint le premier le
(bleil couchant , à demi plongé dans des nuages
d’or 8c de pourpre , & laiflan£ voir encore au,
deflùs
À L L
deftiis de ées vagues enflammées la moitié de (oîi
globe éclatant ; celui qui auroit exprimé les accidents
de fa lumière fur le (bmmet des montagnes,
& le jeu dé fès rayons à travers le feiiil-'
fage des forêts , tantôt imitant les couleurs de l’arc-
en-ciel , tantôt les flammes d’un incendie ; celui-
là fèroit peintre & poète.
Les emblèmes.ne fènt que des Allégories y que
peut exprimer le pinceau. C ’eft ainfî qu’on a re-
préfènté le Nil la tête voilée, pour faire entendre
que la fèurce de ce ! fleuve étoit inconnue ; c’eft
ainfî que , pour défïgher la paix, on a peint les
colombes de Vénus faifènt leur nid dans le calque
de Mars. Voye\ E mblème.
C’eft une idée aflez. heureufè, pour exprimer
la crainte des maux d’imagination , que Y Allégorie
d’un enfant qui (buffle en l’air des boules de (àvon ,
& qui, s’effrayant de leur chute , in (pire la même
frayeur à une foule d’autres enfants , fiir qui ces
boules vont retomber. Ainfi, les peintres , à l ’exemple
des poètes , font quelquefois ufège de ces fictions
allégoriques, mais rarement avec (ùccès.
Lucien nous a tranfmis l’idée d’un tableau allégorique
des noces d’Alexandre & de Roxane ; le
peintre étoit Aetion. Son tableau , qu’il expo (à dans
les jeux olympiques, fit l’admiration de la Grèce
aflemblée ; & Raphaël l ’a defliné tel que Lucien
l’a décrit.
Le fènnet de Crudeli pour lessnoces d’une dame
de Milan , fèroit le fùjet d’un joli tableau; c’eft
la virginité qui parle à la nouvelle époufè,
Del letto nuzzial quefta è la fponda:
Più non lice feguirti : Io parto : addio.
T i fui compagna dell’ età più bionda , ■
33 per te gloria crebbe al regno mio.
Spofa e madré or farai, fe il Ciel féconda
La noftra fpeme , ed il comun defio.
Già vezzègiando ti carpifce , e sfronda
Que’ gigli Amor , che di fua mano ordio;
Diflè , e difparue in un balen la dea ,
E in van tre,voice la chiamô la bella
.Vergine, che di lei -pur anche ardea.
Scefe fra canco sfolgorando in vifo
Fccondità ; la man le prefc, e di ella
Al carô fpqfo ; e il duol cangiolfi in rifo.
Les philofèphes eux-mciiies emploient fèuvent
le ftyle allégorique. Platon , que la nature avoit
fait poète, exprime aflez fèuvent ainfî les idées les
plus (iiblimes. C’eft lui qui a dit que la divinité
eft fituèe loin de douleur & de volupté. On doit
e Xénophon la belle Allégorie du jeune Hercule ,
entre la ^yertu & la volupté. Mais qui avoit imaginé
celle des furies nées du (àng d’un père répandu
par fèn fils , du (àng de Gélus mutilé par
Saturne ? Celte façon de s’énoncer fait le charme
du ftyle de Montagne. Dans fès écrits l’idée abstraite
ne fè préfènte jamais nue : il voit tout ce qu’il
pen(e ; il peint tout ce qu’il dit,
Gramm. e t L iT T iR A T . Tome 4
A E L '12 9
'Plus un peuple a l’imagination vive , plus Y Ab*
légorie lui eft familière : c’eft à cette faculté de
(àifir les rapports d’une idée abftraite avec un objet
fènfîble, & de concevoir l’une (bus la forme de
l’autte, que Ion doit toute la beauté de la mythologie
des grecs ; & à mefiire que ce peuple in-
génieux.devient plus philofophe, Ces Allégories présentent
un fens plus jufte & plus profond. Quoi
de plus beau , par exemple , que d’avoir fait Cérès
l’inventrice des lois ? Quoi de plus (âge dans^ les
moeurs des (partiates , :que de (àcrifier à Vénus
armée ? '
Quoique Y Allégorie fèmble être une façon de
s’exprimer artificielle & recherchée , cependant elle
eft ufitée même chez les (àuvages. Quand ceux
de l ’Orénôque veulent témoigner à un étranger
que (bn atrivée leur eft agréable, le chef lui dit
dans (à harangue ; qu’il a vu paflèr fur (à cabane,
un bifeau remarquable par la beauté de fès couleurs;
ou qu’il a Congé la nuit que les fruits de
la terre périflbiént par la (echerefïè, & qu’il eft
fiirvenu une pluie abondante qui les a ranimés.
Rien de plus naturel, en effet, chez tous les
peuples & dans toutes les langues , que d’emprunter
ainfî les couleurs des chofès fènfîbles , pour
exprimer par analogie, des idées qui, (ans.cela,
feroient vagues, foibles , confufès. Ce qui ne fè
peint point à l’imagination, échappe ailément à l ’efè
prit. Fûyei Image. ( M. Marmontzl. )
ALLÉGORIQUE , adj. Belles-lettres y Poèfie«
Un perfènnage allégorique eft une paflion , une
qualité de l’ame , un accident de la nature , une
idee abftraite perfènnifiée. Prelque toutes les divinités
de la fable fènt allégoriques dans leur ori-
; gine, la Beauté, l’Amour, la Sagefle, ,1e Temps ,
les Saifons , les Eléments , la Paix, la Guerre, &c.
Mais lorfquè ces idées abftraîtes perfènnifiées ont
été réellement l ’objet du culte d’une nation , & que
dans (à croyance elles ont eu une exiftence idéale ,
elles fènt mifès, dans l ’ordre du merveilleux, au
nombre des réalités, & ce n’eft plus ce qu’on appelle
des Perforatages allégoriques.
Il eft vraifèmblable que dans le langage des
premiers poètes, FAllégorie fut la pépinière de«
dieux ; l’opinion en prit ce qu’elle voulut pour
former la mythologie, & iaifla le refte au nombre
des fiftions.
Le même perfènnage eft employé comme réel
dans un poème, & comme allégorique dans un
autre , félon que le (yftême religieux dans lequel
ce perfènnage eft réalifé convient ou non au fùjet'
du poème. Ainfî, par exemple, dans Y Enéide l’A mour
eft pris pour un être réel, & dans la Henriade
ce n’eft qu’ un être allégorique, de la même clafle
que la Politique & la Difèorde.
Nos anciens poètes ont porté à l’excès l’abus des
I perfènnages allégoriques t le Roman de la Rofe
les avoit mis en vogue : dans ce roman l ’on voit
çrç fçènc * Jaloufie, B çhie çuçil, Fauxfemblant,