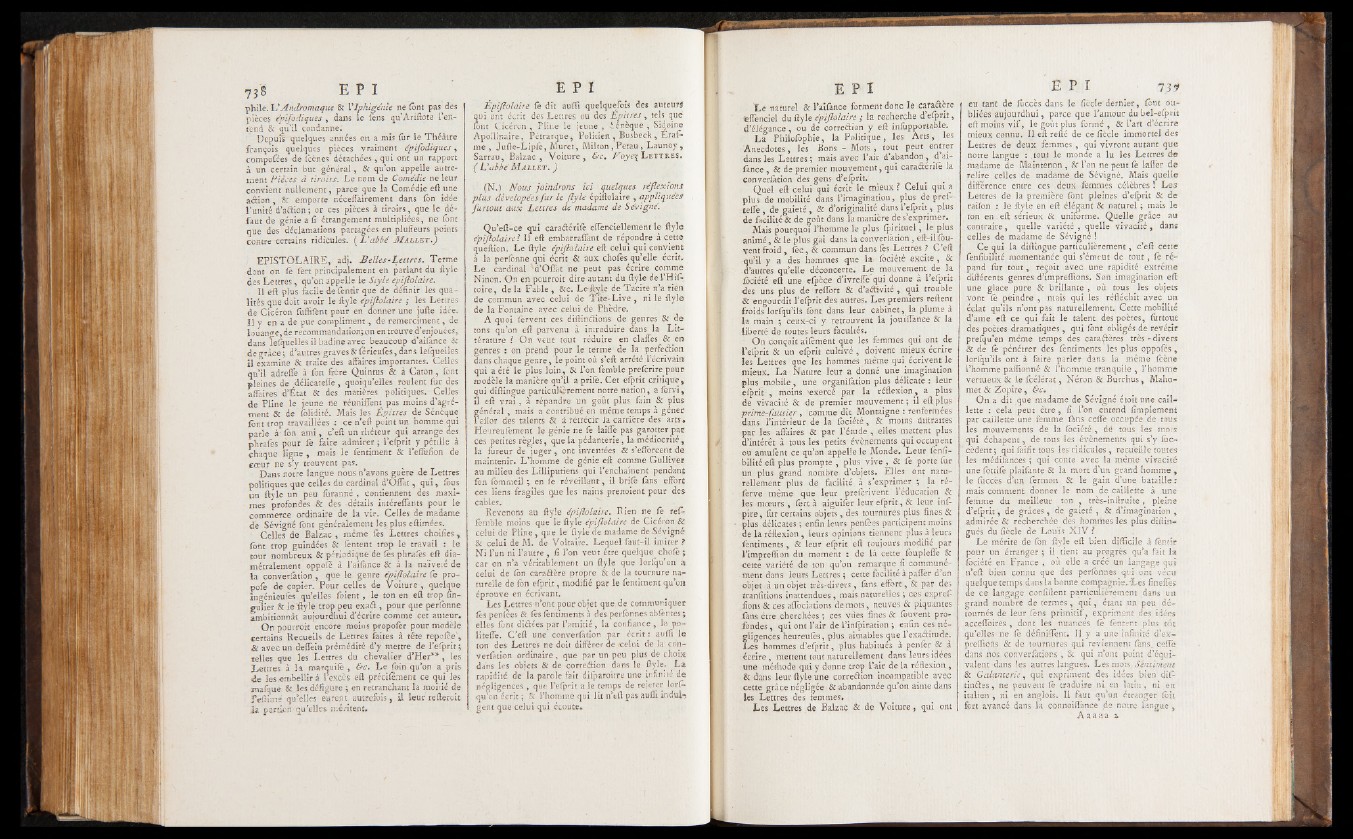
phile. L* Andromaque & Y Iphigénie ne font pas des
pièce? épifodiques , dans le fens qu’Ariftote l’entend
& qu’il condanne.'
Depuis quelques années on a mis fur le Théâtre
françois quelques pièces vraiment épifodiques,
compofées de (cènes détachées, qui ont un rapport
à un certain but général, & qu’on appelle autrement
Pièces à tiroirs. Le nom de Comédie ne leur
convient nullement, parce que la Comédie eft une
aétion, & emporte nécefiairement dans fon idée
l ’unité d’adion; or ces pièces à tiroirs, que le défaut
de génie a fi étrangement multipliées, ne font
que des déclamations partagées en plulïeurs points
contEe-cersains ridicules. ( L'abbé M allet.)
EPISTOLAIRE, adj. Belles-Lettres. Terme
dont on fo fert principalement en parlant du ftyle
des Lettres, qu’on appelle le Style épijlolaire.
Il eft plus facile de fentir que de définir les qualités
que doit avoir le ftyle épijlolaire ,* les Lettres
de Cicéron fuffifent pour en donner une jufte idée.
Il y en a de pur compliment, de remerciaient, de
louante, de recommandation; on en trouve.d’enjouées,
dans lefqu elles il badine avec beaucoup d’aifonce &
de errâce ; d’autres graves & férieufes, dans lesquelles
il examine & traite des affaires importantes. Celles
qu’il adrefle à fon frère Quintus & à Caton, font
pleines de délicatefle, quoiqu’elles roulent fur des
affaires d’État & des matières politiques. Celles
de Pline le jeune ne réunifient pas moins d’agrément
& de folidité. Mais les É p i très de Sénèque
font trop travaillées : ce n’eft point un homme qui
parle à- fon ami , c’ eft un rhéteur qui arrange des
phrafes pour fe foire admirer ; l’efprit y pétille à
chaque ligne , mais le fontiment & l ’effufion de
coeur ne s’y trouvent pas.
Dans notre langue nous n’avons guère de Lettres
politiques que celles du cardinal d’Oflàt, qui, fous
un ftyle un peu foranné , contiennent des maximes
profondes & des -détails intérefîants pour le
commerce ordinaire de la vie. Celles de madame
de Sévigné font généralement les plus eftimées.
Celles de Balzac , même fos Lettres choifies,
font trop guindées & Tentent trop le travail : le
tour nombreux & périodique de fos phrafos eft diamétralement
oppofe à l’aifonce & à la naivete de
la converfotion, que le genre épijlolaire fo pro-
pofe de copier! Pour celles de Voiture , quelque
ingénieufes qu’elles foierit, le ton en eft trop fîn-
gulier & le ftyle trop peu exaft , pour que perfonne
ambitionnât aujourd’hui d’écrire comme cet auteur.
On pourroit encore moins propofor pour modèle
certains Recueils de Lettres faites à tête repofoe',
& avec un defiein prémédité d’y mettre de l ’efprit ;
telles que les Lettres du chevalier d’Her**, les
Lettres à la marquife , &c. Le foin qu’on a pris
de les .embellir à l’excès eft précifément ce qui les
mafque & les défigure ; en retranchant la moitié de
3’ eftimé qu’elles eurent autrefois, il leur refteroit
la portion-qu’elles méritent.
Épijlolaire fo dit aufii quelquefois des aufetirg
qui ont écrit des Lettres ou des Épiires, tels que
font Cicéron , Pline le jeune , ienèque , Sidoine
Apollinaire, Pétrarque, Politien , Busbeck, Ëraf-
me , Jufte-Lipfo, Muret, Milton, Petau , Launoy ,
Sarrau, Balzac, Voiture, &c, Voye\ L ettres.
( U a b b é M a l l e t . )
(N.) Nous joindrons ici quelques réflexions
plus dèvelopéesfur le ftyle épiftolaire , appliquées
furtout aux Lettres de madame de Sévigné.
Qu’eft-ce qui caradérifo eftènciellement le ftyle
épijlolaire l II eft embarrafîant de répondre à cette
queftion. Le ftyle épijlolaire eft celui qui convient
à la perfonne qui écrit & aux chofos qu’elle écrit.
Le cardinal '"d’Offat ne peut pas écrire comme
Ninon. On en pourroit dire autant du ftyle del’Hifo
toire, delà Fable, &c. Le^ftyle de Tacite n’a rien
de commun avec celui de Tiiè-Live , ni le ftyle
de la Fontaine avec celui de Phèdre.
A quoi fervent ces diftin&ions de genres 8c de
tons qu’on eft parvenu à introduire dans la Littérature
? On veut tout réduire en clafies & en
genres : on prend pour le terme de la perfedion
dans chaque genre, le point où s’eft arrêté l’écrivain
qui a été le plus loin, & l’on fomble preferire pour
modèle la manière qu’il a prifo. Cet efprit critique,
qui diftingue particulièrement notre nation, a fervi„
il eft vrai , à répandre un goût plus foin & plus
général, mais a contribué en même temps à gêner
l’eflor des talents & à rétrécir la carrière des arts.
Heureufoment le génie ne fe lailfe pas garotter par
ces petites règles, que la pédanterie, la médiocrité,
la fureur de juger, ont inventées 8c s’efforcent de
maintenir. L ’homme de génie eft comme Gulliver
au milieu des Lilliputiens qui l’enchaînent pendant
fon fommeil ; en fo réveillant, il brifo fons effort
ces liens fragiles que les nains prenoient pour des
cables.
Revenons au ftyle épijlolaire. Rien ne fo ref-
fomble moins que le ftyle épijlolaire de Cicéron &
celui de Pline, que le ftyle de madame de Sévigné
& celui de M. de Voltaire. Lequel faut-il imiter ?
Ni l’un ni l’autre , fi l’on veut être quelque chofo ;
car on n’a véritablement un ftyle que lorfqu’on a
celui de fon caradère propre & de la tournure naturelle
de fon efprit, modifié par le fontiment qu’on
éprouve en écrivant.
Les Lettres-n’ont pour objet que de communiquer
fos penfées & fos fèntiments à des perfonnes abfer.tes;
elles font didées par l’amitié, la confiance, la po-
liteffe. C ’eft une converfotion par écrit : aufii le
ton des Lettres ne doit différer de celui de la çon-
verfotion ordinaire, que par un peu plus de choix
dans les objets & de corredion dans le ftyle. La
rapidité de la parole fait difparoître une infinité de
négligences , que l’efprit a le temps de rejeter lorsqu’on
écrit ; & l’homme qui lit n’tfl pas aufii induis
gent que celui qui écoute.
Le naturel & lYtfonce forment donc Ie cafadère
teiïenciel du ftyle épijlolaire ; la recherche d’efprit,
d’élégance, ou de corredion y eft infùpportable.
La Phiiofophie, la Politique, les Arts, les
Anecdotes, les Bons - Mots, tout peut entrer
dans les Lettres; mais avec l’air d abandon, d ai-
fonce , & de premier mouvement, qui caraderifo la
converfotion des gens <fefprit.'
Quel eft celui qui écrit le mieux? Celui qui a
plus de mobilité dans l’imagination, plus de pref-
teffe , de gaieté , & d’originalité dans 1 efprit y plus
de facilité & de goût dans la manière de s’exprimer.
Mais pourquoi l’homme le plus fpirituel, le plus
animé, & le plus gai dans la converfotion, eft-il fou-
vent froid , foc, & commun dans fos Lettres ? C’eft
qu’il y a des hommes que la- fociété excite , &
d’autres qu’elle déconcerte. Le mouvement ^de la
fociété eft une efpèce d’ivrefie qui donne i l’efprit
des uns plus de reflort & d’aéfctvite, qui trouble
& engourdit l’efprit des autres. Les premiers reftent
froids lorfqu’ils font dans leur cabinet, la plume a
la main ; ceux-ci y retrouvent la jouiiïanee & la
liberté de toutes leurs facultés.
On conçoit aifoment que les femmes qui ont de
l ’elprit & un eiprit cultivé , doivent mieux écrire
les Lettres que les hommes même qui^ écrivent le
mieux. La Nature leur a donné une imagination
plus mobile, une organifotion plus délicate : leur
efprit , moins 'exercé par la réflexion , a plus
de vivacité & de premier mouvement; il eft plus
prime-fauùer , comme dit Montaigne : renfermées
dans l’intérieur de la fociété, & moins diftraites
par les affaires & par l’étude , elles mettent plus
d’intérêt à tous les petits évènements qui occupent
ou amufont ce qu’on appelle le Monde. Leur fonfi-
bilité eft plus prompte , plus vive , & fo porte for
un plus grand nombre d’objets. Elles ont naturellement
plus dé facilité à s’exprimer ; la re-
forve même que leur preforivent l’éducation &
les moeurs , fort à aiguifor leur efprit, & leur infi-
pire, for certains objets , des tournures plus fines &
plus délicates ; enfin leurs penfées participent moins
de la réflexion, leurs opinions tiennent plus à leurs
fontiments, & leur efprit eft toujours modifié par
l’impreflion du moment : de là cette foupleflè &
cette variété de ton qu’on remarque fi communément
dans leurs Lettres ; cette facilité à paflèr d’un
objet à un objet très-divers , fons effort, & par des
transitions inattendues, mais naturelles ; ces expref
fions & ces aflôciations de mots , neuves & piquantes
fons être cherchées ; ces vues fines & fouvent profondes
, qui ont l’air de l’infpiration ; enfin ces négligences
heureufos, plus aimables que l’exaéfitude.
Les hommes d’efprit, plus habitués à penfor dt à
écrire, mettent tout naturellement dans leurs idees
une méthode qui y donne trop l’air de la reflexion ,
& dans leur ftyle une corredion incompatible avec
cette grâce négligée & abandonnée qu’on aime dans
les Lettres des femmes.
Les Lettres de Balzac & de Voiture, qui ont
eu tant de focccs dans le fiècle dernier, font oubliées
aujourdhui, parce que l’amour du bel-efprit
eft moins vif, le goût plus formé , & l’art d’écrire
mieux connu. Il eft refté de ce fiècle immortel des
Lettres de deux femmes , qui vivront autant que
notre langue : .tout le monde a lu les Lettres do
madame de Main tenon , 8c l’on ne peut fe laffer de
relire celles de madame de Sévigné. Mais quelle
différence entre ces deux femmes célèbres ! Les
Lettres de la première font pleines d’efprit & de
raifon : le ftyle en eft élégant & naturel ; mais le
ton en eft sérieux & uniforme. Quelle grâce au
contraire, quelle variété , quelle vivacité, dans
celles de madame de Sévigné !
Ce qui la diftingue particulièrement, c’eft cette
fenfibilité momentanée qui s’émeut de tout, fo répand
for tout, reçoit avec une rapidité extrême
différents genres d’impreflions. Son imagination eft
une glace pure & brillante , où tous les objets
vont fo peindre , mais qui les réfléchit avec un
éclat qu’ils n’ont pas naturellement. Cette mobilité
d’ame eft ce qui fait le talent des poètes, fortout
des poètes dramatiques , qui font obligés de revêtir
prefou’en même temps des caraâères très - divers
& de fo pénétrer des fontiments les plus oppofés ,
lorfqu’ils ont à faire parler dans la même feène
l’homme paflionné & l’homme tranquile , l’homme
vertueux & le fcélérat, Néron & Burrhus, Mahomet
& Zopire, & c .
On a dit que madame de Sévigné étoit une caillette
: cela peut être, fi l’on entend Amplement
par caillette une femme fons ceflè occupée de tous
les mouvements de l'a fociété , dé tous les mots
qui échapent, de tous les évènements qui s’y foc-
1 cèdent ; qui foifît tous les ridicules , recueille toutes
les médifonces ; qui conte avec la même vivacité
une fotrife plaifonte & la mort d’un grand homme ,
le foccès d’un fermon & le gain d’une bataille :
mais comment donner le nom de caillette à une
femme du meilleur ton , très-inftruite, pleine
d’efprit, de grâces, de gaieté , & d’imagination ,
admirée & recherchée des hommes les plus diftin-
gués du fiècle de Louis X IV ?
Le mérite de fon ftyle eft bien difficile à fon tir
pour un étranger ; il tient au progrès qu’a fait la
fociété en France , où elle a créé un langage qui
n’eft bien connu que des perfonnes qui ont vécu
quelque temps dans la bonne compagnie. Les fineflès
de ce langage confîftent particulièrement dans un
grand nombre de termes, qui, étant un peu détournés
de leur fons primitif, expriment des idées
acceflbires, dont les nuances fe fentent plus tôt
qu’elles- ne fo définifienc. Il y a une infinité d’ex-
prefiions & de tournures qui reviennent fens_ cefle
dans nos convertirions , & qui n’ont point d’équivalent
dans les autres langues. Les mots,; Sentiment
8c Galanterie, qui expriment des idées bien dif-
tindes, ne peuvent fo traduire ni en latin, ni en
italien , ni en anglois. Il faut qu’un étranger foit
fort avancé dans la connoifiànce ,de notre langue,