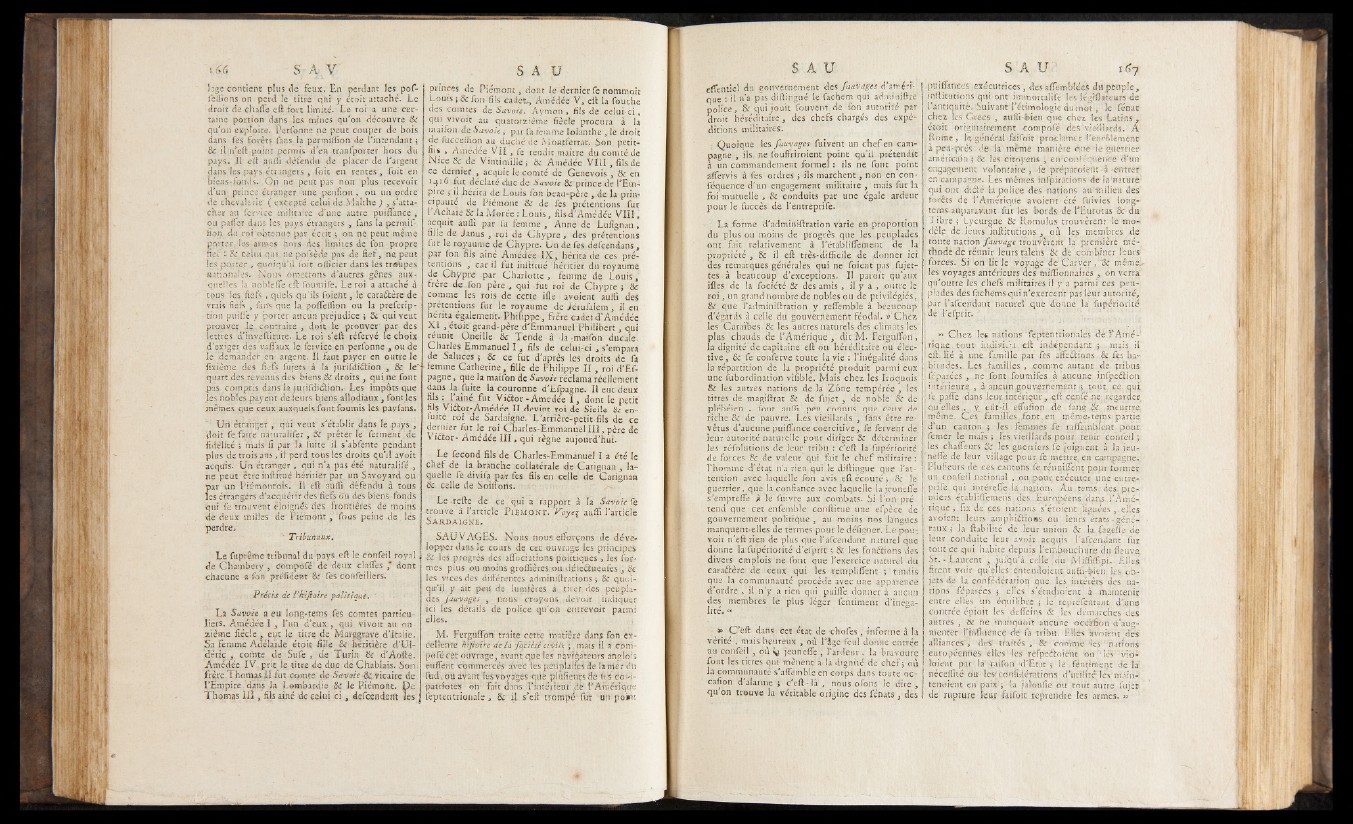
l U SA V
hge contient plus de feux. En perdant les pof-
leûîons on perd le titré qtii- y étoit attaché. Le
droit de chalTe eft fort limité. Le roi a une certaine
portion dans les mines qu'on découvre &
qu’on exploite. Perfonne ne peut couper de bois
dans fes forets fans la permiflion de l'intendant 5
& il n’eft point permis d’en tranfporter hors du
pays. ,11 eft jnifli défendu de placer de l’argent
dans les pays étrangers , foie en rentes, foit en
biens-fomls. Qn .ne peut pas non plus recevoir
d’ un; prince étranger une penfion , ou un ordre
de chevalerie' ( excepté celui de Malthe ) , s’attacher
au ferviee militaire d’une autre puiffance ,
ou pâfisr dans les pays étrangers , fans îa permif
iîoij»- du roi obtenue par écrit » on ne peut même
pqrter. lôS;armes hors des lirnites de fon propre
fief | & celui qui ne pofsedje pas de fief, ne peut
les pqrrej* , quoiqu’il foit officier dans les trôhpes
nationales. Nous omettons d’autres gênes auxquelles
la npbieffe eft foumife. Le roi a attaché à
tous les fiefs , quels qu’ils Coient, le caractère de
vrais fiefs , fân's que la. pofleflïon ou la preferip-
• tion pu-ifiè y porter aucun préjudice ; 8c qui veut
prouver fo. contraire , doit le prouver" par des
lettres d’ inveuiture. Le roi s’eft réfervé le choix
d’exiger des vaftaux le fervice en perfonne , ou de
le .demander en argent. Il faut payer en outre le
fixième des fiefs fujets ~à la jurifdiéUon , & le"
quart des revenus des biens.8c droits , qui,ne font
pas compris dans la jurifdiôlion. Les impôts que
les nobles payent de leurs bjens allodiaux, font les
mêtnes que ceux auxquels font fournis les payfàns.
Un étranger', qui veut s’établir dans le pays ,
doit fefaire ndturalifer, & prêter le ferment'"dé
fidélité ; niais fi par l a fuite il. s’a b fente pendant
plus de trois ans, if perd tous les droits qu’il avoir'
acquis. Un étranger , qui n’a pas été naturalifé
ne peut être milieué héritier par un Savoyard ou
par un Piéihbntbis. Il ell aùfli défendu à tous
les étrangers d’acqüérir desfiéfs ou des biens-fonds
qui fe 'trouvent éloignés dé's frontières dé moins
de deux milles de" P iéfo ôtttTous peiné de lés
perdre,
' Tribufiaux.
Le fuprêrhe tribunal du'pays, eft le confeîl royal j
de Chambéry , Chmppfé'dè deux clafies ,* dont
chacune a fort prëfident &■ fes confeillers.
Précis. de Vfiiftoire poli tiqué. ' .
La Savoie a eu long-terns fes comtes particuliers.
Amédée I , l ’un d’eux , qui vivoit au on
zième fiécle , eut le titre de, Marggrave d’Italie.,
Sa Femme Adélaïde étoit fille & héritière d’.Ui-
dériç t comte de’ Sufe * de Turin 8c d’Aofte.
Amédée, IV .prit, le titre de dite de Çhablais. Son
frère Thomas i l fut comte de Savoie vicaire de
rÉîijpire, dans la Lombardie, •& le Piémont. De
Thomas ï l l , fils aîné de celui c i , defcénden't les
S A U
princes de Piémont, dont le dernier fe nommoit
Louis j & fon fils cadet., Amédée V, eft la fouche
des comtes de Savoie. A y mon , fils de celui-ci,
qui vivoit au quatorzième fiée le procura à la
mai fon de Savoie , par fa-femme lolanthe , le droit
de fucceffiqn au duché de Mou^ferrat. Son petit-
fils > Amédée V I I , fe rendit maître du.comté de
Nice & de Vin’timïlléi & Amédée V I I I , fils de
ce dernier , acquit le comté de Genevois , & en
1416 fut déclaré duc de Savoie 8c prince de l’Ein-
pire j il hérita de Louis fon beau-père , de la principauté
de Piémont 8c de fes prétentions fur
1 Àchaïe & la Morée : Louis, filsd'Amédée V I I I .
acquit aufll par fa femme , Anne de Lufignan *
fille de Janus , .roi de Chypre , des prétentions
fur le royaume de Chypre. Un de fes defeendans,
par fon fils aine Amédée IX , hérita de ces prétentions
, car il fut ihftitué héritier du royaume
de^ Chypre par Charlotte , femme de Louis,
frere de. fon père , qui fut roi de Chypre ; 8c
comme les rois de cette ifle avoient auffi des
prétentions fur le royaume de Jérufalem, il e-n
hérita^ egalement. Philippe, frère cadet d’Amédée
X I , étoit grand-père d’Emmanuel Philibert, qui
réunit Oneille 8c Tende à la-ma-ifon ducale.
Charles Emmanuel I., fils de celui-ci , s’empara
de Saluces j & ce fut d’après les droits de fa
-femme Catherine, fille de Philippe I I , roi d’Ef-
pagne, que la maifon de Savoie réclama réellement
dans .la fuite la couronne d'Efpagne. Il eut deux
fils: laine fut Viéfcor-Amédée I , dont le petit
fils Viélor- AmédéeTI devint roi de Sicile & en-
fuité ról de Sardaigne. L ’arrière-petit-fils de ce
dernier fut le roi Charles-Emmanuel I I I , père de
Viétor- Amédée I I I , qui règne aujourd’hui;
Le fécond fils de Charles-Emmanuel I a été le
chef de la branche collatérale de Garignan , la*
quelle fe divifa par Tes fils en celle de Garignan
& celle de Solfions. t
Le.refte de ce qui a rapport à la Savoie fe
trouve à l’article P iém o nt. Voye{ auffi l’article
Sa r d a ig n e .
SAU V A G E S . Nous nous efforçons de développer
dans le cours de cet ouvrage les principes
H les progrès des afiociations politiques i les formes
plus ou moins groffièresroudéfeâueùiêsi, &
les vices des différentes adminiftrations > 8c quoiqu’il
y ait peu de lumières à., ,tiret des peuplad
e s fauvages 4 nous croyons devoir indiquer
ici les détails de police qu’on entrevoit parmi
elles. •
M. FergulTon traite cette m;atrê.re dans fon excellente
klfkiïïe de la fbtiêté cifilh j mais II a ébiti-
pèfécétouvrage,,àvan'çqpe les navigateurs àhgfôis
eu fient commerces afvéc lés péiipladeide la hiér du
(tidiOüavant fesvbyà'ges que pliiiieiqsSéle’s oö>i-
patrioteS oh- fait dans ;lUnférièùr: LÂmërîqùé
feptentrionale , & ' il s’efi trompé ftd uri-point
S A U
cfientiel du gouvernement des fauvages d ’smérî-
que : il n’a pas diftingué le fachem qui adminiftre
police, 8e qui jouit fouvent de fon autorité par
droit héréditaire, des chefs- chargés des expé^
ditions militaires.
Quoique les fauvages fuivent un chef en campagne
, ils, ne fouffriroient point qu’il prétendît
à un commandement formel : ils ne font point
aflervis à fes ordres } ils marchent, non en con-
féquence d’un engagement militaire , mais fur la
foi mutuelle, & conduits par une égale ardeur
pour le fuccès de l’entreprife.
La forme 'd’adminiftration varie en proportion
du plus ou moins de progrès que les peuplades,
ont fait relativement à l’établifiement de la:
propriété , & il eft très-difficile de donner ici
des remarques générales qui ne foient pas fujet-
tes à beaucoup d’exceptions. Il pardît qu’aux
ifles de la fociété & des amis , il y a , ,outre le
ro i, un grand nombre de nobles ou de privilégiés,
& que l’adminiftration y refiemble à beaucoup
d’égards à celle du gouvernèmént féodal. » Chez
les Caraïbes & les autres naturels des climàts les
plus chauds de l’Amérique, dit M. Fergufibn ,
la dignité de capitaine eft ou héréditaire ou élective
, & fe conîërve toute la vie : l’inégalité dans
la répartition de la propriété produit parmi eux
une îubordination vifible. Mais chez les Iroquois
& les autres nations de là Zone témpérée , les
titres de magiftrat & de' fujet , de noble &r de
plébéien , font auffi peu connus que ceux de
riche & 'de pauvré. Les vieillards , fans être revêtus
d’aucune puiffance coercitive, fe fervent de
leur autorité narurelle'pour diriger & déterminer
les réfolutions de leur tribu : c’eft la fupériorité
de forces & de valeur qui fait le chef militaire :
l'homme d’état n’a rien .qui le diftingué que l’attention
avec laquelle fon avis eft écouté > & le
guerrier, que la-confiance avec laquelle la jeunefiTe
s’emprefie i le fuivre aux combats. Si l ’on prétend
que cet enfemble' conftîtue une efpèce de
gouvernement politique . au moins nos langues
manquent-elles de termes pour le défigner. Le pou-:
voir n’eft rien de plus que l’afcendant Naturel que
donne la fupériorité d’efprit ; & les fonîftions des
divers emplois ne font que l’ exercice naturel du
caradère de ceux qui les rempliffent ; tandis
que la communauté procède avec une apparence
d’ordre , il n’y a rien qui puifle donner à aucun
des membres le plus léger lentiment d’inégalité.
cé
*• Ç ’êft dans cet état de chofes, informe à la
vérité , mais heureux , où l ’âge feu 1 donné entrée
au conféil , où % jeunefle , l’ardeur, la bravoure
font les titres qui 'mènent-à'la dignité de chef 5 ou
la communauté s’affemble en corps dans toute oc-
cafion d’alarme j c’e f t - la , nous ofons le dire ,
qu on trouve la véritable origine des fénats , dés
S A U 167
pujfiances exécutrices , des afiè-mblées du peuple,
inftitutionsiqni ont immortalifé les législateurs de
rantiquké; Suivant rétimologie du m o t, le fénac
chez les Grecs , auffi-bien que chez les Latins ,
étoit originairement compofé des ^vieillards. A
; Roine , Iq gëroéral ■ faifoir proclamer Fenrôlément-
|a peU'pî’è-s - de la même manière qner‘le guerrier
’ an^ériicaïn 5 & les citoyens , en‘coulé que née d’un
engagement vofontaire , Te préparoient à -entrer
en campaJgDe. Les mêmes infpkations de ia'nature
qui ont dîiSlé la police des nations au iriilieu des
forêts de 'l’Amérique avoient été fuivies iong-
terns auparavant fur ies bords de l’ Eu-rotas 8e du
] ibre ; Lycurgue 8e Romulus trouvèrent fëmo*.
dèlç de .leurs inftitutions , où les membres de
toute nation fauvage trouvèrent la pterbièrè méthode
de réunir leurs talent - & dé combiner leurs '
forces. Si on lit le .voyage de"Çarver même>
les voyages antérieurs des mïffionnaires , on verra'
qu’outre les chefs militaires il y a parnii ces peuplades
des faehêms qui n’exercefit pas leut autorité,
par l’afcendant naturel què donne la fiiperiorité
de l'efprit. '
« C hez les nations Teptentrionalei dè FAmé-1
irique , tout individu, -dl indépendant 4 .. mais, il
eft lié à une famille par fes affections & fes habitudes.
Les familles , .comrpe .autant de tribus-
féparées , ne font foutnifes à aucune infpeétion
I intérieure , d aucun gouv^rpeme.nt .) tout çe qui
: le. pàfie dans leur- iptériçiir, eft c^nfe .ne, regarder
qu e lle s ,,)^ eut-il effufion de fang .meiirtrej
même, Ç.es familles,font. en même-temS'partie
d’un canton j les fouîmes Te raflemblent pour,
femer le maïs j les.vieillards pour tenir conlcil ;
les chafteurs & les guerriers fe joignent à la jeûné
fie de leur village pour. fe mettre(en campagne^
Plufieurs de ces ca.ntons lé réunifient pour former
un confeil national, ou .pour exécuter une entre-
pfife. qui intérefie la,, nation. A u . tems f desTpre-
iriiers étab.1 i(Ternens des.. .Européens, ^dapp . 1’.Âméé
rique, fix de. ces nations s’étoient ( liguée s ,. el les
avoient leurs amphiétioas ou leurs éfats-généraux
; la Habilité de leur union <k. la fagefie de
leur conduite leur avoir acquis I’afcendant fur
tout ce qui habite depuis l’emboncfii|re du fleuve,
St. - Laurent , ju.fou.’à. .celle ;du iMifoftbpn -Éllss
firent voir qu’elles:e;ntenclqient aiftù-ij>ien, les objets
de la confédé.rarion que les intérêts des, nations
féparées 5 elles s’étndioient à maintenir
entre elles un équilibre j le repréfentant d'une
contrée épioit les defieins les démarches des
autres, & ne manquoit aucune océf/fion d'augmenter
l’ i-nflivence dé1 fa tribu. Elles àvoi'enc des
allianceS' i !des’ traités , fk comme des " narrons
européennes elles1 les réfpeéioiéïtc ou :‘ lé‘é ; v:io-
loient par,; lâ!%-raifon 'd’Etat j lé' féntinVenc de la:
néceffiié ou-leycohiîdér<atioins d’ùriHté^lés mâin-i
tenaient en' paix' ; la jâloufié ou tout autre fujet
de rupture leur faifoit reprendre les armes. »