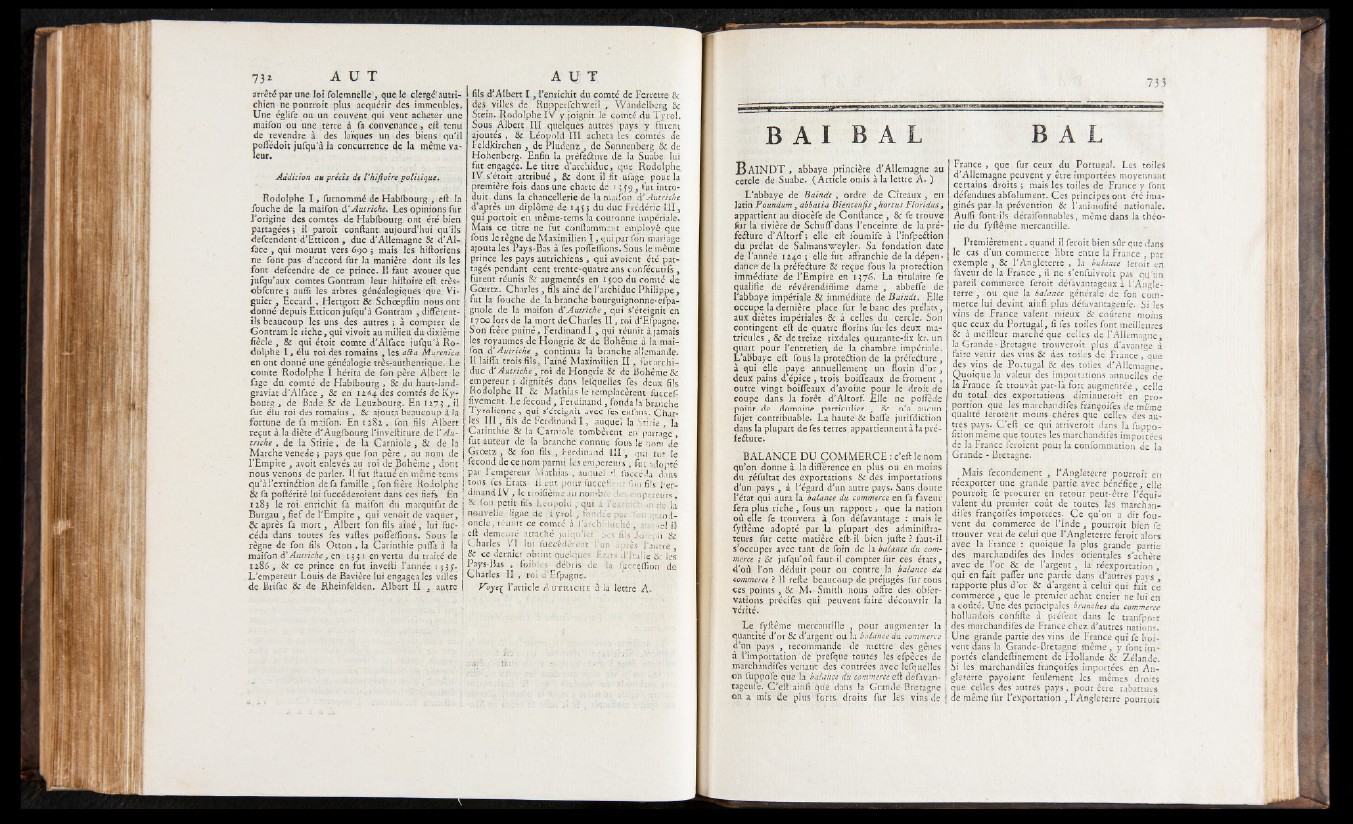
7 3 * A U T
arrêté par une loi folemnelle, que le clergé:autrichien
ne pourroit plus acquérir des immeubles,
Une églife ou un couvent qui veut acheter une
maifon ou une terre à fa convenance, eft tenu
de revendre à des laïques un des biens qu’il
poffédoît jufqu’à la concurrence de la même valeur.
Addition au précis de l ’hifioire polit ique.
Rodolphe I , furnommé de Hablbo.urg , eft la
fouche de la maifon d’Autriche. Les opinions fur
l’origine des comtes de Hablbourg. ont été bien
partagées j il paroît confiant aujourd’hui qu'ils
defcendent d’Etticon , duc d’Allemagne & d’Al-
face , qui mourut vers 690 $ mais les hiltoriens
ne font pas d’accord fur la manière dont ils les
font defcendre de ce prince. Il faut avouer que
jufqu’aux comtes Gontram leur: hiltoire eft très-
obfcure ; aufli les arbres généalogiques, que Vi-
guier, Eccard , Hertgott & Schoepflin nous, ont
donné depuis Etticon jufqu’ à Gontram , diffèrent-
ils beaucoup les uns des autres j à compter de
Gontram le riche, qui vivoit au milieu du dixième
fiècle, & qui étoit comte d’Alface jufqu'à Rodolphe
I , élu roi des romains , les aEta Murenzca
en ont donné une généalogie trèsrauthentique. Le
comte Rodolphe I hérita de fon père Albert le
fage du comté de Hablbourg, & du haut-Jand-
graviat d'Alface , & en 1264 des comtés de K y -
bourg, de Bade & de Leuzbourg. En 127.3 * il
fut élu roi des romains , & ajouta beaucoup à. la
fortune de fa m-dfon. En 1282, fon fils Albert
reçut à la diète d’Augfbourg l’inveftiture de V Autriche
9 de la Stirie, de la Carniole, & de la
Marche venede j pays que fon père , au nqrn de
l ’Empire , avoit enlevés au roi de.Bohême 3 dont
nous venons de parler. 11 fut ftatuéen même tems
qu’à l’extinélion de fa famille '3 fon frère Rodolphe
& fa poftérité lui fuccéderoient dans ces fiefs En
1285 le roi enrichit fa maifon du marquifat de
Burgau , fief de l’Empire , qui venoit de vaquer,
& après fa mort, Albert fon fils aîné, lui fuc-
céda dans toutes fes vaftes poffeflions. Sous le
règne de fon fils O tton , la Carinthie paffa à la
maifon d’ Autriche, en 13 31 en vertu du traité de
?286, & ce prince en fut invefti l ’année. 1 j 3 y.
L ’empereur Louis de Bavière lui engagea les villes
de Brifac & de Rheinfelden. Albert II , autre
A U T
1 fils d’Albert I , l’enrichit du comté de Ferrette &
des villes de Rupperfchweil , Wàndelberg &
Stein. ïlod olp helV y.joignit le comté duTyrol.
Sous Albert III quelques autres pays ÿ furent
ajoutés , & Léopold III acheta les comtés de
Feldkirchen , de Pludenz , de Sonnenberg & de
Hohenberg. Enfin la préfecture de fa Suabe lui
fut engagée. Le titre d’archiduc, que Rodolphe,
IV.s’étoit attribué, & dont il fit ufage pour la
première fois dans une charte de 1339, fat introduit
dans la chancellerie de la maifon d’ Autriche
d’après un diplôme de 1453 du duc Frédéric I I I ,
qui portoit en même-tems la couronne impériale.
Mais ce titre ne fut conftamment employé que
fous le règne de Maximilien I , qui par fon mariage
ajouta les Pays-Bas à fes poffelïions. Sous le même
prince les pays autrichiens , qui avoient été partagés
pendant cent trente-quatre ans confécutifs,
furent réunis & augmentés en 1300 du comté de
Goertz. Charles, fils aîné de l’archiduc Philippe,
fut la fouche de la branche bourguignonne-efpa-
gnole de la maifon’ d’Autriche 3 qui s’éteignit en
1700 lors de la mort deCharles I I , roi d’Efpagnë.
Son frère puîné, FerdinandI , qui réunit à.jamais
! les royaumes de Hongrie & de Bohême à la maifon
d’ Autriche , continua la branche allemande.
Il laiffa trois fils , l’aîné Maximilien I I , fut archiduc
d’Autriche, roi de Hongrie & de Bohême &
empereur dignités dans lesquelles fes deux fils
Rodolphe II & Mathias lé remplacèrent fuccef
five'ment. Le fécond, Ferdinand , fonda là branche
Tyrolienne , qui s’éteignit avec fes enfans. Char-
: les I I I , fils de Ferdinand I , auquel la Stirie , la
Carinthie & la Carniole tombèrent en partagé ,
fut auteur de la branche connue fous le nom de
, Groetz , & fon fils , Ferdinand III , qui fut le
! fécond de ce nom parmi lés empereurs , fui adopté
| par l’empereur Mathias-, auquel si fuccéda dans
j tous fes Etats- il eut pour fucceffeut fon fils Fer-
! dinand IV , le troifième au nombre des.empereurs,
& fon petit fils Léopold y qui à l’extiriéhon de là
j nouvelle ligne de T y r o i , fondée par ion 'grand-
i oncle, réunit ce comté à l’àrchiduché, auquel il
j.eft demeuré attaché jiuqu’ici Ses fils Jofeoii &
Charles VI iui fuccédèrënt l’un après l’autre
& ce dernier obtint quelques Etats d’Italie & les
Pays-Bas , foibles débris de la fucceffion de
Charles II , roi d’Efpagne.
Voyei l’article A ütriche à la lettre A .
ilki
733
BAI BAL B AL
B AIN D T , abbaye princière d’Allemagne au
cercle de Suabe. (Article omis à la lettre A . )
L ’abbaye de Baindt , ordre de Cîteaux, en
latin Poundum 3 abbatia Bientenjis, hortus Floridas,
appartient au diocèfe de Conftance , & fe trouve
fur la rivière de SchufT dans l’enceinte de la préfecture
d’Alto rfj elle eft foumife à l’infpeétion
du prélat de Salmansweyler. Sa fondation date
dé l’année 1240 $ elle fut affranchie de la dépendance
de la préfecture & reçue fous la protection
immédiate de l’Empire en 1376. La titulaire fe
qualifie de révérendiflîme dame , abbeffe de
l’abbaye impériale & immédiate de Baindt. Elle
occupe la dernière place fur le banc des prélats,
aux diètes impériales & à celles du cercle. Son
contingent eft de quatre florins fur les deux matricules
, & de treize rixdalcs quarante-fix kr. un
quart pour l’entretier\ de la chambre impériale.
L ’abbaye eft fous la protection de la préfecture,
à qui elle -paye annuellement un florin d’o r ,
deux pains d’épice , trois boiffeaux de froment ,
outre vingt boiffeaux d’avoine pour le droit de
coupe dans la forêt d’Altorf. Elle ne poffècle
point de domaine particulier , & n’a aucun
fujet contribuable. La haute & baffe jurifdiCtion
dans la plupart de fes terres appartiennent à la préfecture.
B A L A N C E DU C OM M E R C E : c’ eft le nom
qu’on donne à-la différence en plus ou en moins
du réfultat des exportations & des importations
d’un pays , à l'égard d’un autre pays. Sans doute
l’état qui aura la balance du commerce en fa faveur
fera plus riche, fous un rapport, que la nation
où elle fe trouvera à fon défavantage : mais le
fyftême adopté par la plupart des adminiftra-
teurs fur cette matière eft il bien jufte ? faut-il
s’occuper avec tant de foin de la balance du commerce
; & jufqu’où faut-il compter fur ces états,
d’où l’on déduit pour ou contre la balance du
commerce ? Il relte beaucoup de préjugés fur tous
ces points , & M. • Smith nous offre des obfer-
vations précifes qui peuvent faire* découvrir la
vérité.
Le fyftême mercanrille , pour augmenter la
quantité d’or 8c d’argent ou la balance du commerce
d’un pays , recommande de mettre des gênes
à l’importation de prefque toutes les efpèces de
marchandifes venatrt des contrées avec lefquelles
on fuppofe que la balance du commerce eft dé fa van- !
tageuie. C ’eft ainfi que dans la Grande-Bretagne j
on a mis de plus 'forts.: droits fur les vins de j
France , que fur ceux du Portugal. Les toiles
d’Allemagne peuvent y être importées moyennant
certains droits j mais les toiles de France y font
défendues abfolument. Ces principes ont été imaginés
par-la prévention 8c l’animofité nationale.
Aufli font-ils déraisonnables, même dans la théorie
du fyftême mercantille.
Premièrement, quand il feroit bien sûr que dans
le cas d’un commerce libre entre la France , par
exemple , & l'Angleterre , la balance feroit en
faveur de la France, il ne s’enfuivroit pas qu'un
pareil commerce feroit défavantageux à l'Angleterre
, ou que la balance générale de fon commerce
lui devînt ainfi plus défavantageufe. Si les
vins de France valent mieux 8c coûtent moins
que ceux du Portugal, fi fes toiles font meilleures
& à meilleur marché que celles de l'Allemagne
la Grande - Bretagne trouveroit plus d’avantge à
faire venir des vins 8c des toiles de France , que
des vins de Portugal & des toiles d’Allemagne.
Quoique la valeur des importations annuelles de
la France fe trouvât par-là fort augmentée , celle
du total des exportations diminueroit en proportion
que les marchandifes françoifes de même
qualité feroient moins chères que celles des autres
pays. C ’eft ce qui arriveroit dans la fuppo-
fition même que toutes les marchandifes importées
de la France feroient pour la confommation de la
Grande - Bretagne.
Mais fecondement , l’Angleterre pourroit en
réexporter une grande partie avec bénéfice, elle
pourroit fe procurer en retour peut-être l’équivalent
du premier coût de toutes les marchandifes
françoifes importées. C e qu’on a dit fou-
vent du commerce de l'Inde, pourroit bien fe
trouver vrai de celui que l’Angleterre feroit alors
avec la France : quoique la plus grande partie
des marchandifes des Indes orientales s’achète
avec de l’or & de l’argent, la réexportation ,
qui en fait paffer une partie dans d’autres pays
rapporte plus d or & d’argent à celui qui fait ce
commerce , que le premier achat entier ne lui en
a coûté. Une des principales branches du commerce
hollandois confifte à préfent dans le tranfp.oïc
des marchandifes de France chez d’autres nations.
Une grande partie des vins de France qui fe boivent
dans la Grande-Bretagne même, y font importés
clandeftinement de Hollande & Zélande.
Si les marchandifes françoifes importées en Angleterre
payoient feulement les mêmes droits
que celles des autres pays, pour être rabattues
de même fur l’exportation , l’Angleterre pourroit