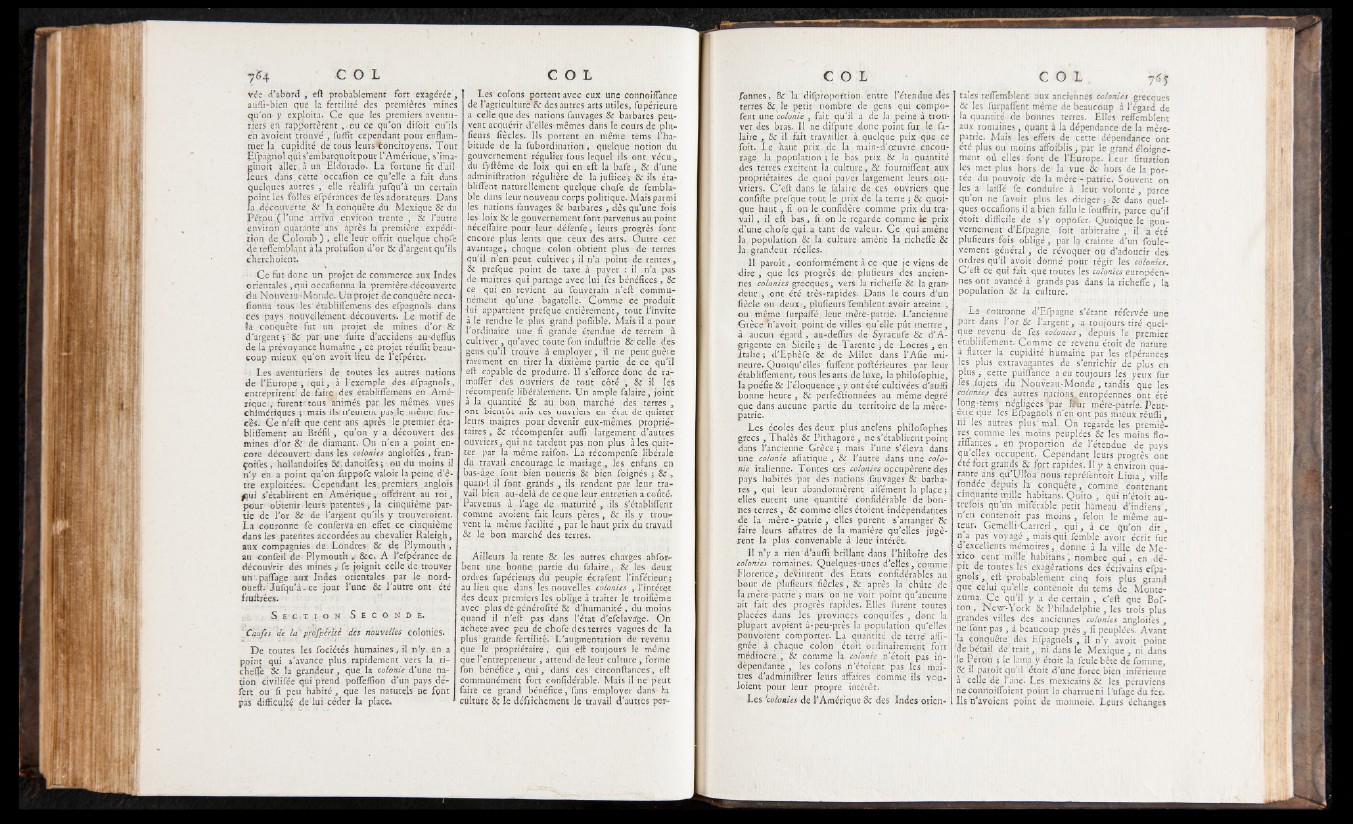
7^4 C O L
vée d’abord , eft probablement fort exagérée,
aufli-bien que la fertilité des premières mines
qu'on- y exploita. C e que les premiers aventuriers
en rapportèrent , ou ce qu’on difoit qu'ils
en avoient trouvé , fuffit cependant pour enflammer
la cupidité de tous leurs^oncitoyens. Tout
Efpagnol quis’embarquoitpour l'Amérique, s’ima-
ginoit aller, à un Eldorado. La fortune fit d’ailleurs
dans, cette ôccafion ce qu'elle a fait dans
quelques autres , elle réalifa jufqu'à un certain
point les folles efpérances de fes adorateurs. Dans
fa découverte. & fa conquête du Mexique & du
Pérou (l'uné arriva environ trente , & l'autre
environ quarante' ans après la première expédition
de Cplomb ) , elle leur offrit quelque chofe
4e rèlTembbnt à la profufîon d'or Si d'argent qu'ils
chei'choient.
C e fut donc un projet de commerce aux Indes
orientales, qui occafionna la première découverte
du Nouveau-Monde. Un projet de conquête occafionna
tous les' é'tabliflemens des efpagnols dans
ces pays nouvellement découverts. Le motif de
là conquête fut un projet de mines d’or &
d'argent ; & par-une fuite d'accidens au-deffiis
de la prévoyance humaine , ce projet réuffit beaucoup
mieux qu'on avoit lieu de l'ejpérer.
-■ Les aventuriers de toutes les autres nations
de l’Europe\ q u i, à l'exemple des efpagnols,,
entreprirent'de faire,;des' établiftemens en Amérique
; furent^ tous animés par les mêmes vues ■
chimériques ; mais ils: n’eurent pasfq même, fuc^-
c ’ès. C e n?eft que cent ans .-après le premier éta*
bliflement au Bréfil, qu’on y a découvert des
mines d’or Si' de diamant. On n’en a point encore
découvert dans les colonies angloifes , fran-
çorfes , hollandoifes Si, danoifes j ou du moins il
n’y en - a point qu’on fupp'ôfe valoir la peine d’ê tre
exploitées. Cependant les, premiers anglois
^ui s’établirent en Amérique, offrirent au ro i,
pour obtenir leurs- patentes, la cinquième partie
de l’or Si de l’argent qu'ils y trouveroient..
La couronne fe conferva en effet ce cinquième
dans les patentes accordées au chevalier Raleigh,
aux compagnies de Londres & dè Plymouth ,
au eonfeil de- Plymouth & c , A l’efpérance de
découvrir des minés ,• fe joignit celle de trouver
un pafîàge aux Indes orientales par le nord-
ouett/'Jufqu’à -c e jour l’une & l’autre ont été
fruftrées.
S e !e x i o N S e c o n d e .
; Caufes de la 4 ■ prospérité des nouvelles colonies.
De toutes les fociétés humaines.3 il n’y, en a
point qui s’avance plus rapidement vers la, ri-
cbe'fle & la grandeur, que la colonie d’une nation
civilifée qui prend pofleffion d’un pays^dé-
fer't ou fi peu habité, que les naturels ne font I
pas difficulté de lui céder la place, *
C O L
Les- colons portent avec eux une connoîflancc
de l’agriculture & des autres arts utiles, fupérieure
a celle que des nations fauvages Si barbares peu*-
vent acquérir d’elles-mêmes dans le cours de plufieurs
fîècies. Ils portent en même tèms l ’har
bitude de la fubordination, quelque notion du
gouvernement régulier fous lequel ils ont vécu>,
du Tyftême de loix qui en eft la bafe , & d’une
adminiftration régulière de la juftice'; & ils éta-
bliffent naturellement quelque chofe de fembla-
ble dans leur nouveau corps politique. Mais parmi
les nations fauvages Si barbares , dès qu’une fois
les loix Si le gouvernement font parvenus au point
néceffaire pour jeur défenfe, leurs progrès font
encore plus lents que ceux des arts.. Outre cet
avantage, chaque colon obtient plus de terres
qu’il n’en peut cultiver ; il n’a point de rentes,
Si prefque point de taxe à payer : il .n’a pas
de maîtres qui partage avec lui fes bénéfices , Si
ce qui en revient au fouverain n’eft communément
qu’ une bagatelle. Comme ce produit
•lui appartient prefque entièrement, tout l’invite
à le rendre le plus grand poffible. Mais il a pour
l’ordinaire une fi grande étendue de terrein à
cultiver , qu’avec toute fon indùftrie & celle des
gens qu’il trouve à employer, il ne peut guère
rarement en tirer la dixième partie de ce qu’il
eft capable de produire. Il s’efforce donc de ra-
maffer des ouvriers, de tout côté , Si il les
récompenfe libéralement. Un ample falaire, joint
à la-quantité) Si au bon marché des terres ,
ont bientôt mis ces ouvriers en état de quitter
leurs maîtres pour devenir eux-mêmes proprietaires
, Si récompenfer aufïî largement d’autres
ouvriers, quLne tardent pas non plus aies quitter
par la même raifon. La récompenfe libérale
du travail encourage le mariage,, les enfans ep
bas-âge. font bien uourris Si bien foignés ; & ,
quand *il font grânds , ils rendent par leur travail
bien au-delà de ce que leur entretien a coûté.
Parvenus à l’age de maturité , ils s’établiften.t
comme avoient fait leurs pères, Si ils y trou**
vent la même facilité , par le haut prix du travail
Si le bon marché des terres.
Ailleurs la, rente & les autres charges abfor-
bent une, bonfte partie du falaire, & les deux
ordres fupérieurs du peuple é.çr^fent l’inférieur;
au lieu que dans* les nouvelles colonies , l’intérêt
des deux premiers les oblige à traiter le troifième
avec plus dè générofité & d’humanité , du moins
quand il n’eft pas dans l’état d’ efclavafge. On
àchete avec peu de chofe des.terres vagues de la
plus grande fertilité-: L'augmentation de revenu
que le propriétaire , qui eft toujours le même
que l’entrepreneur, attend de leur culture , forme
fon bénéfice , qui, dans ces circonftances, eft
communément fort confîdérable. Mais il ne peut
faire ce grand bénéfice,Tans employer dansla
culture Si le défrichement le travail d’autres perc
o L
fonnes, 8i la difpropctition entre l’étendue des
terres & le petit nombre de gens qui cômpo-
fent une colonie , fait qu’il a de la peine à trouver
des bras. Il ne djfpute donc point fur le falaire
, & il fait travailler à. quelque prix que ce
foit. Le haut prix .de la main-d’oeuvre encourage
la population > le bas prix & la quantité
des terres excitent la culture.,. .& fourniffent aux
propriétaires de quoi payer largement leurs ouvriers.
C ’eft dans le falaire de ces ouvriers que
confifte prefque tout le prix de la terre 5 & quoique
hau t, fi on le confidère comme prix du travail
, il eft bas, fi on le regarde comme te prix
d’une chofe .qui-a tant de valeur. C e qui amène
la. population la culture amène la richefîe &
la grandeur réelles.
11 paroît, conformément à ce que je viens de
dire , que les progrès de plufieurs des ancien-,
nés colonies grecques, vers la richefîe Si la grandeur,,
.ont été très-rapides. Dans le cours d’un
fiècle ou deux -, plufieurs Tenablent avoir atteint ,
ou même furpafîe. leur mère-patrie. L’ ancienne
Grèce h ’avoit point de villes qu’elle pût mettre,
à. aucun égard , au-defîîis de Sy.racufe & d’A-
grigente en Sicile ; de Tarente , de Loctes , en
fltalie ; d’Ephèfe & de Milet dans l’Afie mineure.
Quoiqu’elles fufîent poftérieures par leur
établiffement, tous les arts de luxe, la philofophie,
la poéfie & l’ éloquence 9,y. ont été cultivées d’auflï
bonne heure , & perfectionnées au même degré
que dans aucune partie du territoire de la mère-
patrie.
Les écoles des deux plus anciens philofophes
grecs , Thalès Si Pithagore , ne s’établirent point
dans l’ancienne Grèce j mais l’une s’éleva dans
une colonie afiatique , Si l ’autre dans une colonie
italienne. Toutes ces occupèrent des
pays habités par des nations Tapvages & barbares
, qui leur abandonnèrent aifément la place ;
elles eurent une quantité confîdérable dé bonnes
terres , Si commeellès étoîent indépèndantes
de la mère - patrie, elles purent s’arranger Si
faire leurs affaires de la manière qu’elles jugèrent
la plus convenable à leur intérêt.
Il n’ y a rien d’auflx brillant dans, l’hiftoire des
colonies romaines. Quelques-unes d^efles, comme
-Florence, devinrent des Etats confîdérables au
bout de plufieurs fiècles , & après là chute ,de
la mère-patrie ; mais on ne voit point qu’aucune
ait fait des progrès rapides. Elles furent toutes
placées dans les provinces conquifes , dont la
plupart avoient à-peu-près la population qu’elles
pouvaient comporter. La quantité de terre' aflî-
gnée à chaque colon étoit ordinairement fort
médiocre, & comme la colonie n’étoit pas indépendante
, les colons .n'étoient pas les maîtres
d’adminiftrer îeiirs affaires comme ils vou-
loient pour leur propre intérêt.
Les colonies de l’Amérique & des Indes orien-
C O L 76 j
taies reftemblent aux anciennes colonies grecques
Si les furpaflent même de beaucoup à l’égard de
la q u an ci té de bonnes terres. Elles reftemblent
aux romaines, quant à la dépendance de la mère-
patrie. Mais les effets de cette dépendance ont
été plus ou moins affaiblis, par le grand éloignement
où elles font de l’Europe. Leur fîtuation
les met plus hors de la vue & hors de la portée
du pouvoir de la mère - patrie. Souvent on
les a biffé fe conduire à leur volonté, parce
qu’on ne favoic plus les diriger ; & dans quelques
occafions il a bien fallu le fouffrir, parce qu’il
étoit difficile de s’y oppofer. Quoique le gouvernement
d’Efpagne foit arbitraire , il a été
plufieurs fois obligé, par la crainte d’un foule-
vement général , dé révoquer ou d’adoucir des
ordres qu’il avoit donné pour régir les colonies.
C ’eft ce qui fait que toutes les colonies européennes
ont avancé à grands pas dans la richefîe, la
population & la culture.
La ^couronne d’Efpagne s’étant réfervée une
part dans l’or. Si l’argent, a toujours tiré quelque
revenu de fes colonies, depuis le premier
établiffement. Comme ce revenu droit de nature
à flatter la cupidité humaine par les efpérances
les plus extravagantes de s’enrichir de plus en
plus , cette puiflance a eu toujours les yeux fur
fes Sujets du Nouveau-Monde , tandis que les
colonies des autres n a rio ns e u ro pée n n és ont été
long -téms négligées "par Mir mère-parrie. Peut-
etre que les Efpagnols n’ en ont pas mieux réufti,
rii les autres plus' mal. On regarde les premiè-
Tfs comme les moins peuplées1 Si les moins flo-
riffantès , en proportion de l’ étendue de pays
qu’elles occupent. Cependant leurs progrès ont
été fort grands Si fort rapides. Il y â environ quarante
ans qû’Ullba'nous repréfentoit Lima , ville
fondée depuis ,b conquête, comme contenant
cinquante mille habitans. Quito , qui n’étoit autrefois
qu'un miférable petit hàmeaû d’indiens ,
n en contenoit pas moins , félon le même auteur.
Gemelli-Carreri , q u i, à ce qu’on dit ,
n’a pas voyagé , mais qui femble avoir écrit fur
d’excellents mémoires, donne à la ville de M e xico
cent’ mille habitans, nombre q u i, en dépit
de toutes les' exagérations des écrivains efpa-
griols', eft probablement cinq fois plus grand
que celui qu’elle contenoit du te ms de Monte-
zuma. C e qu’il y a de certain , c’eft que Bof-
ton , New-York Si Philadelphie, les trois plus
grandes villes' des anciennes colonies angloifes,
ne font pas , à beaucoup près, fi peuplées. Avant
la conquête' des Efpagnols , il n’y avoit point
bétail de trait,, ni dans le Mexique, ni dans
le Pérou ; le lama y étoit la feule bête de fomme,
Si il paroît qu’il étoit d’une force bien inférieure
à celle dè l’âne. Les mexicains & les péruviens
ne connoilfoient point la charrue ni lufage du fer.
Ils nbvoienî point de monnoie. Leurs échanges