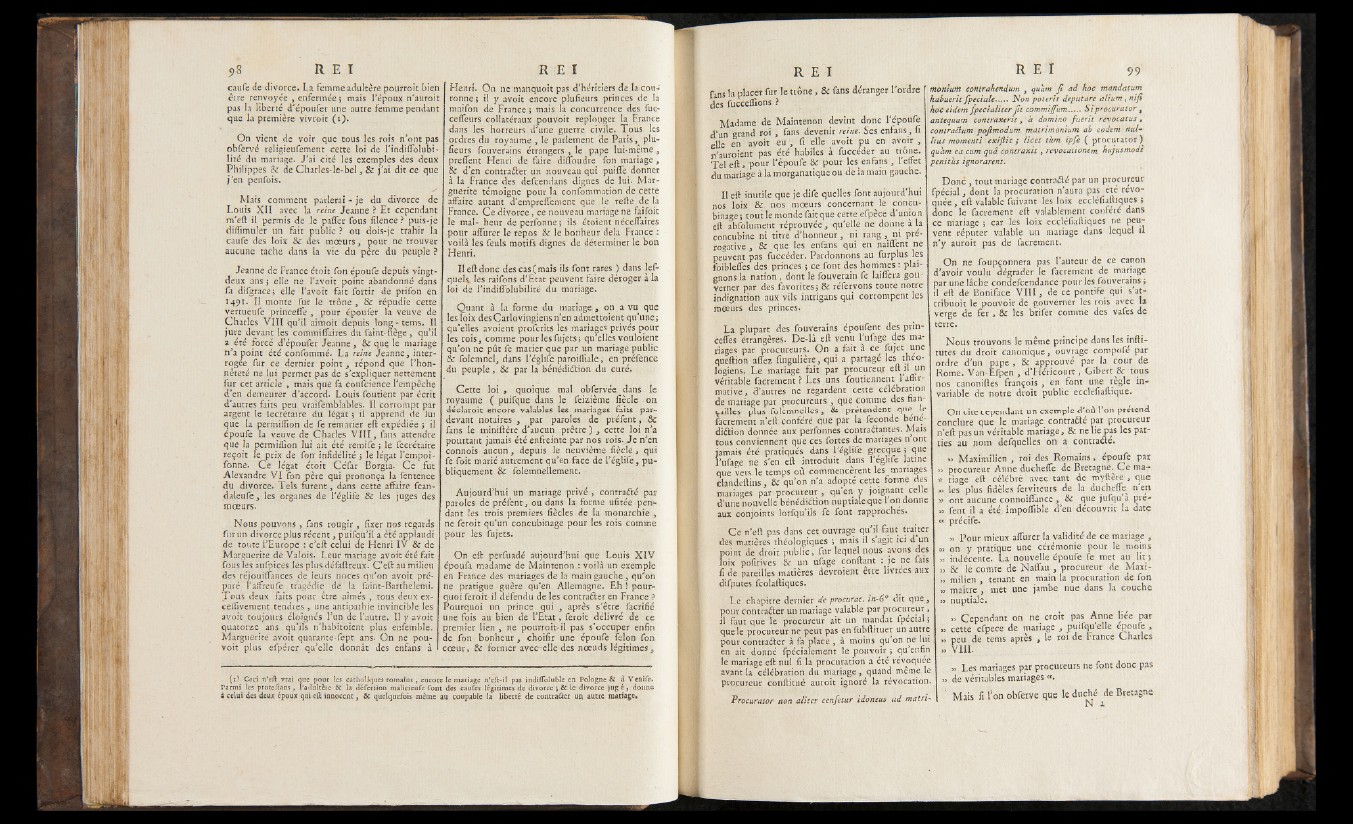
caufe de divorce. La femme adultère pourroit bien
être renvoyée , enfermée 5 mais l’époux n’auroit
pas la liberté d’ époufer une autre femme pendant
que la première vivroit ( i ) .
On vient de voir que tous les rois n’ont pas
obfervé religieufement cette loi de l’indifTolubi-
lité du mariage. J’ai cité les exemples des deux
Philippes 8c de Charles-le-bel , 8c j’ai dit ce que
j'en penfois.
Mais comment parlerai - je du divorce de
Louis X II avec la reine Jeanne ? Et cependant
m’eft il permis de le paffer fous filence? puis-je
diflimuler un fait public ? ou dois-je trahir la
caufe des loix 8c des moeurs , pour ne trouver
aucune tache dans la vie du père du peuple ?
Jeanne de France étoit fon époufe depuis vingt-
deux ans j elle ne- l’ avoit point abandonné dans j
fa difgrace; elle l’avoit fait fortir de prifon en
1491. Il monte fur le trôn e , & répudie ce tte ,
vertueufe princelfe, pour époufer la veuve de
Charles VIII qu’il aimoit depuis long-tems. Il
jure devant les commiffaires du faint-fiège, qu’il j
a été forcé d’époufer Jeanne , & quç le mariage
n’a point été confommé. La reine Jeanne, interrogée
fur ce dernier point, répond que l’honnêteté
ne lui permet pas de s’expliquer nettement
fur cet article , mais que fa confcience l’empêche
d’en demeurer d’accord. Louis foutient par écrit
d’autres faits peu vraifèmblables. Il corrompt par
argent le fecrétaire du légat ; il apprend de lui
que la permiflion de fe remarier eft expédiée } il
époufe la veuve de Charles V I I I , fans attendre
que la permiflion lui ait été remife ; le fecrétaire
reçoit le prix de fon' infidélité 5 le légat l’empoi-
fonne. C e légat étoit Céfar Borgia. C e fut
Alexandre VI fon père qui prononça la fentence
du divorce. Tels furent , dans cette affaire fcan-
daleufe, les organes de l’églife 8c les juges des
moeurs.
Nous pouvons » fans rougir, fixer nos regards
fur un divorce plus récent, puifqu’il a été applaudi
de toute l’Europe : c’eft celui de Henri IV & de
Marguerite de Valois. Leur mariage avoit été fait
fous les aufpiçes les plus défaftreux. C ’ eft au milieu
des réjouiflances de leurs noces qu’on avoit préparé
Faffreufe tragédie dé la faint-Barthelemi.
Tous deux faits pour être aimés , tous deux ex-
ceflîvement tendres , une antipathie invincible les
avoit toujours éloignés l’un de Y autre. 11 y avoit
quatorze ans qu’ils n’hàbitoîent plus enfemble.
Marguerite avoit qüarante-fept ans. On ne pou-
voit plus efpérer qu’elle donnât des enfans à
Henri. On ne manquoit pas d’héritiers de la cou*
ronne ; il y avoit encore plufieurs princes de, la
maifon de France ; mais la concurrence des fuc-
cefleurs collatéraux pouvoit replonger la France
dans les horreurs d’une guerre civile. Tous les
ordres du royaume , le parlement de Paris, plufieurs
fouverains étrangers , le pape lui-même ,
preffent Henri de faire difloudre fon mariage ,
8c d’en contrarier un nouveau qui puiflfe donner
à la France des defcendans dignes de lui. Marguerite
témoigne pour la confommation de cette
affaire autant d’empreffement que le refte delà
France. C e divorce, ce nouveau mariage ne faifoit
le mal- heur de perfonne ; ils étoient néceflaires
pour aflurer le repos 8c le bonheur delà France :
voilà les feuls motifs dignes de déterminer le bon
Henri.
Il eft donc des cas (mais ils font rares ) dans lesquels,
les raifons d’Etat peuvent faire déroger à la
loi de l’indiflblubilité du mariage.
Quant à la forme du mariage, on a vu que
les loix des Carlovingîens n’en admettoient qu’une;
qu’elles avoient profcrits les mariages privés pour
les rois, comme pour les Sujets ; qu’elles vouloient
qu’on ne pût fe marier que par un mariage public
& folemnel, dans l’églife paroifliale, en préfence
du peuple, & par la bénédiction du curé.
Cette loi , quoique mal obfervée dans le
royaume ( puifque dans le Seizième fiècle on
déclaroit encore valables les mariages faits par-
devant notaires , par paroles de préfent, &
fans le miniftère d’aucun prêtre ) , cette loi n’a
pourtant jamais été enfreinte par nos rois.,Je n’en
connois aucun, depuis le neuvième fièclé, qui
fe foit marié autrement qu’ en face de l’églife, publiquement
& folemnellement.
Aujourd’hui un mariage privé , contracté par
paroles de préfent, ou dans la forme ufitée pendant
les trois premiers fiècles de la monarchie ,
ne feroit qu’ un concubinage pour les rois comme
pour les Sujets.
On eft perSuadé aujourd’hui que Louis X IV
époufa madame de Maintenons voilà un exemple
en France dés mariages de la main gauche, qu’on
ne pratigue guère qu’en Allemagne. Eh ! pourquoi
feroit il défendu de les contracter en France ?
Pourquoi un prince qui , après s’être Sacrifié
une fois au bien de l’E ta t, feroit délivré de ce
premier lien , ne pourroit-il pas s’occuper enfin
de fon bonheur, choifir une époufe félon fon
coeur, 8c former avec-elle des noeuds légitimes,
(x ) Ceci n’eft vrai que pour les catholiques roma ins , encore le mariage n’eft-il pas indiiToluble en Pologne & à V e a ife .
Parmi les p ro teftans, î’ailultèie 8c la défertion malicieufe font des caufes légitimes de divorce j 8c le divorce ju g é , donne
à celui des deux époux qui eft in n o c e n t , 8c quelquefois même au coupable la liberté de contracter un autre mariage.
fans la placer fur le trône, & fans déranger l ’ordre
des fucceflions ?
Madame de Maintenon devint donc l’époufe
d’un grand r o i , fans devenir reine. Ses enfans, fi
elle en avoit eu , fi elle avoit - pu en avoir ,
n’aurôient pas été habiles à fuccéder au trône.
Tel eft , pour l'époufe & pour les enfans, l’eftet
du mariage à la morganatique ou de la main gauche.
Il eft inutile que je dife quelles font aujourd'hui
nos loix & nos moeurs concernant le concubinage
i tout le monde fait que cette efpèce d’union
eft abfolument réprouvée, qu’elle ne donne à la
concubine ni titre d’honneur, ni rang , ni prérogative
, & que les enfans qui en naiffent ne
peuvent pas fuccéder. Pardonnons au furplus les
foibleffes des princes ; ce font des hommes : plaignons
la nation, dont le fouverain fe laiffera gou-
verner par des favorites; & réfervons toute notre
indignation aux vils intrigans qui corrompent les
moeurs des princes.
La plupart des fouverains époufent des prin-
cefles étrangères. De-là eft venu l^ufage des mariages
par procureurs. On a fait a ce^ fujet une
queftion affez fingulière, qui a partage les théologiens.
Le mariage fait par procureur eft il un
véritable facrement ? Les uns foutiennent 1 affirmative
, d’autres ne regardent cette célébration
de mariage par procureurs , que comme des fiançailles
monium contrahendum , quant f i ad hoc mandatum
habuerit fpeciale......Non poterit deputare alium, ni fi
hoc eidem fpecialiter fit commijfum.....S i procurât or ,
antequam contraxerit, a domino fuerit revocatus ,
: contrabtum pofimodufn piatrimonium ab eodem nul-
lius momenti exiftit | licet tiim ipfe ( procurator )
quam eu cum quâ contraxit , revocaiionem hujusmodi
penitus ignorarent.
plus folemnelles, & prétendent que le
facrement n’eft conféré que par la fécondé bénédiction
donnée aux perfonnes contractantes. Mais
tous conviennent que ces fortes de mariages n ont
jamais été pratiqués dans l ’egliie grecque ; que
l’ ufage ne s’en eft introduit dans l’églife latine
que vers le temps où commencèrent les mariages
clandeftins, 8c qu’on n’ a adopté cette forme des
mariages par procureur , qu en y joignant celle
d’une nouvelle bénédiction nuptiale que l’on donne
aux conjoints lorfqu’ils fe font rapproches.
C e n’eft pas dans cet ouvrage qui] faut traiter
des matières théologiques ; mais il s agit ici d un
point de droit public, fur lequel nous avons des
loix pofirives 8c un ufage confiant : je ne fais
fi de pareilles matières devroient etre livrées aux
difputes, fcolalliques.
Le chapitre dernier de procurât, in-6Q dit que,
pour contracter un mariage valable par procureur,
il faut que le procureur ait un mandat fpecial ;
que le procureur ne peut pas en fubftituer un autre
pour contracter à fa place, à moins qu’on ne lui
en ait donné fpécialement le pouvoir j cju enfin
le mariage eft nul fi la procuration a été révoquée
avant la célébration du mariage, quand même le
procureur conftitué auroit ignoré la révocation.
Prçcurator non aliter cenfetur idoneus ad matri*
D o n c , tout mariage contracté par un procureur
fpécial, dont la procuration n’aura pas été révoquée
, eft valable fuivant les loix eccléfiaftiques ;
donc le facrement eft valablement conféré dans
ce mariage ; car les loix eccléfiaftiques ne peu-
vent réputer valable un mariage dans lequel il
n’y auroit pas de facrement.
On ne foupçonnera pas l ’auteur de ce canon
d’avoir voulu dégrader Je facrement de mariage
par une lâche condefcendance pour les fouverains ;
il eft de Boniface V I I I , de ce pontife qui s at-
tribuoit le pouvoir de gouverner les rois avec la
verge de f e r , 8c les brifer comme des vafes de
: terre.
Nous trouvons le même principe dans les infti-
tutes du droit canonique, ouvrage compofe par
ordre d’un pape , & approuve par la cour de
Rome. Van-Efpen , d’Héricourt > Gibert 8c tous
nos canoniftes françois , en font une réglé invariable
de notre droit public eccléfiaftique.
On cite cependant un exemple d’où l’on prétend
conclure que le mariage contracté par procureur
n’eft pas un véritable mariage, & ne lie pas les parties
au nom defquelles on a contracte.
» Maximilien , roi des Romains, époufe par
« procureur Anne ducheffe de Bretagne. C e ma-
» liage eft célébré avec tant de myftère , que
„ les plus fidèles fervitëurs de la ducheffe n’en
» ont aucune connoiffance, & que jufqu a press
fent il a été; impoflible d’en découvrir la date
« précife.
ss Pour mieux affurer la validité de ce mariage ,
» on y pratique une cérémonie pour le moins
>s indécente. La nouvelle époufe fe met au lit 5
ss & le comte de Naffau , procureur de Maxi-
ss milien , tenant en main la procuration de fon
ss maître , met une jambe nue dans la couche
ss nuptiale.
ss Cependant on ne croit pas Anne liée par
ss cette efpece de mariage , puifqu elle epoufe ,
s, peu de tems après , le roi de France Charles
s, VIII.
ss Les mariages par procureurs ne font donc pas
ss de véritables mariages «*.
' Mais fi Fon obferve que le duché de Bretagne
N z