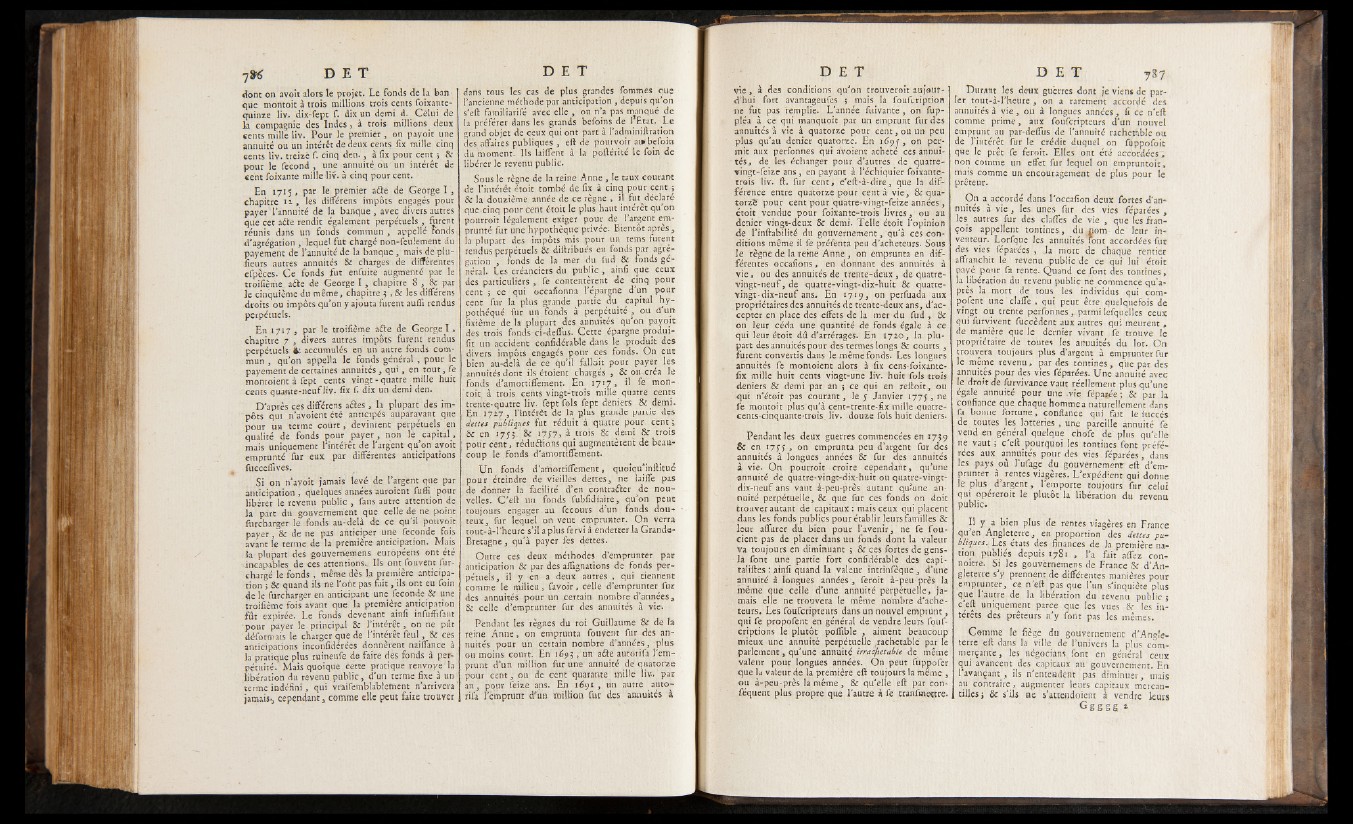
dont on avoit alors le projet. Le fonds de la ban
que montoit d trois millions trois cents foixante-
quinze liv. dix-fepc f. dix un demi d. Celui de
la compagnie des Indes, à trois millions deux
«ents mille liv. Pour le premier, on payoit une
annuité ou un intérêt de deux cents fix mille cinq
eents liv. treize f. cinq den., à fix pour cent ; &
pour le fécond j une annuité ou un intérêt de
cent foixante mille liv. à cinq pour cent.
En 1715 > par le premier aâe de George I ,
chapitre 1 1 , les différens impôts engagés pour
payer l’annuité de la banque, avec divers autres
que cet aéte rendit également perpétuels ^ furent
réunis dans un fonds commun , appellé Tonds,
d’agrégation , lequel fut chargé non-feulement du
payement de l’annuité de la banque , mais de plu-
fieurs autres annuités 8e charges de différentes
efpèces. C e fonds fut enfuite augmenté par le
troifième.. aéle de George I , chapitre S , & par
le cinquième du même, chapitre ; , & les différens
droits ou impôts qu’on y ajouta furent auffi rendus
perpétuels.
En 1 7 1 7 , p ar le troilîème afle de G e o rg e I ,
chapitre 7 , divers autres impôts furent rendus
perpétuels & accumulés en un autre fonds commun
, qu’on appella le fonds général , pour le
payement de certaines annuités , q u i, en tout, fe
montoient à fept cents vingt - quatre mille huit
• cents quante-neufliv, fix f. dix un demi den.
D'après ces différens a&es, U plupart des impôts
qui n’ avoient été anticipés auparavant que
pour un terme cou r t, devinrent perpétuels en
qualité de fonds pour payer, non le^capital,
mais uniquement l’intérêt de l’argent qu’on avoit
emprunté fur eux par différentes anticipations
fucceffives.
Si on n’avoit jamais levé de l’argent que par
anticipation , quelques années auroient fuffi pour
libérer le revenu public , fans autre attention de
la part du gouvernement que celle de ne point
furcharger le fonds au-delà de ce qu’il pouvoit
payer, Se de ne pas anticiper une fécondé fois
avant le terme, de la première anticipation. Mais
la plupart des gouvernemens européens ont été
incapables de ces attentions. Ils ont fouvent fur-
chargé le fonds , même dès la première anticipation
; & quand ils ne l’ofit pas fait, ils ont eu foin
de le furcharger en anticipant une fécondé & une
troifième fois avant que. la première anticipation
fdt expirée. Le fonds devenant^ ajnfi infuffifant
pour payer le principal & l’intérêt, on ne pdt
déformais le charger que de l’ intérêt feul, 8e ces
anticipations inconfidérées donnèrent naiffance à
la pratique plus ruineufe de faire des fonds à per-L
péruité. Mais quoique cette pratique renvoyé'la
libération du revenu.public, d'un terme fixe à un-
terme indéfini, qui vraifemblàblement n’arrivera’
jamais-, cependant, comme elle peut faire trouver
dans tous les cas de plus grandes Tommes eue
l’ancienne méthode par anticipation , depuis qu’ on
s’eft familiarifé avec elle , on n’a pas naanqué de
la préférer dans les grands befoins de I Etat. Le
grand objet de ceux qui ont part à l’adminiftration
des affaires publiques , eft de pourvoir ai*befoin
du moment. Ils lailfent à la poftérité le foin de
libérer le revenu public.
Sous le règne de la reine Anne , le taux courant
de l’intérêt étoit tombé de fix à cinq pour cent ;
& la douzième année de ce règne , il fut déclaré
que cinq pourcent étoit le plus haut interet qu on
pourroit légalement exiger pour de l’argent emprunté
fur une hypothèque privée. Bientôt apres,
la plupart des impôts mis pour un tems furent
rendus perpétuels & diffribués en fonds par agrégation
, fonds de la mer du lud & fonds général.
Les créanciers du public, ainfi que ceux
des particuliers , fe contentèrent de cinq pour
cent j ce qui occafionna l’épargne d un pour
cent fur la plus grande partie du capital hypothéqué
fur un fonds à perpétuité , ou d un
frxième de la plupart des annuités qu on payoit
des trois fonds ci-deffus. Cette épargne produi-
fit un accident cojifidérable dans le produit des
divers impôts engagés pour ces fonds. On eut
bien au-delà de ce qu’il falloir pour payer les
annuités dont ils étoient chargés , & on créa le
fonds d’amortifTement. En 1717 , il fe mon-
| toit, à trois cents vingt-trois mille quatre cents
trente-quatre liv- fept fols fept deniers & demi.
En . 17 2 7 , l’intérêt de la plus grande partie des
dettes publiques fut réduit à quatre pour cent >
bc en 1753 & 1757» à trois & demi & trois
pour cent, rédu&ions qui augmentèrent de beaucoup
le fonds d’àmortiflêment.
Un fonds d’amortiflement , quoiqu’ inftitué
pour éteindre de vieilles dettes, ne laiffe pas
de donner la facilité d’ en contra&er de nouvelles.
C ’ eft im fonds fubfidtaire, qu’on peut
toujours engager au fecours d’un fonds douteux,
fur lequel on veut eippruwter. On verra
tout-à-l’heure s’il a plus fervi -à endetter la Grande-
Bretagne, qu’à payer fes dettes.
Outre ces deux méthodes d’emprunter par
anticipation & par des afïignations de fonds perpétuels,
il y en a deux autres , qui tiennent
comme le milieu, favoir, celle d’emprunter fur
des annuités pour un certain nombre d’années y
& celle d’ emprunter fur des annuités à vie^
Pendant les règnes du roi Guillaume & de ht
reine Anne, on emprunta fouvent fur des annuités
pour un certain nombre d’années, plus
ou moins court. En 1693, un aéle autorifa l'emprunt
d’un million fur une' annuité de quatorze
pour cent, ou de cent quarante mille liv. par
an, pour feize ans. En 16 9 1 , un autre autorifa
l’emprunt d'un million fur des annuités à
v ie > à des conditions qu’ on trouveroit aujourd’hui
fort avantageufes > mais la foufcription
ne fut pas remplie. L ’année fuivante, on fup-
pléa à ce qui manquoic par un emprunt fur des
annuités'à vie à quatorze pour cent, ou un peu
plus qu’au denier quatorze. En 1695, on permit
aux perfonnes qui àvoienc acheté ces annuités
, de les échanger pour d’autres de quatre-
vingt-feize ans, en payant à l’échiquier foîxante-
trois liv. ft. fur cent, c’eft-à-dire, que la différence
entre quatorze pour cent à v ie , & quatorze
pour cent pour quatre-vingt-feize années,
étoit vendue pour foixante-trois livres, ou au
denier vingt-deux & demi. Telle étoit l’opinion
de l’inftabilité du gouvernement, qu’à ces conditions
même il fe préfenta peu d’acheteurs. Sous
le règne de la reine Anne, on emprunta en différentes
occafions, en donnant des annuités à
v ie , ou des annuités de trente-deux, de quatre-
vingt-neuf, de quatre-vingt-dix-huit & quatre-
vingt-dix-neuf ans. En 17 19 , on perfuada aux
propriétaires des annuités de trente-deux ans, d’accepter
en place des effets de la mer du fud , &
on leur céda une quantité de fonds égale à ce
qui leur étoit dû d’arrérages. En 1720, la plupart
des annuités pour des termes longs & courts ,
furent convertis dans le même fonds. Les longues
annuités fe montoient alors à fix cens-foixante-
fix mille huit cents vingt-une liv. huit fols trois
deniers & demi par an 5 ce qui en reftoit, ou
qui n’étoit pas courant, le y Janvier i7 7 y ,n e
fe montoit plus qu’à cent-trente-fix mille quatre-
eents-cinquante-treisjiv. douze fols huit deniers.
Pendant les deux guerres commencées en 1739
& en 1-7y y , on emprunta peu d’argent fur des
annuités, à longues années & fur des annuités
à vie. On pourroit croire cependant, qu’une
annuité de quatre-vingt-dix-huit ou quatre-vingt-
dix-neuf ans vaut à-peu-près autant qu’une annuité
perpétuelle, & que fur ces fonds on doit
trouver autant de capitaux : mais ceux qui placent
dans les fonds publics pour établir leurs familles &
leur affurer du bien pour l’avenir, ne fe fou-
cient pas de placer dans un fonds dont la valeur
va toujours en diminuant î & ces fortes de gens-
là font une partie fort confîdérable des capi-
taliftes : ainiî quand la valeur intrinfèque, d’une
annuité à longues annéès , feroit à-peu près la
même que celle d’une annuité perpétuelle, jamais
elle ne trouvera le même nombre d’ acheteurs.
Les foufcripteurs dans un nouvel emprunt,
qui fe propofent en général de vendre leurs fouf-
criptions le plutôt poflîble , aiment beaucoup
mieux une annuité perpétuelle ^achetable par le
parlement, qu’une annuité irracjietable de même
valeur pour longues années. On peut fuppofer
que la valeur de la première eft toujours la meme ,
ou à-peu-près la même, & qu’elle eft par con-
féquent plus propre que l'autre à fe tranfaiettre.
Durant les deux guerres dont je viens de parler
tout-à-l’heure, on a rarement accordé des
annuités à v ie , ou à longues années, ü ce n’eft
comme prime, aux foufcripteurs d’un nouvel
emprunt au par-deflus de l’annuité rachetàbîe ou
de 1: ’intérêt fur le crédit duquel on fuppofoit
que le prêt fe feroit. Elles ont été accordées ;
non comme un effet fur lequel on empruntoit,
mais comme un encouragement de plus pour le
prêteur.
On a accordé dans l ’occafion deux fortes d'annuités
à v ie , les unes fur des vies réparées ,
les autres fur des clafles de vie , que les fran-
çois appellent tontines, du «om- de leur inventeur.
Lorfque Jes annuités fo n t accordées fur
des vies feparées , Ja mort de chaque rentier
affranchit le revenu public de ce qui lui étoit
paye pour fa rente. Quand ce font des tontines,
la libération du revenu public ne commence qu’a-
près la.mort de tous les individus qui comp
te n t une clafle , qui peut être quelquefois de
vingt ou trente perfonnes , parmi lefquelles ceux
qui furvivent fuccèdent aux autres qui meurent ,
de manière que le dernier vivant fe trouve le
propriétaire de toutes les annuités du lot. On
trouvera toujours plus d’argent à emprunter fur
le même revenu, par des tontines, que par des
annuités pour des vies réparées. Une annuité avec
ip droit de furvivance vaut réellement plus qu’une
égale annuité pour une .vie fépa*ée ; & par la
confiance que chaque hommea naturellement dans
fa bonne fortune, confiance qui fait le fticcès
de toutes les lotteries , une pareille annuité fe
vend en général quelque chofe de plus qu'elle
ne vaut i c'eil pourquoi les tontines font préférées
aux annuités pour des vies féparées, dans
les pays où I’ufage du gouvernement eft d’emprunter
à rentes viagères. L’expédient qui donne
le plus _ d’argent, l’emporte toujours fur celui
qui opéreroit le plutôt la libération du revenu
public.
II y a bien plus de rentes viagères en France
qu’en Angleterre, en proportion des dettes publiques.
Les états des finances de ia première nation
publiés depuis 1781 , l’a fait aflez con-
noître. Si les gouvernemens de France & d’Angleterre
s’y prennent île différentes manières pour
emprunter, ce n’eft pas que l’un s’inquiète plus
que l'autre de la libération du revenu public ;
c’eft uniquement parce que les vues & les intérêts
des prêteurs n’y font pas les mêmes.
Comme le fiège du gouvernement d’Angleterre
eft dans la ville de l’univers la plus commerçante,
les négocians font en général ceux
qui avancent des capitaux au gouvernement. En
l’avançant , ils n’entesdent pas diminuer, mais
au contraire , augmenter leurs capitaux mercan-
tiftes ; Se s’ils ne s’attendoient à vendre leurs
Gg g g g z