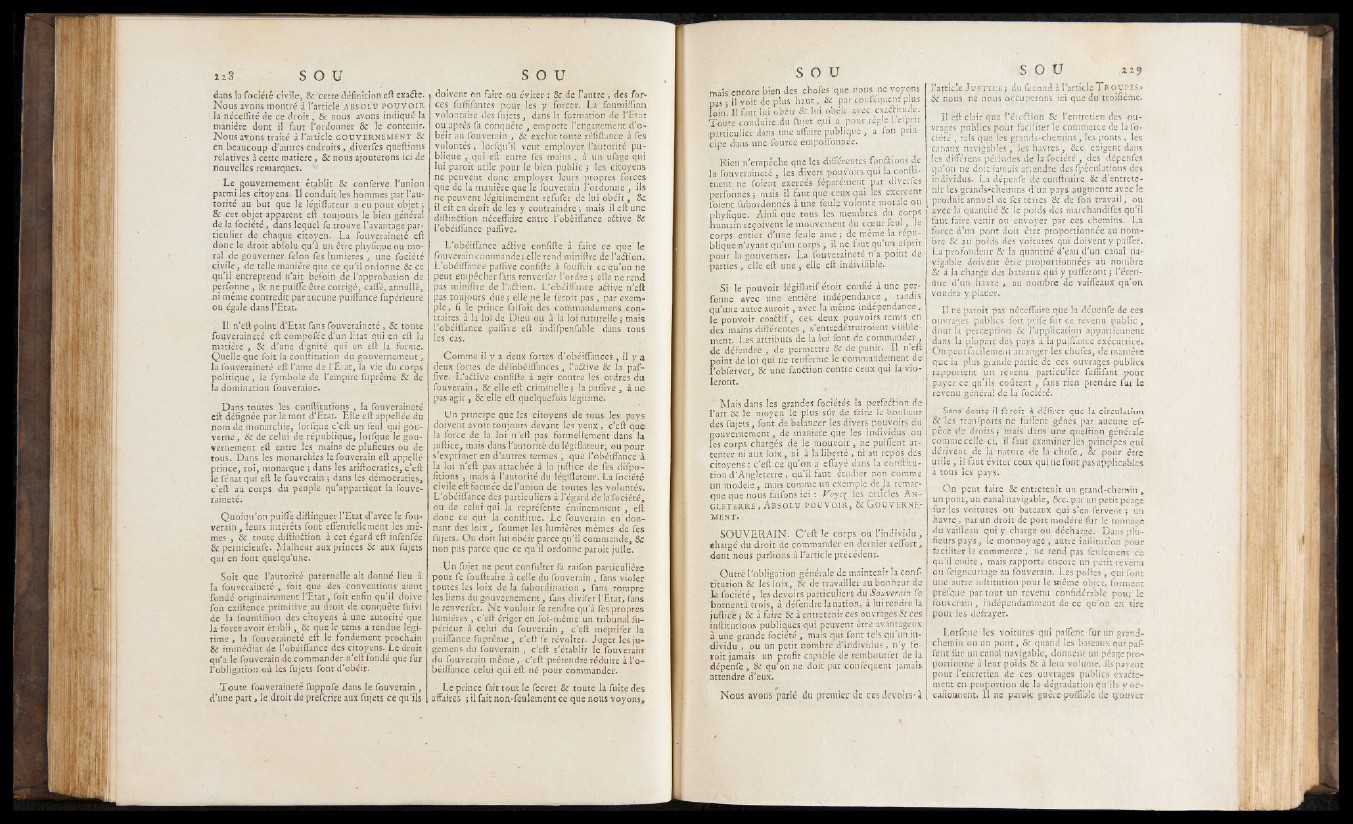
dans la fociété civile, & 'cette définition eft exa&e.
Nous avons montré à l'article absolu p ou vo ir
la néceffité de ce droit, Se nous avons indiqué la
manière dont il faut l’ordonner 8c le contenir.
Nous ayons traité à l’article gouvernement &
en beaucoup d’autres endroits, .diverfes queftions
relatives à cette matière, Se nous ajouterons ici de
nouvelles remarques.
Le gouvernement établit & conferve l’union
parmi les citoyens. 11 conduit les hommes par l’autorité
au but que le législateur a eu pour, objet 5
& cet objet apparent eft toujours le bien général
de la fociété, dans lequel fe trouve l’avantage particulier
de chaque citoyen. La Souveraineté eft
donc le droit abfolu qu’ à un être phyfique ou moral
de gouverner félon fes lumières , une fociété
civile, de telle manière que ce qu’il ordonne & ce
qu’il entreprend n’ait befoin de l’approbation de
perfonne, & ne puifle être corrigé, cafle, annullé,
ni même contredit par aucunepuifîance Supérieure
ou égale dans l’Etat.
Il n’eft point d’Etat fans Souveraineté , & toute
fouveraineté eft compofée d’ un Etat qui en eft la
matière , & d’une dignité qui en eft la forme.
Quelle que Soit la conftitution du gouvernement,
la fouveraineté eft l’ame de l’Eiat, la vie du corps
politique, le Symbole de l’empire Suprême 8c de
la domination Souveraine.
Dans toutes les conftitutions , la Souveraineté
eft défignée par le mot d’Etat. Elle eft appellée du
nom de monarchie, lorfque c’eft un feul qui gouverne
, & de celui de république, lorfque le gouvernement
eft entre les mains de plufieurs ou de
tous. Dans les monarchies le Souverain eft appellé
prince, roi, monarque ; dans les ariftocraties, c’eft
le Sénat qui eft le Souverain ; dans les démocraties,
c’eft au corps du peuple qu’ appartient la Souveraineté.
Quoiqu’on puifle diftinguer l’Etat d’avec le Souverain,
leurs intérêts Sont essentiellement les mêmes
, 8c toute diftinCtion à cet égard eft infenfée
& pernicieufe. Malheur aux princes & aux Sujets 1
qui en font quelqu’une.
Soit que l’autorité paternelle ait donné lieu à
la fouveraineté , foit que des conventions’ aient
fondé originairement l ’Etat, Soit enfin qu’il doive
fon exiftence primitive au droit de conquête Suivi
de la foumiffion des citoyens à une autorité que
la force avoir é t a b l i& que le tems a rendue légitime
, la fouveraineté eft le fondement prochain
& immédiat de l’obéiffance des citoyens. Le droit
qu’ a le fouverain de commander n’eft fondé que fur
l’obligation où les Sujets Sont d’obéir.
Toute Souveraineté SuppoSe dans le Souverain ,
d’une part, le droit de prescrire aux Sujets ce qu'ils
1 doivent on faire ou éviter : 8c de f’aiitre , des forces
Suffisantes pour les y forcer. La Sot1miffio.11
volontaire des Sujets, dans la formation de l’Etat
ou après Sa conquête , emporte l’engagement d’obéir
au Souverain , 8c exclut toute réfiftance à Se s
volontés, iorSqu’il veut employer l’autorité publique
, qui eft entre Ses mains , à un- ufage qui
lui paroît utile pour le bien public 5 les citoyens
ne peuvent donc employer leurs propres forces
que de la manière que le Souverain l ’ordonne , ils
ne peuvent légitimement refufer de lui obéir, 8c.
il eft en droit de'les y contraindre; mais il eft une
diftinéfcion nécefîaire entre l’obéiflance aCtive 8c
l ’obéiftance paffive.
L’obéiflance aâive confifte à faire ce que le
fouverain commande; elle rend miniftre de I’aCtion.
L’obéiffance paffive confifte à fouffrir ce qu’on ne
peut empêcher Sans renverfer l’ordre ; elle ne rend
pas miniftre de l’aftion. L’obéiffance aétive n’eft
pas toujours due; elle neJe feroit pas , par exemple,
fi le prince faifoit des commandemens contraires
à la loi de Dieu ou à la loi naturelle ; mais
l’obéiflance paffive eft indifpenfable dans tous
les cas.
Comme il y a deux fortes d’ obéiflances , il y a
deux fortes de défobéiffances, l’aétive 8c la paf-
. fîve. L’ aétive confifte à agir contre les ordres du
Souverain, & elle eft criminelle ; la paffive, à ne
pas a gir, &.elle eft quelquefois légitime.
Un principe que les citoyens de tous les pays
doivent avoir toujours devant les yeux, c’eft que
la force de la loi n’eft pas formellement dans la
juftice, mais dans l’ autorité dü lëgiflateur, ou pour
s’exprimer en d’autres termes , que l’obéiflance à
la loi n’eft pas attachée à la juftice de fes ai'fpo-
fitions , mais à l’autorité du législateur. La fociété
civile eft formée de l’union de toutes les 'volontés.
L’obéiflance des particuliers à l’égard de la'fociété,
ou de celui qui- la repréfehte éminemment , eft
donc ce qui la conftitué. Le fouverain en donnant
des lo ix , foumet les lumières mêmes de Ses
fujets. On doit lui obéir parce qu’ il commande, &
non pas parce que ce qu’il ordonne paroît juite.
-Un fujet ne peut confulter fa raifon particulière
pour fe Souftraire à celle du fouverain , fans violer
toutes les loix de la fub ordination , fans rompre
les liens du gouvernement, fans divifer l ’Etat, fans
le renverfer. Ne vouloir fe rendre qu’à fes propres
lumières , c ’eft ériger en foi-même un tribunal fu-
périeur à celui du fouverain , c’eft méprifer la
puiflance fuprême, c’eft fe révolter. Juger lesju-
gemens du fouverain , c’eft s’établir le fouverain
du fouverain même, c’eft prétendre réduire à l’o-
béiflance celui qui eft né pour commander.
Le prince fait tout le fecret 8c toute là fuite des
affaires 5 il fait non-feulement ce que nous voyons,
mais encore bien des chofes ’que nous né voyons
pas 5 il voit de plus haut, & par conséquent! plus
loin. Il faut lui obéir & lui otîéir avec exactitude.
Toute conduite .du füjet qui a pour règle l'efprit
particulier dans une affaire publique , a fon prin-
Rien n’empêche que les différentes fonctions de
la fouveraineté , les divers pouvoirs qui la c.onfti-
tuent ne foient exercés féparçment par diverfes
perfonnes ; mais il faut que ceux qui les exercent
foient fubordonnés à une feule volonté morale ou
phyfique. Ainfi que tous les membres du Corps
humain reçoivent le mouvement du coeur feul-, le
corps entier d’une feuje a me ; de même la république
n’ayant qu’un corps , il nç faut qu’ un efprit
pour la gouverner. La fouveraineté n’ a point de'
parties , elle eft une , elle eft indivifible.
Si le pouvoir légiflatif étoit confié à une perfonne
avec une entière indépendance , tandis
qu’ une autre auroit, avec la même indépendance/
le pouvoir coa&if, ces deux pouvoirs remis en
des mains différentes , s’enttedétruiroient vilible-
ment. Les attributs de la loi font de commander ,
de défendre , de permettre 8c de punir. Il n eft
point de loi qui ne renferme le commandement de
fobferver, 8c une fan&ion contre ceux qui la violeront.
Mais dans les grandes fociétés la .perfection de
l’art & le moyen le plus sûr de faire le bonheur
des fujets, font de balancer les divers pouvoirs du
gouvernement, de maniéré que les individus ou
les corps chargés de le mouvoir, ne puiflent attenter
ni aux loix’, ni à la liberté , ni au repos des
citoyens : c’ eft ce qu’on a effayé dans la cbnftitu-
tion d’Angleterre , qu’il faut étudier non comme
un modeie, mais comme un exemple de^a remarque
que nous faifons ici : Voye{ les articles A ngleterre
, A bsolu p o u v o ir , & G ouv ernement.
SO U V E R A IN . C ’eft le corps ou l’individu,
chargé du droit de commander en dernier reflort,
dont nous parlions à l’article précédent.
Outre l ’obligation générale de maintenir la conftitution
& les loix, & de travailler au bonheur de
k fociété, les devoirs particuliers du Souverain fe
bornentà trois, à défendre la nation, à lui rendre la
jufticé ; 8c à faire & à entretenir ces ouvrages 8c ce s
inftitutions publiques qui peuvent être avantageux
à une grande fociété , mais qui font tels qu’un individu
, ou un petit nombre d’individus, n’y fe-
roit jamais un profit capable de rembourfer de la
dépenfe, & qu’on ne doit par conféquent jamais
attendre d’eux.
Nous avons parlé du premier de ces devoirs-à
l’article Ju stice y.du, fécond à l’article T f oupes*
& nous ne nous occuperons ici que du troifième.
Il eft clair que l’éieCtion & l’entretien des ouvrages
publics pour faciliter le commerce de la fociété
, tels que les grands-chemins, les ponts, les
canaux navigables , les havres , 8cc. exigent dans
les différent périodes de la fociété , des dépenfes
qïi’on ne doit jamais attendre des fpéculations des
individus. La dépenfe de conftiuire 8c d’entretenir
les grands-chemins d’un pays augmente avec le
produit annuel de fes terres 8c de fon travail, ou
avec la quantité 8c le poids des marchandées qu’il
faut faire venir ou envoyer par ces chemins. La
force d’un pont doit être proportionnée au nombre
8c au poids des voitures qui doivent y pafler.
La profondeur & la quantité d’eau d’un canal navigable
doivent être proportionnées au nombre
& à la charge des bateaux qui y pafferont ; l’étendue
d’un havre , au nombre de vaiffeàux qu’on
voudra y pla'cev.
Il ne paroît pas nécefîaire que la dépenfe de ces
ouvrages publics foit prife fur ce revenu public ,
dont la perception 8c l’application appartiennent
dans la plupart des pays à la puiflance exécutrice.
On peut facilement arranger les chofes, de manière
que la plus grande partie dé ces ouvrages publics
rapportent un revenu particulier fuffifant pour
.payer ce qu’ ils coûtent , fans rien prendre fur le
revenu général de la fociété.
Sans doute il feroit à délirer que la circulation
& les tranfports ne fuflent gênés, par aucune ef-
pèce de droits j niais dans une queftion générale
comme celle-ci, il faut examiner les principes qui
dérivent de la nature de la chofe, & pour être
utile, il faut éviter ceux qui ne font pas applicables
à tous les pays. -,
On peut taire & entretenir un grand-chemin ,
un pont, un canal navigable, &e. par un petit péage
fur les voitures ou bateaux qui s’en fervent ; un
havre, par un droit de port modéré fur le tonnage
du vaifleau qui y charge ou décharge. Dans plufieurs
pays, le mon noyage ^ autre inflitution pour
faciliter le commerce , ne rend pas feulement ce
qu’il coûte, mais rapporte encore un petit revenu
ou feigneuriage au fouverain. Les poftes, qui font
une autre inltitution pour le même objet, forment
prëfque par tout un revenu confidérable pour le
fouverain, indépendamment de ce qu’on en tire
pour les défrayer.
Lorfque les voitures qui paflent fur un grand-
chemin ou un pont, 8c quand les bateaux qui pafi
fent fur un canal navigable, donnent un péage proportionné
à leur poids & à leur volume, ils payent
pour l’entretien de ces ouvrages publics exactement
en proportion de la dégradation qu’ils y oc-
cafioanent. Il ne parok guère poffibîe de trouvée