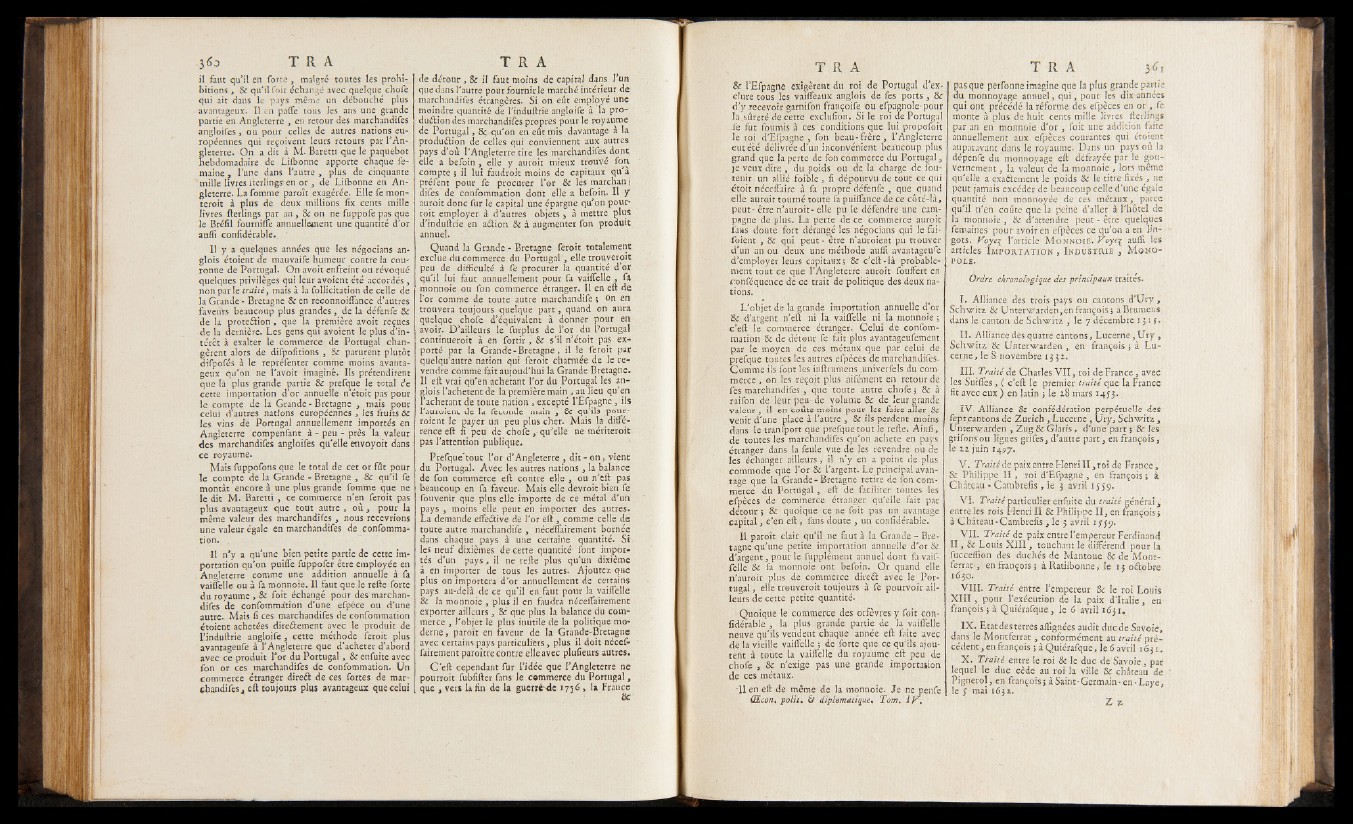
il faut qu’ il en forte , malgré toutes les prohibitions
, & qu’il foit échangé avec quelque chofe
qui ait dans le pays même un débouché plus
avantageux. Il en paffe tous les ans une grande
partie en Angleterre , en retour des marchandifes
angloifes, ou pour celles de autres nations européennes
qui reçoivent leurs retours par T A n gleterre.
On a dit à M. Baretti que le paquebot
hebdomadaire de Lifbonne apporte chaque fe-
maine, l ’une dans l’autre , plus de cinquante
mille livres fterlings*- en or 3 de Lifbonne en Angleterre.
La fomme paroît exagérée. Elle fe mon-
teroit à plus de deux millions fix cents mille
livres fterlings par an 3 8c on ne fuppofe pas que
le Bréfîl fourniffe annuellement une quantité d’ or
aufli coniidérable.
Il y a quelques années que les négocians an-
glois étoient de mauvaife humeur contre la cou*
ronne de Portugal. On avoir enfreint ou révoqué
quelques privilèges qui leur avoient été accordés 3
non parle traité3 mais à la follicitation de celle de
la Grande - Bretagne & en reconnoiffance d’autres
faveurs beaucoup plus grandes, de la défenfe &
de la protection, que la première avoit reçues
de la dernière. Les gens qui avoient le plus d'intérêt
à exalter le commerce de Portugal changèrent
alors de difpofitions 3 Sz parurent plutôt
drfpofés à le repréfenter comme moins avantageux
qu'on ne l’avoit imaginé. Ils prétendirent
que là plus grande partie & prefque le total de
cette importation d’or annuelle n'étoit pas pour
le compte de la Grande - Bretagne 3 mais pour
celui d'autres nations européennes , les fruits &
les vins de Portugal annuellement importés en
Angleterre compenfant à - peu - près la valeur
des marchandifes angloifes qu’elle envoyoit dans
ce royaume.
Mais fuppofons que le total de cet or fût pour
le compte de la Grande - Bretagne , & qu'il fe
montât encore à une plus grande fomme que ne
le dit M. Baretti, ce commerce n'en feroit pas
plus avantageux que tout autre , où 3 pour la
même valeur des marchandifes , nous recevrions
une valeur égale en marchandifes de çonfomma-
tion. .
Il n’y a qu’une bien petite partie de cette importation
qu’on puiffe fuppofer être employée en
Angleterre comme une addition annuelle à fa
vaiffelle ou à fa monnoie. Il faut que le refte forte
du royaume, & foit échangé pour des marchandifes
de çonfommàtion d’une efpèce ou d’une
autre. Mais fi ces marchandifes de çonfommàtion
étoient achetées dire&ement avec le produit de
l’induftrie angloife, cette, méthode feroit plus
avantageufe à l’Angleterre que d'acheter d'abord
avec ce produit l’or du Portugal, & enfuite avec
fon or ces marchandifes de çonfommàtion. Un
commerce étranger direéfc de ces fortes de marchandifes
eft toujours plus avantageux que celui
de détour , 8c il faut moins de capital dans l ’un
que dans l’autre pour fournir le marché intérieur de
marchandifes étrangères. Si on eût employé une
moindre quantité de l'induftrie angloife à la production
des marchandifes propres pour le royaume
de Portugal, Sç-qu’on en eût mis davantage à la
production de celles qui conviennent aux autres
pays d’où l ’Angleterre tire les marchandifes dont
elle a befoin , elle y auroit mieux trouvé fon
compte ; il lui faudroit moins de capitaux qu'à
préfent pour fe procurer l’or & les marchant
difes de çonfommàtion dont elle a befoin. Il y
auroit donc fur le capital une épargne qu’on pour-
roit employer à d ’autres objets > à mettre plus
d’induftrie en aCtion 8c à augmenter fon produit
annuel. -
Quand la Grande - Bretagne feroit totalement
exclue du commerce du Portugal , elle trouveroit
peu de difficulté à fe procurer la quantité d oy
qu'il lui faut annuellement pour fa vaiffelle , fa
monnoie ou fon commerce étranger. Il en eft de
l’or comme de toute autre marchandife ; on en
trouvera toujours quelque part, quand on aura
quelque chofe d'équivalent à donner pour en
avoir. D'ailleurs le furplus de l’or du Portugal
continueroit à en f o r t i r & s’il n'étoit pas exporté
par la Grande-Bretagne, il le feroit par
quelqu'autre nation qui feroit charmée de le revendre
comme fait aujoud'hui la Grande Bretagne.
Il eft vrai qu’ en achetant l’or du Portugal les an-
glois l’achetent de la première main , au lieu qu'en
l’achetant de toute nation , excepté l'Efpagne, ils
l’auroienc de la fécondé main , 8c qu’ils pour-
roient le payer un peu plus cher. Mais la différence
eft fi peu de ch o fe ,- qu'elle ne mériteroit
pas l’attention publique.
Prefque’ tout l’or d'Angleterre , dit - o n , vient
du Portugal. Avec les autres nations , la balance
de fon commerce eft contre elle , ou n'tft pas
beaucoup en fa faveur. Mais elle devrait bien fe
fouvenir que plus elle importe de ce métal d'un
pays , moins elle peut en importer des autres.
La demande effective de l'or e f t , comme celle de
toute autre marchandife , nécéffairement bornée
dans chaque pays à une certaine quantité. Si
les neuf dixièmes de cette quantité1 font importés
d’ un pays, il ne refte plus qu*ûn dixième
à en importer de tous les autres. Ajoutez que
plus on importera d'or annuellement de certains
pays au-delà de ce qu'il en faut pour la vaiffelle
8c la monnoie , plus il en faudra néceffairement
exporter ailleurs , 8c que plus la balance du commerce
, J'objet le plus inutile de la politique moderne,
paroît en faveur de la Grande-Bretagne
avec certains pays particuliers, plus il doit nécef»
fairement paroître contre elle avec plufîeurs autres.
C ’eft cependant fur l'idée que l’Angleterre ne
pourroit fubfifter fans le commerce du Portugal,
que , vers la fin de la g u c r r^ c 175^ > la France
& l’Efpagne exigèrent du roi de Portugal d’exclure
tous les vaiffeaux anglois de fes ports, &
d'y recevoir garnifon françoife ou efpagnole- pour
la sûreté de cette exclufion. Si le roi de Portugal
-fe fut fournis à ces conditions que lui propofoit
le roi d'Efpagne , fon beau-frère, l ’Angleterre
eut été délivrée d'un inconvénient beaucoup plus
grand que la perte de fon commerce du Portugal,
je veux dire , du. poids ou de la charge de fou-
tenir. un allié foible , fi dépourvu de tout ce qui
étoit néceffaire à fa propre défenfe , que quand
elle aurait tourné toute fa puiffance de ce côté-là,
peut - être n’auroit- elle pu le défendre une campagne
de plus. La perte de ce commerce auroit
faas doute fort dérangé les négocians qui le fai-
-foient 3 8c qui peut - être n'auroient pu trouver
d’un an ou deux une méthode aufli avantageuse
d’employer leurs capitaux; 8c c'eft-là probablement
tout ce que l'Angleterre auroit fouffert en
conféquence de ce trait de politique des deux nations.
L ’objet de la grande importation annuelle d’or
& d’argent n’eft ni la vaiffelle ni la monnoie ;
c'eft le commerce étranger. Celui de confom-
mation 8c de détour fe fait plus avantageufement
par le moyen de ces métaux que par celui de
prefque toutes les autres efpèces de marchandifes.
Comme ils font les inftrumens amiverfels du commerce
, on les reçoit plus aifément en retour de
fes marchandifes , que toute autre chofe ; & à
raifon de' leur peu--de volume 8c de leur grande
valeur, il en coûte moins pour les faire aller &
venir d’ une place à l’autre , & ils perdent moins
dans le transport que prefque tout le refte. Ainfi,
de toutes les marchandifes qu’on acheté en pays
étranger dans la feule vue de les revendre ou de
les échanger ailleurs , il n’y en a point de plus
commode que l’or 8c l’argent. Le principal avantage
que la Grande-Bretagne retire de fon commerce
du Portugal, eft de faciliter toutes les
efpèces de commerce étranger qu’elle fait par
détour 5 8c quoique ce ne foit pas un avantage
capital, c’en e ft, fans doute , un confidérable.
Il paroît clair qu’il ne faut à la Grande - Bretagne
qu’une petite importation annuelle d'or 8c
d’argent, pour le fupplément annuel dont fa vaiffelle
8c fa monnoie ont befoin. Or quand elle
n'auroit plus de commerce direét avec le Portugal
, elle trouveroit toujours à fe pourvoir ailleurs
de cette petite quantité.
• Quoique le commerce des orfèvres y foit confidérable
, la plus grande partie de la vaiffelle
neuve qu'ils vendent chaque année eft faite avec
de la vieille vaiffelle ; de forte que ce qu'ils ajoutent
à toute la vaiffelle du royaume eft peu de
chofe , & n'exige pas une grande importation
de ces métaux.
-Il en eft de même de la monnoie. Je ne penfe
dEcort» polit, & diplomatique, Tom, 1 K,
pas que perfonne imagine que la plus grande partie
du monnoyage annuel, qui, pour les dix années
qui ont précédé la réforme des efpèces en o r , fe
monte à plus de huit cents mille livres fterlings
par an en monnoie d 'o r , foit une addition faite
annuellement aux efpèces courantes qui étoient
auparavant dans le royaume. Dans un pays où la
dépenfe du monnoyage eft défrayée par le gouvernement
, la valeur de la monnoie , lors même
qu'elle a exactement le poids 8c le titre fixés , ne
peut jamais excéder de beaucoup celle d'une égale
quantité non monnoyée de ces métaux, parce
qu'il n'en coûte que là peine d’aller à l'hôtel de
la monnoie, & d'attendre peut - être quelques
femaines pour avoir en efpèces ce qu’on a en lingots.
Foyei l'article M on no ie . Voye^ aufli les
articles Im po r t a t io n , In dustrie , M onopole.
Ordre chronologique des principaux traites.
I. Alliance des trois pays ou cantons d’U r y ,
Schwitz & Unterwarden, en françois; àBrumetis
dans le canton de Schwitz , le 7 décembre mM §
II. Alliance des quatre cantons, Lucerne, U ry ,
Schwitz 8c Unterwarden , en françois ; à Lucerne,
le 8 novembre 1332.
III. Traité de Charles V I I , roi de France, avec
les Suiffes, ( c'eft le premier traité que la France
fit avec eux ) en latin 5 le 28 mars 1453.
IV. Alliance & confédération perpétuelle des
fept,cantonsde Zur ich, Lucerne , Ury, S chw itz ,
Unterwarden , Zug & Glaris, d'une part ; 8c les
grifonsou ligues grifes, d'autre part, en françois,
le 22 juin 1497.
V . Traité de paix entre Henri I I , roi de France ,
8c Philippe I I , roi d'Efpagne , en françois ; à
Château - Cambrefis , le 3 avril 1559.
VI. Traité particulier enfuite du traité général ,
entre les rois Henri II 8c Philippe I I , en François >
à Château-Cambrefis , le 3 avril 1 y59.
V IL Traité de paix entre l’empereur Ferdinand
I I , & Louis X I I I , touchant le différend pour U
fucceflion des duchés de Mantoue & de Mont-
ferrat-, en françois j à Ratifbonne, le 13 o&obre
1630.
VIII. Traité entre l’empereur & le roi Louis
X I I I , pour l’exécution de la paix d’Italie, en
françois ; à Quiérafque , le 6 avril 1631.
IX . Etat des terres aflignées audit duc de Savoie,
dans le Montferrat, conformément au traité précédent
, en françois ; à Quiérafque, le 6 avril 1631.
X . Traité entre le roi 8c le duc de Savoie, par
lequel le duc cède^ au roi la ville & château de
Pignerol, en françois j à Saint-Germain-en-Laye,
le S mai 1631.
Z z