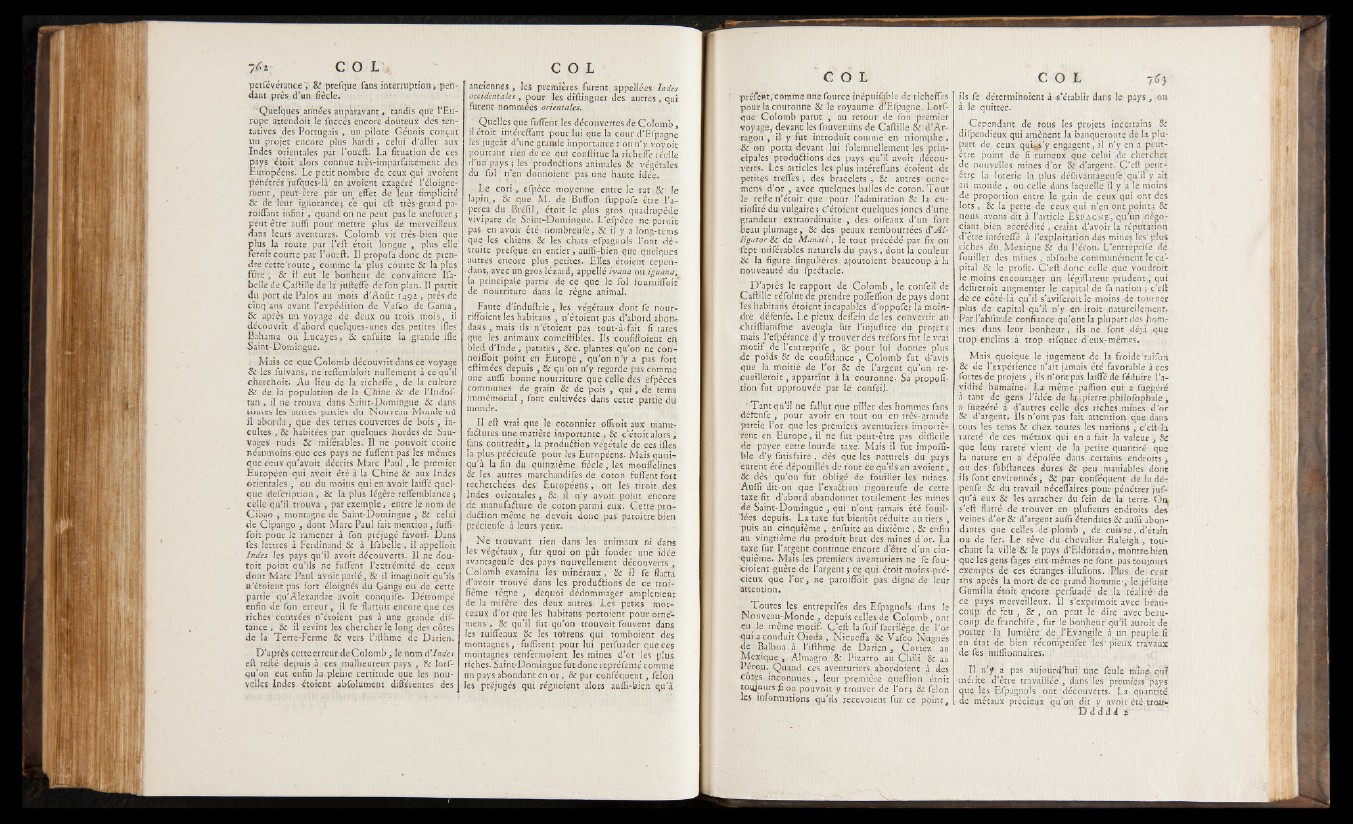
~ j6 t C O L 4
persévérance*; & prefque fans interruption, pendant
près ft’ uûi fiècle.
‘ Quelques années auparavant , tandis que l’Europe
attendoit le fuccès encore douteux dés tentatives
dès Portugais , un pilote Génois conçut
un projet encore plus hardi, celui d’aller aux
Indes orientales par l’ou'eft. La fituation de ces
pays étoit alors connue très-imparfaitement des
Européens! Le petit nombre de ceux qui avôient
pénétrés jufques-là1 en avôi'ent exagéré l'éloignement,
peut-être par un^ effet de leur fimplicité
& Hè leur ignorance; ce qui eif très-grand pa-
roiflant infini , quand on ne peut pas le mefurer ;
peut être- auffi pour mettre plus de merveilleux
dans leurs aventures. Colomb vit très-bien que
plus la route par l ’eft étoit longue , plus elle
ferdit courte par i’oùeft. Il propofa donc de prendre
dette route, comme la plus courte 8c la plus
fûre , & il eut le bonheur de convaincre Ifa-
belle de .Caftille de 1.2 juftefle de: fon'plan. Il partit
du port de Palos uu mois d’Août 1492 , près de
cinq ans avant l’expédition de Vafeo de Gama,
& après un voyage de deux ou trois mois, il
découvrit d’abord quelques-unes des petites illes
Bahama. pu Lucayès, & enfui te la .grande ifle
Saint-Domingue. ,
Mais ce que Colomb découvrit dans ce voyage
& Jes fuivans, ne reffembloit nullement à ce qu’ il
çherehoit. Au lieu de la richeffe., de la culture
& de la population de la -Chine & de l’Indof-
tan , il ne trouva dans Saint-Domingue & dans
toutes les autres parties du Nouveau-Monde où
il aborda, que des terres couvertes de bois , incultes,
& habitées par quelques hordes de Sauvages
nuds 8c miférables. Il ne pouvoit croire
néanmoins que ces pays ne fuffent pas’ les mêmes
que ceux qu’avoit décrits Marc Paul , le premier
Européen qui avoit été à la Chine & aux Indes
orientales , ou du moins qui en*avoit laide quelque
defcription , & la plus légère reftemblance ;
celle qu’il trouva, par exemple, entre le nom de
Cibao , montagne de Saint-Domingue , & celui
de Cipango , dont Mare Paul fait mention, fu-ffi-
foit pour le ramener à fon préjugé favori. Dans
fes lettres à Ferdinand & à Ifabelle, il appelloit
Indes les pays qu’ il avoit découverts. II ne dou-
toit point qu’ils ne fuffent l’extrémité de ceux
dont Marc Paul avoit parlé, & il imaginoit qu’ils
n’étorent pas fort éloignés du Gange ou de cette
partie qu’Âlexandre avoit conquife. Détrompé
enfin de fon erreur, il fe flattoit encore que ces
riches contrées n’étoiênt pas à une grande dif-
tance , 8c il revint les chercher le long des côtes
de la Terre-Ferme 8c vers l’ifthme de Darien.
D ’après cette erreur de C olomb , le nom dïIndes
eft relié depuis à ces^malheureux pays , 8c lorf-
qu’on eut enfin la pleine certitude que les nouvelles
Indes étoient abfolument différences^ des
C O L
'anciennes, les premières furent, appellées Indes
j occident aies, pour les diftinguer des autres, qui
furent nommées orientales.
Quelles que fuflent les découvertes de Colomb ,
il étoit iméreflant pour lui que la cour d’Efpagne
les jugeât d’une grande importance r on n’ y voyoit
; pourtant rien de ce qui conftitue la richeffe réelle
d’un*pays ; le s -productions animales & végétales
du fol n’en donnoiènt pas uné haute idée.
Le c o r i, efpèce moyenne entre le rat 8c le
lapinv, & -que M. de Buffon fuppofe être l’a-
perea du Bréfîl, étoit le plus gros quadrupède
vivipare de Saint-Domingue. L ’efpèce ne paroît
pas en avoir été. nombreufe, & il y a long-tems
que les chiens & les chats-efpagnols l’ont d é truite
prefque en entier, auffi-bien que quelques
autres encore plus petites. Elles étoient cepen-*
- dans, avec un gros lézard, appellé iv a n a ou iguana,
la principale partie de ce que le fol fournifToitT
de nourriture dans le règne animal.
Faute d’induftrre, les végétaux dont fe nour-
riffoient les habitans , n’étoient pas d’abord abon»
dans , mais ils n’étoient pas tout-à-fait fi rares
que les animaux comeftibles. Ils confiftoient eh
bled d’ Inde, patates, & c . plantes qu’on ne.con-
noilfoit point en Europe, qu’on n’y a pas fort
eftimées depuis , & qu’on n’y regarde pas comme
une auffi bonne nourriture que celle des efpèces
communes de grain 8c de pois , q u i, de fems
immémorial, font cultivées dans cette partie dti
monde.
Il eft vrai que le cotonnier offroit aux manufactures
une matière importante , 8c ç’étoit alors »
fans contredit,, la production végétale de ces ifles
la plus précieufe pour les Européens. Mais quoi-
qu’à la fin du quinzième fiècle, les mouflelines
8c les autres marchandifes de coton fuffent fort
recherchées des' Européens, on les droit des
Indes orientales, 8c- il n’y avoit point encore
de manufacture de coton parmi eux. Cette production
même ne devoit donc pas' pâroitre bien
précieufe à leurs yeux.
Ne trouvant rien dans les animaux ni dans
les végétaux , fur quoi on pût fonder une idée
avantagëufe des pays nouvellement découverts ,
Colomb examina les'minéraux , & il fe flatta
d’avoir trouvé dans les productions de ce troi-
fième règne:, dequoi dédommager amplement
de la mifère des deux autres. Les petits morceaux
d’or que les habitans portoient pour orne-
mens , 8c qu’il fut qu’on trouvoit fouvent dans
les ruiffeaux 8c les totrens qui tomboient des
montagnes, Suffirent pour lui perfuader que ces
montagnes renfermoient les mines d’or les plus
riches. Saint-Domingue fut donc repréfenté comme
un pays abondant en o r , & par conféquent, félon
les préjugés q.ui régnoient alor-s auffi-bien qu’à
C O L
préfewt, comme une fource inépuifable de richeffes
pour la couronne & le royaume d’Efpagne. Lorf-
que Colomb parut , au retour de fon premier
voyage, devant les fouverains de Caftille & d.’Ar-
ragon^ il y fut introduit comme en triomphe ,
■8c on porta devant lui folemnellement les principales
productions des pays qu’ il avoit découverts.
Les articles les plus intéreffans étoient de
petites treffes, des bracelets , & autres'orne-
•mens d’or , avee quelques balles de coton. Tout
le relie n’étoit que pour l’admiration 8c la cu-
riofité du vulgaire? c’étoient quelques joncs d’une
grandeur extraordinaire , des oifeaux d’un fort
beau plumage, & des peaux rembourrées <£A l ligator.
8c de Maniai, le tout précédé par fix ou
fept miférables naturels du pays, dont la couleur
& la figure fingulières. ajoutoient beaucoup à la
nouveauté du fpeCtacle.
D ’après le rapport de Colomb , le confeil de
Caftille réfolutde prendre poffeffion de pays dont
les habitans étoient incapables d’oppofer la moindre
défenfe. Le pieux deffein de les convertir au
chriftianifme aveugla fur I’injuflice du projet
mais l ’efpérance d’y trouver dés t ré fors fut le vrai
..motif deTentreprife , 8c pour lui donner plus
.de poids 8c de confiftance , Colomb fut d’avis
que la moitié de l’or & de l’argent qu’on re-
xueilleroit, appartînt à la couronne. Sa propofi-
tion fut approuvée par le confeij.
f Tantqu’il ne fallut que piller des hommes fans
défenfe , pour avoir en tout ou en très-grande
partie l’or que les premiers aventuriers impovtè1-
rèn.t en Europe, il ne fut peut-être pas difficile
de payer cette lourde taxe. Mais il fut impoffi-
ble d’y fatisfaire , dès que les naturels du pays
eurent été dépouillés de tout ce qu’ils en avoient,
& dès qu’on fut obligé de fouillér le,s mines.
Auffi dit-on que l’exaCfcion rigoureufe de cette
taxe fit d’abord abandonner totalement les mines
de Saint-Domingue , qui n’ont jamais été fouillées
depuis. La taxe fut bientôt réduite au tiers ,
puis au cinquième , enfuite au dixième , 8c enfin
au vingtième du produit brut des mines d ’or. La
taxe fur l’argent continue encore d’être d’un cinquième.
Mais lès premiers aventuriers ne fe fou-
'cioient guère de l’argent ? ce qui étoit moins-précieux
que l’o r , ne paroifloit pas digne de leur
Attention.
Toutes les entreprifes des Efpagnols dans le
Nouveau-Monde , depuis celles de Colomb, ont
eu le mêine motif. C ’eft la foif facrilège^ de l ’o^r
qui a conduit Oïeda,, Nicueflà & Vafeo Nugnés
de Balboa .à l’ifthme de, Darien , C o r tè z , au
Mexique, Almagro 8c Pizarro au C h i li . & au
Pérou. Quand ces aventuriers abordoient à des
cot^s inçonnuës., leur première queftion étoit
toujours û on pouvoit y trouver de l’or; & félon
les informations qu’ils.jrecevoienc fur ce point.
C O L 'p f y
ils fë détermihoient à -s’établir dans le pays, ou
à le quitter.
Cependant de tous les projets incertains &
difpendieux qui amènent la banqueroute de la plupart
de. ceux qu%s’y engagent, il n’y en a peut-
être; point de fi ruineux que'celui de cherchée
de nouvelles mines d’or 8c d’argent.1 Ç ’eft peut-
être la. loterie la plus défavantagëufê qu’il y ait
aii monde , ou celle dans laquelle il y à le moins
de proportion entre le gain de ceux, qui ont des
lots , & la perte de ceux qui n’en ont point.; &
nous avons dit à l’ article Espag ne , qii’un négociant
bien: accrédité , craint d’avoir l'a réputation
d’êtrè intéreffé à l’exploitation des mines les' plus
riches du Mexique &: du Pérou. L’entreprife de
fouiller des mines, abforbe communément le capital
8c le prb fit. C ’eft donc celle que Voudrait
le moins encourager un légiflateur prudent, qui
defireroit augmenter le capital de fa nation ; c’eft
de ce côté-là qu’il s’aviferoit le moins de tourner
plus de capital qu’ il n’y en-iroit naturellemenr.
Parl’abfurde confiance qu’ont la plupart des hommes,
dans leur bonheur , ils ne ipnt déjà -que
trop enclins à trop rifquer d’eux-mêmes. ■
Mais quoique le jugement de la froide‘raifoti
8c de l’ expérience n’ ait jamais été Favorable à ces
fortes de projets , ils n’on-tpas laififé de féduire -l’avidité
humaine. La même paffion qui a fùg^éfé
à tant de gens l’idée de la i pierre philofophale ^
a-fuggéré à d’autres celle des riches.mines d ’or
& d’argent. Ils h’ont pas • fait attention que.dans
tous les tëms & chez toutes les nations , c’eft la
rareté de ces métaux qui en a fait la valeur > Sc
que leur rareté vient de la petite quantité que
h nature en a dépofée dans -certains, endroits j
ou des fubftancés dures & peu maniables dont
ils font environnés, & par conféquent de la dé-
penfe & du travail nécefifaires pour pénétrer juf-
qu’ à eux & les Arracher du fein de la terre. On^
s’ eft flatté de trouver en plufieurs endroits des
veines d’or 8c d’ argent auffi étenducsik auffi abondantes
que celles-dé plomb , de cuivre, d’étain
ou de fer. Le rêve du chevalier. Raleigh , touchant
la villêi& le p^ys d’Eldorada, montrobien
que les gens fages eux-mêmes ne font pas to.ujnu.rs
exempts de ces étranges’illufions. Plus, dej cent
ans après la mort deice grand.homme viftijéfuite
Gumilla étoit encore perfuadë- de la réajité^de
ce pays merveilleux. Il s’exprimoit avec béâu-
coup de feu , 8c , on peut le dire avec beaucoup
de franchife , fur le bonheur qfû’rl auroit de
porter la lumière-, de-l’Evangile, àt un peuple.fi
en état de bien récomperifèr les1 pieux travaux
de fes miffionnaires.
II n’y a pas aujourd’hui1 line feule Thuip.qü1
•mérite d’être travaillée , dans îes ' premiér-s^pàys
que. les Efpagnols ont découverts. La..quantité
de métaux précieux qu’on dit y avoir été troü*
D d d d d *