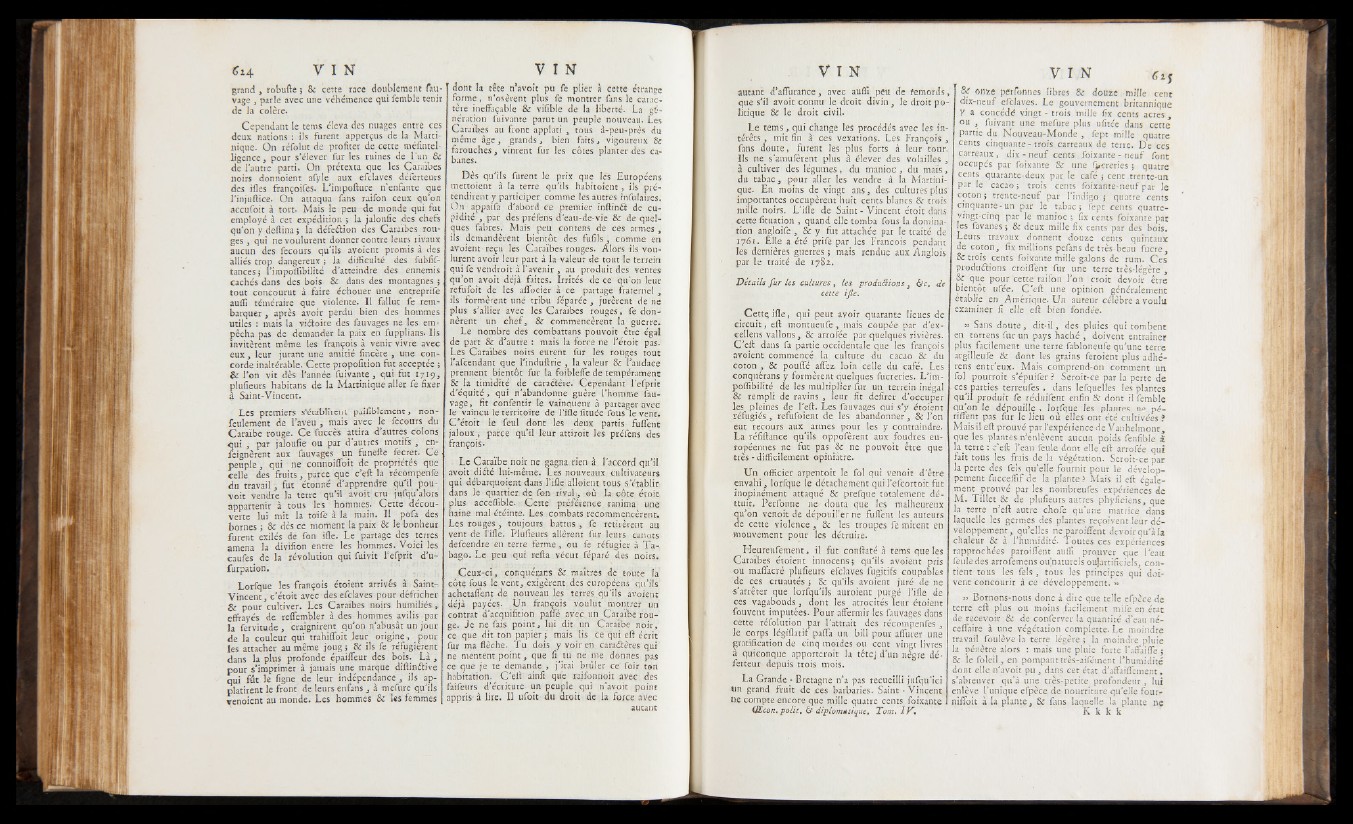
grand, robufte j & cette race doublement ravivage
, parle avec une véhémence qui femble tenir
de la colère.
Cependant le tems éleva des nuages entré ces
deux nations : ils furent apperçus de la Martinique.
On réfolut de profiter de cette méfîntel-
ligence, pour s’élever fur les ruines de l ’un &
de l’autre parti. On prétexta que les Caraïbes
noirs donnoient afyle aux efclaves déferteurs
des ifles françoifes. L’impofture n’enfante que
l ’injuftice. On attaqua fans raifon ceux qu’on
accufoit à tort. Mais le peu de monde qui fut
employé à cet expédition ; la jaloufie des chefs
qu’on y deftina ; la défection des Caraïbes rouges
, qui ne voulurent donner contre leurs rivaux
aucun des fecours qu’ils avoient promis à des
'alliés trop dangereux j la difficulté des fubfif-
tancesj l’impoflibilité d’atteindre des ennemis
cachés dans des bois & dans des montagnes 5
tout concourut à faire échouer une entreprife
auffi téméraire que violente. Il fallut fe rembarquer
y après avoir perdu bien des hommes
utiles : mais la vi&oire des fauvages ne les empêcha
pas de demander la paix en fupplians. Ils
invitèrent même les françois à venir vivre avec
eux , leur jurant une amitié fincère , une concorde
inaltérable. Cette propofition fut acceptée 5
& l’on vit dès l’année fuivante, qui fut 17 19,
plufieurs habitans de la Martinique aller fe fixer
à Saint-Vincent.
Les premiers s’établirent paifiblement, non-
feulement de l’aveu , mais avec le fecours. du
Caraïbe rouge. C e fuccès attira d’autres côlons
qui , par jaloufie ou par d’autres motifs , en- i
feignèrent aux fauvages un funéfte fecret. C e
peuple, qui ne connoifloit de propriétés que
celle des fruits, parce que c’eft la récompenfe
du travail j fut étonné d’apprendre qu’ il pou-
voit vendre la terre qu’il avoit cru jafqu’ alors
appartenir à tous les hommes. Cette decouverte
lui mit la toife à la main. Il pôfa des
bornes j & dès ce moment la paix & le bonheur
furent exilés de fon ifle. Le partage des terres
amena la divifion entre les hommes. Voici les
caufes de la révolution qui fuivit refprit d’u-
furpation.
Lorfque les françois étoient arrivés à. Saint-
Vincent, c’étoit avec des efclaves pour défricher
& pour cultiver. Les Caraïbes noirs humiliés ,!
effrayés de reflembler à des hommes avilis par
la fervitude , craignirent qu’on n’abusât un jour
de la couleur qui trahifîbit leur' origine, pour
les attacher au même joug ; & ils fe réfugièrent
dans la plus profonde épaifleur des bois. Là ,
pour s’imprimer à jamais une^ marque diftinétive
qui fut le ligne de leur indépendance 3 ils ap-
platirent le front de leurs enfans à mefure qu’ ils
yenoient au monde. Les hommes & les femmes
dont la tête n*avoit pu fe plier à cette étrange
forme, n’osèrent plus fe montrer fans le caractère
ineffaçable & vifible de la liberté. La génération
fuivante parut un peuple nouveau. Les
Caraïbes au front applati 3 tous à-peu-près du
même âge 3 grands, bien faits, vigoureux 8e
farouches 3 vinrent fur les côtes planter des cabanes.
Dès qu’ils furent le prix que lés Européens
mettoient à la terre qu’ils habitoient, ils prétendirent
y participer comme les autres infulaires.
! On àppaifa d’abord ce premier inftinâ: de cupidité
, par des préfens d ’eau-de-vie & de quelques
fabres. Mais peu contens de ces armes ,
ils demandèrent bientôt des fufils 3 comme en
avoient reçu les Caraïbes rouges. Alors ils voulurent
avoir leur part à la valeur de tout le terrein
qui fe vendroit à l’avenir , au produit des ventes
qu’on avoit déjà faites. Irrités de ce qu'on leur
refufoit de les afîocier à ce partage fraternel ,
! ils formèrent unè tribu féparée, jurèrent de ne
plus s’allier avec les Caraïbes rouges, fe donnèrent
un chef, & commencèrent la guerre.
Le nombre des combattans pouvoit être égal
de part & d’autre : mais la force ne l’étoit pas.
Les Caraïbes noirs eurent fur les rouges tout
l’afcendant que l’ induffrie , la valeur & l’audace
prennent bientôt fur la foibleffe de tempérament
& la timidité de caractère. Cependant l ’efprit
d’équité, qui n’abandonne guère l ’homme fau-
vage, fit confentir le vainqueur à partager avec
le vaincu le territoire de l’ifle fituée fous le vent.
C ’étoit le feul dont les deux partis fufîent
jaloux, parce qu’il leur attiroit les préfens des
françois.
Le Caraïbe noir ne gagna rien à l'accord qu’ il
avoit diété lui-même. Les nouveaux cultivateurs
qui débarquoient dans l’iffe; alloient tous s’établir
dans le quartier.de fon rival^ où. la côte étoit
plus acceflîble. Cette' préférence, ranima une
haine mal éteinte. Les combats recommencèrent.
Les rouges, toujours battus , fe retirèrent au
vent de l’ifle. Plufieurs allèrent fur leurs canots
defcendre en terre ferme , ou fe réfugier à T a -
bago. Le peu qui. relia yécut féparé des noirs.
C eu x -c i, conquérans & maîtres de toute la
côte fous le vent, exigèrent des européens qu’ils
açhetaflent de nouveau les terres ,qu’ils avoient
déjà payées* Un françois voulut montrer un
contrat d’acquifition pané ayec un Caraïbe rouge.
Je ne fais point, lui dit un Caraïbe noir,
ce que dit ton papier j mais lis ce qui eft écrit
fur ma flèche. T u dois y voir en caraélères qui
ne mentent point, que fi tu né me donnes pas
ce que je te demande , j’ irai brûler ce foir ton
habitation. C ’èit ainfi que raifonnoit avec des
faifeurs d’écriture un peuple qui n’ avoit point
appris-à lire. Il ufoit du droit de la force avec
autant
V I N
autant d’affurance, avec auffi peu de femords,
que s’il avoit connu le droit divin, le droit politique
& le droit civil.
Le tems, qui change les procédés avec les intérêts
, mit fin à ces vexations. Les François ,
fans doute, furent les plus forts à leur tour.
Ils ne s’amufèrent plus à élever des volailles ,
à cultiver des légumes, du manioc , du maïs,
du tabac, pour aller les vendre à la Martinique.
En moins de vingt ans, des cultures plus
importantes occupèrent huit cents blancs & trois
mille noirs. L’ifle de Saint - Vincent étoit dans
cette fituation , quand elle tomba fous la domination
angloife , & y fut attachée par le traité de
1761. Elle a été prife par les François pendant
les dernières guerres j mais rendue aux Anglois
par le traité de 1782.
Détails fur Us cultures, les productions, &c. de
cette ifle.
^ Cettq ifle , qui peut avoir quarante lieues de
circuit, eft montueufe, mais coupée par d’ex-
cellens vallons, & arrofée par quelques rivières.
C ’eft dans fa partie occidentale que les françois
avoient commencé la culture du cacao & du
coto n , & pouffe aflez loin celle du café. Les
conquérans y formèrent quelques fucreries. L ’impoflibilité
de les multiplier fur un terrein inégal
& rempli de ravins , leur fit defîrer d’occuper
les pleines de l’ell. Les fauvages qui s’y étoient
réfugiés, refufoient de les abandonner, & l’on
eut recours aux armes pour les y contraindre.
La réfiftance qu’ ils oppofèrent aux foudres européennes
ne fut pas & ne pouvoit être que
très - difficilement opiniâtre.
Un officier arpentoit le fol qui venoit d’être
envahi, lorfque le détachement qui l’efcortoit fut
inopinément attaqué & prefque totalement dé-
ttuit. Perfonne 11e douta que les malheureux
qu’on venoit de dépouiller ne fuflënt les auteurs
de cette violence , & les troupes fe mirent en
mouvement pour les détruire.
Heureufement, il fut conftaté à tems que les
Caraïbes étoient innocens; qu’ils avoient pris
ou maflacré plufieurs efclaves fugitifs coupables
de ces cruautés ; & qu’ils avoient juré de ne
s ’arrêter que lorfqu’ils auroient purgé l’ifle de
ces vagabonds, dont les atrocités leur étoient
fouvent imputées. Pour affermir les fauvages dans
cette réfolution par l ’attrait des récompenfes ,
le corps légiflatif pafîa un bill pour aflurer une
gratification de cinq moïdes ou cent vingt livres
à quiconque apporteroit la têteJ d’un nègre dé-
ferteur depuis trois mois.
La Grande - Bretagne n’ a pas recueilli jufqu’ici
un grand fruit de ces barbaries. Saint - Vincent
ne compte encore que mille quatre cents foixante
(Eicon, polit» &■ diplomatique, Tom, IV\
V I N tz,
8ç onze per fon nés libres & douze mille cent
dix-neuf efclaves. Le gouvernement britannique
y a concédé vingt - trois mille fix cents acres ,
ou , fuivant une mefure plus ufitée dans cette
partie du Nouveau-Monde, fept mille quatre
cents cinquante - trois carreaux de terre. De ces
carreaux, dix - neuf cents foixante - neuf font
occupés par foixante & une frcreries } quatre
cents quarante-deux par le café 5 cent .trente-un
par le cacao ; trois cents foixante-neuf par le
coton 5 trente-neuf par l’indigo 5 quatre cents
cinquante-un par le tabac ; fept cents quatre-
vingt-cinq par le manioc ; fix cents foixante par
les favanes> & deux mille fix cents par des bois.
Leurs travaux donnent douze cents quintaux
de coton, fix millions pefans de très-beau fucre,
& trois cents foixante mille galons de rum. C e s
productions croifîent fur une terre très-légère ,
& que pour cette'raifon l’on croit devoir être
bientôt ufée. C ’eft une opinion généralement
établie en Amérique. Un auteur célèbre a voulu
examiner fi elle eft bien fondée.
« Sans doute, dit-il, des pluies qui tombent
en torrens fur un pays haché , doivent entraîner
plus facilement une terre fabloneufe qu’une terre
argilleufe & dont les grains feroient plus adhé-
rens entr’eux. Mais comprend-on comment un
fol pourroit s’épuifer ? Seroit-ce par la perte de
-ces parties terreufes , dans lefquelles les plantes
qu’il produit fe réduifent enfin & dont il femble
qu’on le dépouille , lorfque les plantes ne péri
fient pas fur le lieu où elles ont été cultivées ?
Mais il eft prouvé par l’expérience de Vanhelmont,
que les plantes n’enlèvent aucun poids fenfible a
la terre : c’ eft l’eau feule dont elle eft arrofée qui
fait tous les frais de la végétation. Seroit-ce par
la perte des Tels qu’elle fournit pour le développement
fucceflif de la plante ? Mais il eft également
prouvé par les nombreufes expériences de
M. Tillet & de plufieurs autres phyficiens, que
la terre n’eft autre chofe qu’une matrice dans
laquelle les germes des plantes reçoivent leur développement,
qu’elles ne paroiflent devoir qu’à la
chaleur & à l’humidité. Toutes ces expériences
rapprochées paroiflent auffi prouver que l ’eau
feule des arrofemens ou'naturels oujartificiels, contient
tous les Tels, tous les principes qui doivent
concourir à ce développement. »
» Bornons-nous donc à dire que telle efpèce de
terre eft plus ou moins facilement mife en état
de recevoir & de conferver la quantité d’eau nc-
ceflaire à une végétation complette. Le moindre
travail foulève la terre légère ; la moindre pluie
la pénètre alors : mais une pluie forte l’affaiffe ;
& le fole.il, en pompant très-aiféinent l'humidité
dont elle n’avoit p u , dans cet état d’affaifîement,
s’abreuver qu’à une très-petite profondeur, lui
enlève l’unique efpèce de nourriture qu’elle four-
niflbit à la plante, & fans laquelle la plante ne