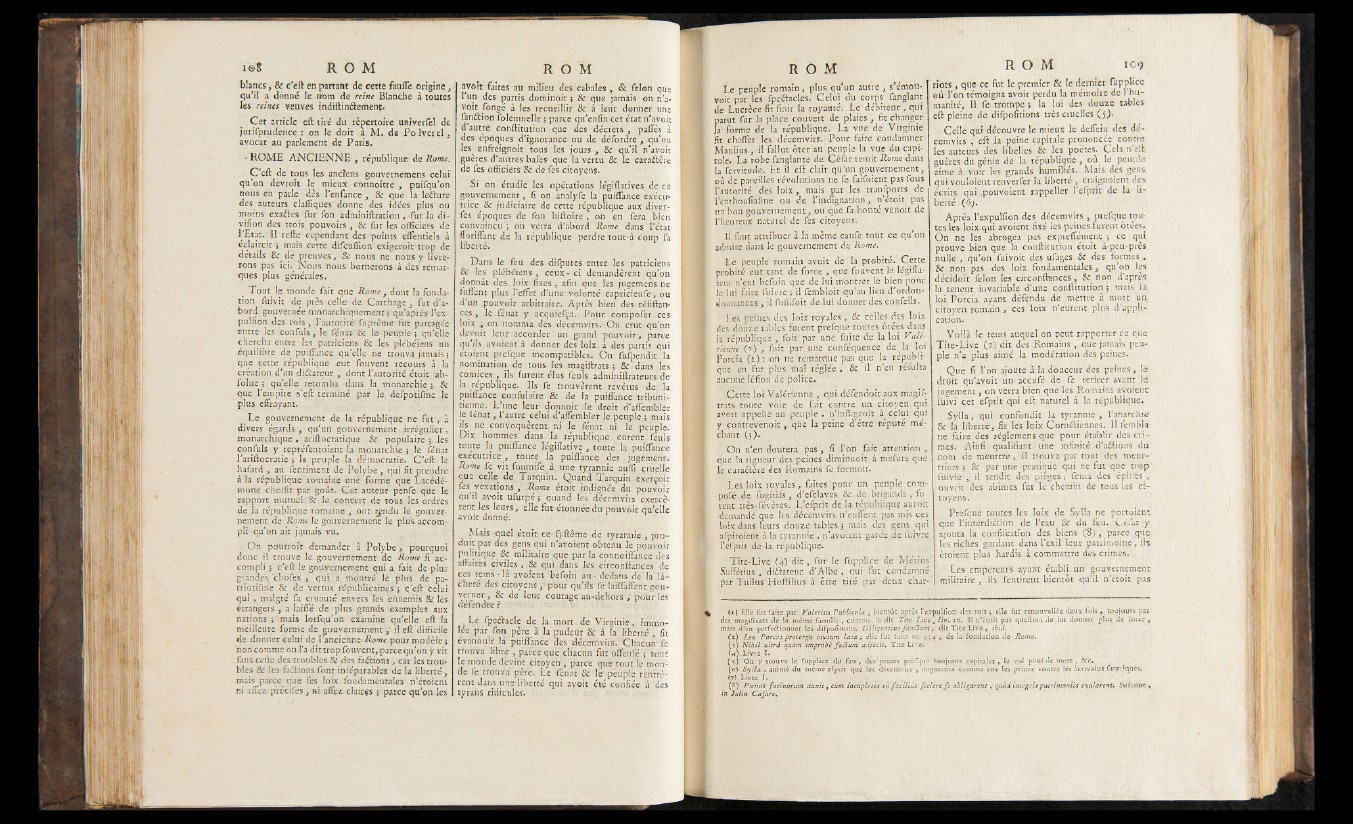
¥ 0 R O M
blancs, & c'eft en partant de cette faufle origine ,
qu'il a donné le nom de reine Blanche à toutes
les reines veuves indiftin&emenf.
C e t article eft tiré du répertoire univerfel de
ju ri fprd dence : on le doit à M . de P olve rel ,
avocat au parlement de Paris.
* ROM E A N C IE N N E , république de Rome.
C'eft de tous les anciens gouvernemens celui
qu’on devroit le mieux connoître , paifqu'on
nous en parle dès l'enfance , 8c que la leéhrre
des auteurs claffiques donne des idées plus ou
inoins exaltes fur fon adminiftration , -fur-la di-
vifion des trois pouvoirs 3 8c fur les officiers de
J’Etat. Il relie cependant des points elfentiels à
éclaircir ; mais cette difcufîîon exigeroit trop de
details 8c de preuves, & nous ne nous y livrerons
pas ici.^ Nous nous bornerons à des remarques
plus générales.
Tout le monde fait que Rome 3 dont la fondation
fuivit de près celle de Carthage ^ fut d'abord
gouvernée monarchiquement j'qu'après l'ex-
pulfîon des rois , l'autorité fuprême fût parta-g.ee
entre les confuls , le fénat -& le- peuple 5 qu'elle
chercha entre les patriciens & les plébéiens un
équilibre de puiflance. qu'elle ne trouva jamais 5
que cette république eut fouvent recours à la
création d'un dilhteur , dont l’autorité étoit ab-
fo lu e } qu’elle retomba dans la monarchie 5 &
que l'empire s’eft terminé par Je defpotifme le
plus effrayant.
Le gouvernement de la république ne fû t , à
divers égards 3 qu'un gouvernement: irrégulier
monarchique , autocratique • & populaire 5 les
confuls y repréfentoient la monarchie } le fénat
l'ariftocratie ; le peuple la démocratie. C'eft le
hafard , au fentiment de Polybe, qui fit prendre
à la république romaine unë forme que Lacédémone
choifit par goût. C et auteur penfe que le
rapport mutuel & le concert de tous les ordres
de la république romaine , ont rgndu le gouvernement
de Rome le gouvernement le plus accompli
qu'on ait jamais vu.
On pourroît demander à P olyb e , pourquoi
donc il trouve le gouvernement de Rome û zc-
compli 3 c'eft le gouvernement quia fait de plus
grandes, chofes , qui . a montré le plus de pa-
rriotifmë 8c de vertus repùblicairiës y c/eft ’celui
qui , malgré fa cruauté envers lés ennemis & les
étrangers , a laifle de plus grands exemples aux
nations ; mais lorfqu’on examine qu'elle eft la
meilleure forme de gouvernement, il eft difficile
de donner celui de l'ancienne Rome pour modèle 5
non comme on l’a dit trop fouvent, parce qif on y vit
fans celle des troubles & des faisions, car les trou*
blés & les fa&ions font inséparables delà liberté,
mais parce que fes loix fondamentales n’étoient
ni allez précifes, ai afîèz clairfs 5 parce qu’on le s .
R O M
avoît faites au milieu des cabales, & félon que I
I fH des partis dominoit y 8c que jamais on n'a- I
voit fongé à les recueillir & à leur donner une I
fanltion folemnelle j parce qu'enfin cet état n’avoic I
d'autre conftitution que des décrets , pafles à I
des époques d'ignorance ou de défordre , qu'ou I
les^ enfreignoit tous les jours , 8c qu'il n'avoit I
guères d'autres bafes que la vertu 8c le caractère I
de fes officiers & de fes citoyens.
Si on étudie les opérations légiflatives de ce I
gouvernement , fi on analyfe la puiflance exécu* I
trice & judiciaire de cette république aux diver- I
fes époques de fon hiftoire , 011 en fera bien I
convaincu \ on verra d'abord Rome dans l’état I
floriflant de la république perdre tout-à coup fa I
liberté.
! -Dans le feu des difputes entre les patriciens I
& les plébéiens, ceux- ci demandèrent qu'on I
donnât des loix fixes , afin que les jugemens ne I
fulfent plus l’effet d'une * volonté capricieufe, ou I
d'un .pouvoir arbitraire. Après bien des réfiftan- I
c e s , le fénat y acquiefça. Pour compofer ces I
loix ^ on nomma des décemvirs.- On crut , qu’on I
devoir leur accorder un grand pouvoir, parce I
qu'ils avoient à donner des loix: à des partis qui I
étoient prefque incompatibles. On fufpendit la I
nomination de tous les magiitrats 3 Sc dans les I
comices , ils furent élus feuls adminiftrateurs de I
la république. Us fe trouvèrent revêtus de. la I
puiftance confulaire. & de la puiftance tribûni- I
tienne. L'une leur do«noit le droit d'aftembler I
le fénat , l'autre celui d'aftembler le peuple 5 mais I
ils ne convoquèrent ni le fénat ni Te peuple. I
Dix hommes dans la république eurent feuls I
toute la puiflance légiftative , toute la puiflance I
exécutrice , toute la puiftance des jugemens. I
Rome fe vit foumife à, une tyrannie aufli cruelle I
que celle de Tarquin. Quand Tarquin -cxerçoit I
fes^ vexations 3 Rome étoit indignée du pouvoir I
qu’il a voit ufurpé 5 quand lés‘ décemvirs exercé- I
rent; les leurs, elle fut étonnée du pouvoir qu’elle t
avoir donné.
Mais -quel étoit ce' fyftême de tyrannie , pro- |
duit par des gens qui n'avoient obtenu le pouvoir I
politique & militaire .que-,par la contioiftance des I
affairés civiles , 8c qui dans les circohftanees de
ces tçms-làNavoient befoin au- dedans de la lâcheté
Tes citoyens ÿ ptjuif qu’ils fëTaifîaftent gouverner
, 8c de leur courage au-dehors I polir les.
défendre ?
} Le Û?e<^acle ûe la mort.de Virginie, immo-
lee par Ton père à la pudeur & â la liberté , fit
évanouir la puiftance d^s idéçerhvirs. Chacun fe
trouva libre , parce q.uê chacun 'fut offeirfé ; tout
le monde devint citoyen ’, parce que tout le monde
fe‘ttôtivâ père. L e Ténat & le peuplé réiitrè-
rent dans une liberté qui a voit été confiée à dés
tyrans ridicules.
R O M
Le peuple romain, plus qu*un autre , s’émou-
voit par les fpeltacles. Celui du corps fanglant
de Lucrèce fit finir la royauté. Le débiteur , qui
parût fur la place couvert de plaies , fit changer
la forme de la république. La vue de Virginie
fit. chafler les décemvirs. Pour faire condamner
Manlius, il fallut ôter au peuple la vue du Capitole.
La robe fanglante de Céfar remit Rome dans
la fervitu'de. Et il eft clair, qu’un gouvernement,
où de pareilles révolutions ne fe faifoient pas fous
l’autorité des lo ix , mais par les tranfports de
l'emhoufiafme ou de l’indignation, n’étoit pas
un bon gouvernement , ou que fa bonté venoit de
l’heureux naturel'de fes citoyens.
11 faut attribuer à la même caufe tout ce qu’ on
admire dans lé gouvernement de Rome.
Le peuple romain avoit de la ‘probité. Cette
probité eut tant de force , que fouvent le légifla-
teur n’eut befoin-que de lui montrer le bien pour
le lui faire Tu ivre ; il fembloit qu’au lieu d’ordon-
donnances , il Tuffifoit de lui donner des confeils.
• Les peines des loix royales , & celles des loix
des douze tables furent prefque toutes ôtées dans
|| république , foit,par une fuite de la loi V<ilé-
rienne ( t) , fort par, une conséquence de la loi
Porcia (z) : on ne remarque pas que la république
en fut plus mal réglée , 8c il n'en ré fui ta
aucune léfion de police.
Cette loi Valérienne , qui défendoit aux magif-
trats toute voie de fu t contre un citoyen qui
avoit appelle au peuple , n'infhgeoit à celui qui
y contrevenoit, que la peine d'être réputé méchant
(3).
On n'en doutera pas, fi l'on fait attention,
que la rigueur des peines diminuoit à mefure que
le caraltère des Romains fe formoit.
Les loix royales, faites pour un peuple com-
pofé de fugitifs, d’efclaves & de brigands, fu rent
très-fëveres. L'efprit de la république auroit
demandé que les décemvirs n’eulfent pas mis ces
loix dans leurs douze tables j mais des gens qui
afpiroient à la tyrannie , n'avoient garde de luiyre
l'efprk de la. république.
Tite-Livé (4) d i t , fur le fupplice de Métius
Suffétius, di&ateur d'Albe , qui fut condamné
par Tullus Hoftilius à être tiré par deux char-
R O M 109
riots , que ce fut le premier 8c le dernier fupplice
où l'on témoigna avoir perdu la mémoire de 1 humanité,
Il fe trompe ; la loi des douze tables
eft pleine de difpofitions très cruelles (5).
Celle qui découvre le mieux le deflein des décemvirs
, eft la peine capitale prononcée contre
les auteurs des libelles 8c les poètes. Cela n eft.
guères du génie de la république, où le peuple
aime à voir les grands humilies. Mais des gens
qui vouloient renverfer la liberté , craignoient des
écrits qui pouvoient rappeller 1'efprit de la liberté
(6j.
■ Après l'expulfion des décemvirs , prefque toutes
les loix-qu,i avoient fixé les peines furent ôtées.
On ne les abrogea pas expiefîement j ce qui
prouve bien que la conftitution étoit à-peu-pres
nulle , qu'on fuivoit des ufages 8c des formes ,
& non pas des loix fondamentales, qu’on les
décidoit félon les circonftances, 8c non d’après
la teneur invariable d’une conftitution 3 mais la
loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un
citoyen romain , ces loix n’eurent plus d'application.
Voilà le tems auquel on peut rapporter ce que
Tite-Live (7) dit des Romains , que jamais peuple
n'a plus aimé la modération des peines.
Que fi l’on ajoute à la douceur des peines, le
droit qu'avoit un accufé. de fe retirer avant lé
jugement, on verra bien que les Romains avoient
fuivi cet efprit qui eft naturel à la république.
Sylia, qui confondit la tyrannie , l’anarchie
8c la liberté, fit les loix Cornéliennes. 11 fembla
ne faire des réglemens que pour établir des crimes.
Ainfî qualifiant une infinité d'aétions du
nom de meurtre , il trouva par tout des meurtriers
3 & par une pratique qui ne fut que trop
fuivie , il tendit des pièges , fema des épines ,
ouvrit des abîmes fur le chemin de tous les citoyens,
Prefque toutes les loix de Sylla ne portoient
que l'interdiction de l'eau & du feu. Céfar y
ajouta la çonfifeation des biens (S ) , parce que
; les riches gardant dans l'exil leur patrimoine, ils
, étoient plus hardis à commettre des.crimes.
Les empereurs ayant établi-un gouvernement
militaire , ils fentirent bientôt qu’ il n'étoit pas
% ( !) Elle fu t faite par Valcriùs Publicola , bientôt apres l’expulfion des-rois -, elle fut renouveliée deux fois , toujours par
K des magilfracs de la même famille , comme le dit T ite -L iv e , liv . 10. Il n’étoit pas queftion clé lui donner plus de to r e s ,
B mais d’en perfe&iomier les difpofitions. Diiigentius fanClum, dit T i te Live , ibid.
f i ) Lex Porcia protergo civium Lata ; elle fut faite en 454 , de la fondation de Rome.
(? ) N ih il ultra quàm improbè faôlum adjecit. T ite Live.
(4^ Livre J . ........... .. . •
( T Oh y trouve le fupplice du feu , des peines prefque toujours capitales , le vol puni de mort . & c .
(6) Sy lla , animé du même efprit que les décemvirs", augmenta comme eux les peines contre les écrivains fatyriques.
(7) .Livre I.
(8) Parias facinorum a u x ït, cùm locupletes eo fa ç iliu s feelere f e obligarent, quod integrispatrimoniis exularent. Suétone , 1 in Jubio CaJ'are.