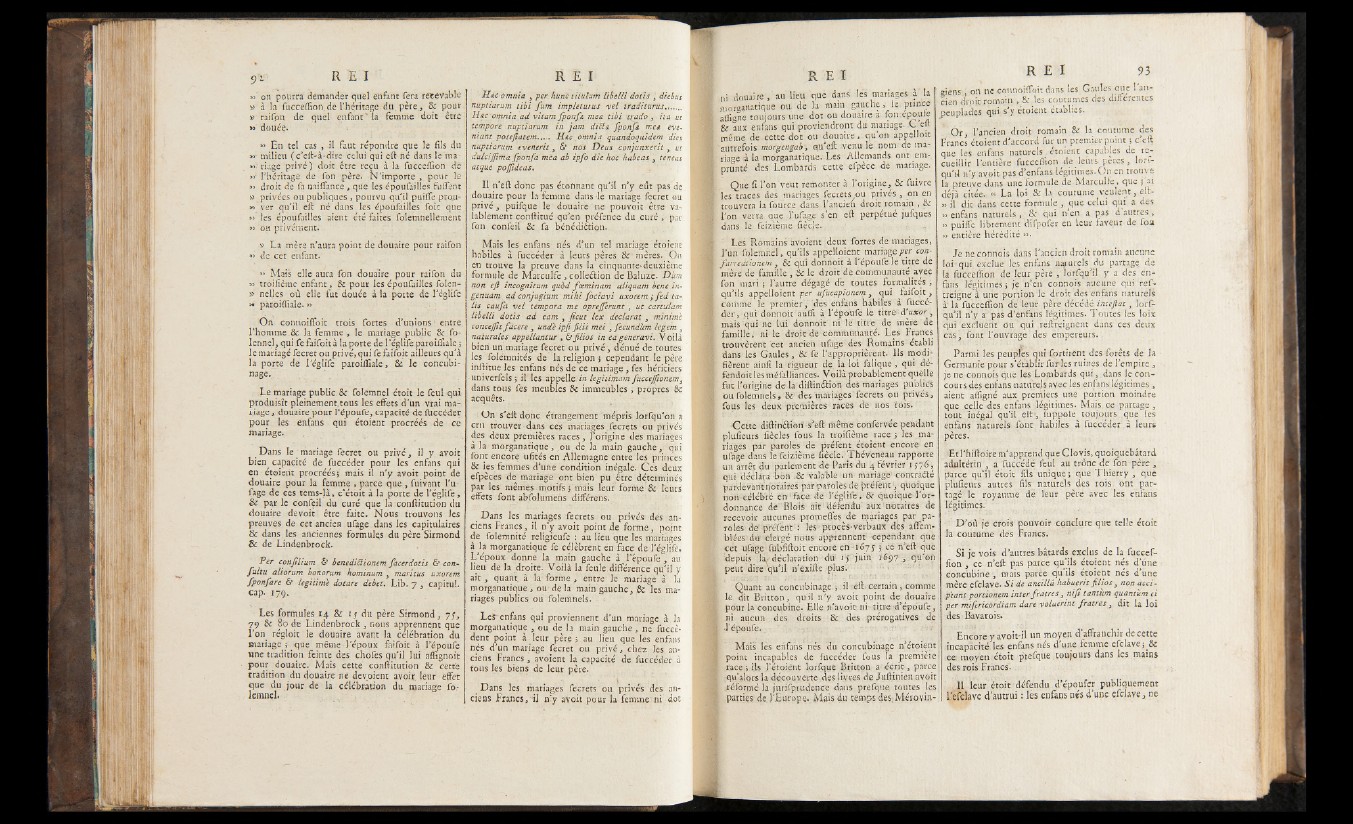
a» on pourra demander quel enfant fera redevable
» à la fuccefifi6n.de l’héritage du. père., 8c pour
» raifon de quel enfant ' l a femme doit être
» douée.
« En tel cas , il faut répondre que le fils du
>»• milieu ( c ’eft-à-dire celui qui eft né dans le ma-
m: ri âge privé) doit être reçu à la fucceffion de
sj l'héritage de fon père. N ’importe pour le
»s droit de fa naiffance, que les époufailles fuffent
» privées ou publiques , pourvu qu’ il. puifife pco.u-
» ver qu’il cft né dans les époufailles foit que
« les époufailles aient été faites folemnellement
« ou privément.
» La mère n’aura point de douaire pour raifon
m de cet enfant.
33 Mais elle aura fon douaire pour raifon du
33 troifième enfant, & pour les époufailles. folen-
» nelles où elle fut douée à la porte de l’églife
3« parpiffiale. 33
On connoilfoit trois fortes d’unions - entre
l'homme,& là femme, le mariage public & fo-
lennel, qui fe faifoit à la porte de Téglife paroiffiale }
le mariage fecret ou prive, qui fe faifoit ailleurs qu’à
la porte de l'églife paroiffiale, & le concubinage..
Le mariage public & folemnel étoit le feul qui
produisît pleinement.tous les effets d’un vrai mariage,
douaire pour l’époufe, capacité de fuccéder
pour les . enfans qui étoient procréés de ce
mariage.
Dans le mariage fecret ou privé, il y avoit
bien capacité de fuccéder pour les enfans qui
en étoient procréés} mais il n’y avoit point de
douaire pour la femme , parce que , fuivant l'u-
fage de ces tems-là, c’étoit à la porte de l’églife,
& par le confeil du curé que la conftitution du
douaire devoit être faite. Nous trouvons les
preuves de cet ancien ufage dans les capitulaires
& dans les anciennes formules du père Sirmond
& de Lindenbrock.
Per confiLium. & benediëtionem facerdotis & con-
fultu aliorum bonorum hominum 3 maritus uxorem
fponfare & légitimé dotare debet. Lib. 7 , capitul.
cap. 179.
Les formules 14 & 15 du père Sirmond, 75 3
79 8c 8b de Lindenbrock , nous apprennent que
l ’on régloit le douaire avant la célébration du
mariage ; que même 1 epoux faifoit à l’époufe
une tradition feinte des chofes qu’il lui affignoit
pour douaire. Mais cette conftitution & cette
tradition du douaire né dévoient avoir, leur effet
que du jour de la célébration du mariage folemnel.
H ac omnia , per hune tiiulum libelli dotis , diebus
nupdarum tibi fum impleturus vel traditurus.......
H&c'omni a ad vitam JponfA me a tibi 'trado ,. ita ut
tempore nupdarum in jam diÜA fponjA me a eveniant
potefiatem...... H ac omnia quandoquidem die s
nupdarum evenerit, 6’ nos De us conjunxerit 3 ut
dulcifilma fponfa mea ab ipfo die hoc kabeas 3 teneas
atque pofitdeas.
Il n’eft: donc pas étonnant qu’il n'y eût pas de
douaire pour la femme dans -le mariage fecret ou
p riv é, puifque le douaire ne pouvoit être valablement
conftitué qu’en préfence du curé , par
fon confeil & fa bénédiction.
Mais les enfans nés d'un tel mariage étoient
habiles à fuccéder à leurs pères & mères.. On
en trouve la preuve dans la cinquante-deuxième
formule de Marculfe, collection de Baluze. Dum
non efi incognitum quod feeminam a/i.quam bene in-
genuarn ad conjugium mihi foçiavi uxorem ; fed ta-
lis caufa vel témpora me oprejferunt , ut cartdlam
libelli dotis ad eàm , fie ut lex déclarât 3 minime
concejfit facere 3 unde ipfi filii mei , fecundhm legem ,
naiurales appellantur , &filios in ea generavi. Voilà
bien un mariage fecret ou privé, dénué de toutes
les folemnités de la religion} cependant le père
inftitue les enfans nés de ce mariage, fes héritiers
univerfels} il les appelle in legidmam fuccefilonem 3
dans tous fes meubles 8c immeubles, propres 8c
acquêts..
On s'éft donc étrangement mépris lorfqu'on a
cru trouver dans ces mariages .fecrets ou privés
des deux premières races, l ’origine des mariages
à la morganatique, ,ou.de, la main gauçhe, qui
font encore ufités en Allemagne entre les princes
& les femmes d’une condition inégale. Ces deux
efpèces de mariage ont bien pu être déterminés
par les mêmes motifs 5 mais leur forme & leurs
effets font abfoiumens différens.
| Dans les mariages fecrets ou privés- dés anciens
Francs, il n'y avoit point de forme, point
de folemnité religieufe : au lieu que fes mariages
à la morganatique fe célèbrent en face de l’églife.
L'époux donne la main gauche à l'êpoufe, au
lieu de la droite. Voilà la feule.différence qu’il y
a i t , quant, à la forme, entre le mariage à la
morganatique, ou de la main gauche, & les mariages
publics ou fo.lemnels. *
Le? enfans qui proviennent d’un mariage à la
morganatique , ou de la main gauche, ne fuccè*
dent point à-leur père j au lieu que les enfans
nés d’un mariage fecret ou privé, chez les; anciens
Francs, avoient la capacité de fuccéder à
tous les biens de leur père.
Dans les mariages fecrets ou privés des anciens
Francs, il n’y avoit pour l'a femme-ni. dot
ni douaire, au lieu que dans' lés mariages à 'la
morganatique ou. de la main gauche, le. prince
affigne toujours une dot ou douaire à fomépoufe
& aux enfans qui proviendront- du mariage. C eu
même de cette dot ou douaire, qu on appelloit
'autrefois morgengab > qu’eft venu le nom de mariage
à la morganatique.'Les Allemands ont emprunté
des Lombards cette efpèce de mariage.
Que fi l’on veut remonter à l’origine, 8c fuivre
ies traces des mariages fecrets ou privés, on en
trouvera la fource dans l’ancien droit romain , 8c
l’on verra que rufage s’en eft perpétué jufques
dans le, feizième fiècle. .
Les Romains avoient deux fortes de mariages,
l ’un folemnel, qu’ils appelaient mariageyrcr con-
'farredtionem , & qui donnoit à l’êpoufe le titre de
mère de famille, & le droit de communauté avec
fon mari ; l’autre dégagé de toutes formalites ;
qu’ils appelloient per ufucapionem , qui faifoit ,
comme le premier, des enfans habiles à fuccéder,
qui donnoit auffi a l’êpoufe le titre - à’ uxor 3
mais qui ne lui donnoit ni le titre de mère de
famille; ni le droit-dé communauté. Les Francs
trouvèrent cet ancien ufage des Romains établi
dans les Gaules, 8c fe l’approprièrent. Ils modifièrent
ainfî la rigueur de la loi falique, qui dé-
fendoit les méfalliances. Voilà probablement quelle
fut l’origine de la diftinâion de-s mariages publics
ou folemnels, 8cvdes mariages fecrets ou privés,
fous les deux premières races de nos rois.
•Cette diftinétiori s’eft même confervée pendant
plufieurs fiècles fous la troifième race } les mariages
par paroles de préfent étoient encore en,
ufage dans lefeizième fiècle. Théveneau rapporte
un arrêt du parlement de Paris du 4 février 1576 ,
qui déélira bon .& valable mn mariage'çontràété
pardëvàntnotaires par paroles de préfènt, quoique
noncélébfé en rfâce de l’églifèi & quoique l ’ordonnance
de Blois ait’défendu* aux Notaires de
recevoir aucunes promeffes de mariages par paroles
de préfènt : les procès-verbaux des affem-
blées du J clergé nous apprennent’ cependant que
cet ufage fubfiftoit encore en 1675 5 cé n’eft que
depuis .la/ déclaration du 15 'juin 1697., qu’on
peut dire -qu'il n’éxifte plus.
Quant au concubinage,j il (eft> certain , comme
! le, dit Britton, qu il n'y avoit point de douaire
pour la concubine. Elle n’avoit. ni titre d'époufe,
ni aucun des droits 8c des prérogatives de
ï -l’êpoufe. , . , - :r f . •; ■ -/,
Mais les enfans nés du concubinage n'étoient
l point incapables de fuccéder fous la première
race } ils l’étoiént Iorfquè Britton a é c r it , parce
qu’alors la découverte des livres de Jullinien avoit
I réformé la juri(prudence dans prefque toutes les
[ parties de. l'Europe.. Mais du temps des.Méïovin'
siens, on ne connoiffoit dans les Gaules aue 1 ancien
droit romain , & les coutumes des differentes
peuplades qui s’y étoient établies.
Or l’ancien droit romain 8c la coutume des
Francs étoient d’accord fur un premier point ; c eft
que les enfans naturels , étoient capables de recueillir
l ’entière fucceffion de leurs peres, lon-
qu’il n’y avoit pas d’enfans légitimes. On en trouve
la preu,ve dans une formule de Marculfe, que j ai
déjà citée>;> La loi & la coutume veulent, eft-
33 il dit dans cette formule, que celui qui a des
33, enfans naturels , 8c qui n’en a pas d autres ,
j > 3 puiffe librement difpofer en leur faveur de fon
33 entière hérédité »3. .
Je neconriois dans l’ancien droit romain aucune
loi qui. exclue les enfans naturels du partage de
la fucceffion de leur père, Idrfqu’il y a des enfans
légitimes} je n’en connois aucune qui ref-
treigne a urie portion le droit des enfans naturels
à' la fucceffion dé, leur père décédé intefiat 3 lorsqu’il
n’y a pas 4’enfans légitimes. Toutes les loix
qui excluent ou qui reftréignent dans ces deux
cas, font l ’ouvrage des- empereurs.
Parmi les peuples qui fortirênt des forêts de la
Germanie pour s’établir fur ies ruines de l’empire ,
je ne connois que les Lombards qui, dans le concours,
des.enfans nature,ls avec les enfans légitimes,
aient affigné aux premiers une portion moindre
que celle des enfans légitimes. Mais, ce partage ,
tout inégal qu’il eft’, fuppofe toujours, que les
enfans naturels font habiles à fuccéder , à leurs
pères.
EtThiftoire m’apprend que Clovis, quoiquebâtard
adultérin , a fuccédé feul au trône de fon-père,
parce qu’ il étoit fils unique} que T h ie r ry , que
; plbfieurs autres fils naturels des rois ont partagé
le royaume de leur père ayec les enfans
légitimes.
D ’où je crois pouvoir conclure que telle étoit
, la coutume des Francs.
Si je vois d’autres bâtards exclus de la fucceffion
, ce n’eft pas parce qu’ils étoient nés d’une
concubine, mais parée qu’ils étoient nés d’une
mère efclave. Si de ancilla habuent filios , non acci-
piant pordonem inter.fratres , ni f i tantum quantum ei
per mifericôrdiam dure voluerint fratres 3 dit la loi
des Bavarois.
Encore y avoit-ïî un moyen d’affranchir de cette
' incapacité les enfans nés d une femme efclave} &
• ce; moyen étoit pïefque toujours dans les mains
: des rois Francs. .
Il leur étoit défendu d’époufer publiquement
l’efclave d’autrui : les enfans nés d’ une efclaye, ne