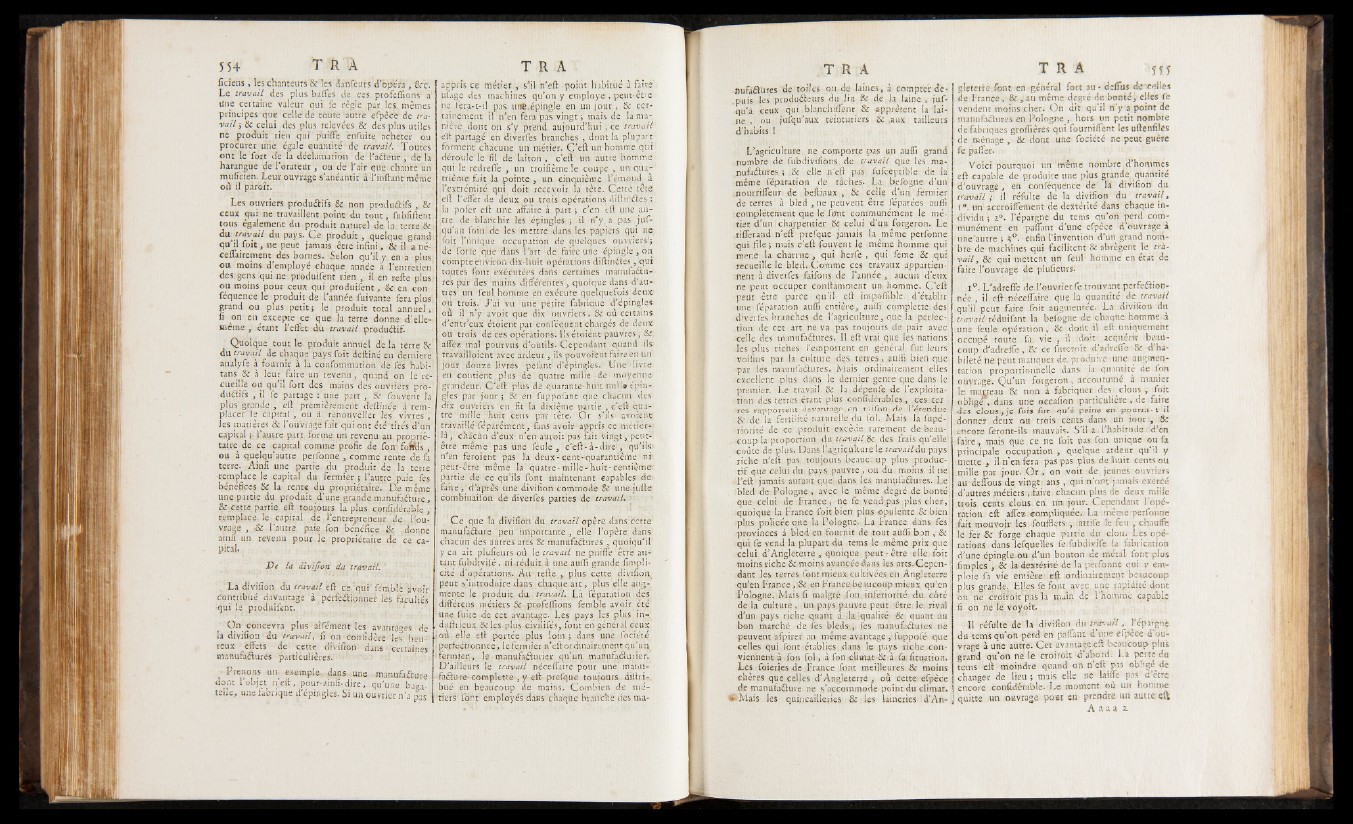
î 54 T R p.
fîcîens, les chanteurs & les danfèurs d’bp’éra , I r c l
Le travail des plus baffes de ces profeflionfi a
une certaine valeur qui le règle par les mêmes
principes que celle de toute autre efpêcë de travail
j & ce lu i. des plus relevées 3c des plus utiles
ne produit rien qui puifie en fuite, acheter ou
procurer une égale quantité de travail. Toutes
ont le fort de la déclamation de l’aéfeur dè; la
harangue deTorateür ou de l'air que chante un
muficien. Leur ouvrage s'anéantit à l'inftaiit même
où il parbît.
Les ouvriers produ&ïfs & non produ&ifs , 3c
ceux qui ne travaillent point du to u t , fubfiftent
tous également du produit naturel de la terre
du^ travail du pays. C e produit, quelque grand
qu il fo it , ne peut jamais être infini, & il a né-
ceffairement^des bornes. Selon qu'il y. en a plus:
ou moins d'employé chaque année à l'entretien
des. gens qui ne produifent rien , il en refte plus:
ou moins pour ceux qui produifent, & en con
féquence le produit de l'année fui vante fera plus,
grand ou plus petit} le produit total annuel >■
fi on en excepte ce que la terre donne d'elle-
meme , étant l ’effet du travail productif.
Quoique tout le produit annuel de la terre 3c
&u travail de chaque pays foit deftiné en derniere'
analyfe a fournir à la confommation de fés habi-
tans & n leur faire un revenu, quand on le recueille
ou qu’ il fort des mains des ouvriers' prb-'
duétifs , il fe partage une part, & fouvenc la
plüs grande eft premièrement dcûinée à remplacer
le capital, ou à renôiiveller les vivres ,
les matières & l'ou vragé fait qui ont été tirés d'un
capital ; l’ autre part forme un revenu-au propriétaire
de ce capital comme profit de fomfptfds ,
ou à quelqu’autre perfonne , comme rente de fa
terre. Ainfi une partie du produit de la terre
remplace le capital du fermier } l'aut;re paie, fe s
bénéfices & la rente d,u propriétaire. De même
unepartie du produit d’une grande.manufacture,
& :cette partie eft toujours la plus’ confidérable ,-
remplace. le capital de l’entrepreneur'de. ,1’om
vrage , 3c l ’autre paie fon bénéfice & donne
ainfi un revenu pour le propriétaire de ce capital.
De la divifion du travail. '
, La divifion du travail eft ce-'qui’ fémbîe avoir-
contribué davantage à perfectionner les facultés
■ qui lé,' produifent.
On concevra plus aifément les avantages de
la divifion du travail, fi ôn confidère les heureux
effets de cette divifion dans certaines-
manufactures particulières. wM
Prenons um exemple, dans une manufacture
dont l'objet n’eft, pour-ainfi-dire, qu'une bagatelle,
une fabrique d épingles. Si un ouvrier n’a pas
T R A
appris ce métier , s'il n’eft point habitué à faire-
ufage des machines qu’on y employé , peut-êt:e
ne-fera-t-il pas iinÊ.épingle en nn .jour , & certainement
il'n'en fera pas vingt ; mais de la manière
dont on s'y prend aujourd'hui , ce travail
élt partagé en diverfes branches , dont la plupart
forment chacune Un métier. G ’eft un homme qui
dérouie le fil de laiton, c’eft un autre homme
qui le redreffe , un troifième le coupe , un quatrième;
fu t la pointe, un cinquième l'émoud à
'l’extrémité qui doit recevoir la tête. Certé tête
•eft l’effet de deux ou trois opérations diftihéles :
;la pofer eft une affaire à part} c’en eft une autre
de blanchir les épingles > il n’y a pas juf-
; qu’au foin de les mettre dans les papiers qui ne
!fo.it l’unique occupation de quelques ouvriers'}
|d‘e force que dans l’art dé faire une épingle, ôn
compte environ dix-huit opérations diftinCtes, qui
toutes font exécutées dans certaines manufactures
par des mains différentes, quoique dans d’ aunes
un leu 1 homme en exécute quelquefois deux-
ou trois. J’ai vu une petite fabrique d’épingles
où il n’y avoit que dix ouvriers , .& où certains
d’entr’eüx étoient par cbrtféqùent chargés de deux
ou trois de ces opérations. Ils étoient pauvres, 3c
allez mal pourvus d’outils. Cependant quand ils
travailloient avec ardeur, ils pou voient faire en un'
jour douze livres pèfant d’épingiès. Une livre
en contient, plus de quatre mille de-moyenne
'grandeur. C'eft plus de quarante-huit mi II® épingles
par jour j & en fuppofant que chacun des
dix ouvriers en fit là dixième partie , c’eft quatre
mille huit cens par tête. Or s’ils'1 avoienc
travaillé féparément, fans avoir appris ce ..métier--
} l , chacun d’eux n’en auroit pas fait vingt, peut-’1
être même pas une feule, c’eft-à - dire-, qli’ils»
nfen feroient pas la deux-cent-quarantième ni'
peut-être même la quatre-mille-huit-centième'
partie de ce qu’ils font maintenant capables de-
f a i r e d ’après une divifion commode 3c une-jufte
combinaifon de diverfes parties de travail.
C e que la divifion du travail opère dans cette
manufacture 'peu importante , elle l’opère dans
chacun dès autres arts & manufactures , quoiqu’ il
y en ait plufîeurs où le travail ne puiffe être autant
fubdivifé , niaédmt à une au (fi grande fimpli-
ci.te d’opérations. Au refte , plus cette divifion,-
peut s’introduire dans chaque ar t, plus elle augmente
le produit du trav,ail. Là réparation des
différens métiers & profeflions femble avoir été
une. fuite de cet. avantage. Les pays, les plus ii||
duftrieux & les plus civilifés, font en général ceux
? où-elle eft portée plus loin} dans une, focié.té
perfectionnée, le fermier n’ eft ordinairement qu’ un
fermjer , le manufacturier qu’un manufacturier.
D ’ailleurs le travail néceftaire pour une manii-
-faCture- complette , y eft prefique toujours . di.ltri-
bué en beaucoup de mains. Combien de métiers
font employés dans chaque btaiVchè des ma-
T R A
mi fàCtüres de toiles ou de laines, à compter de-
.puis les producteurs du Jiu & de la laine, juf-
qu’à ceux qui blanchiffent & -apprêtent la laine
, ou jufqu’aux teinturiers 5c ,aux tailleurs
d’habits !
L’agriculture ne comporte pas un aufli grand
nombre de fubdivifiôns de travail que les manufactures
; 3c elle n eft pas lufeeprible de la
même réparation de tâches. La befogne d’un
nourriffeur de beftiaux , 3c celle d’un fermier
de terres à bled , ne peuvent être réparées aufli
complètement que le font communément le méfier.
d’un charpentier & celui d’un forgeron. Le
-tifferand n’eft prefque jamais la même perfonne
qui file } mais c’eft fouvent Je .même homme qui
mer.ë la charrue , qui herfe , qui feme 3c qui
recueille le bled. Comme .ces travaux appartiennent
à diverfes faifons de l’année, aucun d’eux
ne peut occuper conftamment un homme. C'eft
peut être parce qu’il eft impoflible d'établir
line réparation aufli entière, aufli complette. des;
diverfes branches de l'agriculture, que la per.fec-i
.tien de cet arc. ne va pas toujours de-pair avec;
celle des manufactures. Il eft vrai que les nations
les plus riches l’emportent en général fur leurs
voifins par la culture dçs terres., aufli bien que
par lès manulâCtures. Mais ordinairement .elles
excellent plus dans le dernier genre que dans le
premier. Le travail 3c la dépeufe de l’exploitation
des terres étant plus eonfîdérables , . ces ter
res rapportent davantage .en raifon de J’étenduei
& de la fertilité nature lie du fo l. Mais Iafiupé-
riotité de ce produit excède rarement de beaucoup
la proportion du travail &c des trais qu’elle1
coûte de plus. Dans l’agriculture le travail3u pays
riche n’eft pas, toujours beaucoup plus.produc-,
rif que celui du pays pauvre , ou du moins il ne,
l’elt jamais autant que;.dans les manufactures..Le'
bled de Pologne, avec le même degré de bonté j
que celui de France, ne fe ven,d,püs plus cher,|
quoique la France, foit bien, plus opulente 5c bien
plus policée que la Pologne. La France dans fés
provinces à bled en fournit de tout aufli bon , & '
qui fe vend la plupart du tems le même prix que
celui d’Angleterre, quoique peut-être elle foit
moins riche 3c moins avancée dans les arts. Cependant
les terres lpnt.mieux cultivées, en Angleterre
qu’en France , ’&,en F rance beaucoup mieux qu'en
Pologne. Mais fi malgré fon infériorité, du côté
de la culture , un pays pauvre peut. être, le:; rival
d’un pays riche quant à la, i quali té 3c quant au
bon marché de fes blêds., fes manufactures ne
peuvent afpirer. an même avantage y fuppofé que
celles qui font‘établies. .dans le pays riche .conviennent
à fon fol-, à fort,climat & à,fa;ficuation.
Les foieries de ..France font meilleures & moins
chères que celles d’ Angleterre , où cette:efpèce
de manufacture ne s’accommode point du climat.
^M ais les quincailleries & les laineries ; d’An-
T R A m
gîeterre font: en général fort au - deffus de celles
de France , & au même degré de bonté j elles fe
vendent moins‘.cher. Oh dit qu’il n’y a point de
manufactures en Pologne , hors un petit nombre
de fabriques groflières qui fourniffent les uftenfijes
de ménage, & dont une fociété ne peut guère
fe paffer.
Voici pourquoi un même nombre d’hommes
eft capable de produire une plus grande, .quantité
d’ouvrage j en conféqüénce de la divifion du
travail ; il réfulte de la divifion du travail,
i®. un accroiffement de dextérité dans chaque individu
} i° . l’épargne du tems qu’on perd communément
en panant d’une efpèce d’ouvrage à
une'autre ; y°. enfin l’invention d’un grand norh-
bre de machines qui facilitent & abrègent le trà-
vail, 3c qui mettent un feul homme en état de
faire l’ouvrage de plufieurs.
I 9. L’adreffe de.l’ouvrier fe trouvant perfectionnée
, il eft néceftaire que la quantité de travail
qu’il peut faire foit augmentée. La divifion du
travail réduifant la befogne de chaque homme à
une feule opération , ■ & . dont il eft uniquement
occupé toute fa vie , il do-K^ acquérir beaucoup
cfadreffe , 3c ce furcroît d’adreffe 3c d’habileté
ne peut maiiquer de. produire - une augmentation
proportionnelle dans la quantité de fon
ouvrage. Qu’un forgeron, accoutume a manier
le matteau & non à fabriquer des clous., foit
oblige*, dans une o.ccafion particulière , de faire
des clous y je fuis fur qu’à peine en ppurra -t il
donner deux ou trois cènts dans un jo u r , 3c
encore feront-ils mauvais.. S’ il a Fhabitude d’en
faire, mais que ce ne foit pas fon unique ou fa
principale occupation , quelque ardeur qu’ il y
mette , il n en fera pas pas plus de huit cents ou
.mille par jour. O r , on voit de jeunes ouvriers
au deffous de vingt; ans , qui n’ont jamais exercé
d’autres métiersfaire chacun,plus de deux mille
trois cents clous en. un jour. Cependant l ’opération
eft affez compliquée. La même perfonne
fiait mouvoir les fouflkts , attife le feu , chauffe
le fer 3c forge chaque partie du clou. Lés opérations
dans lefquelles fe fubdivifé la fabrication
d’ une épingle-ou d’un bouton de métal font plus
Amples , & la dextérité de la perfonne qui y emploie
fa vie entière , eft ordinairement beaucoup
plus grande. Elles fe font avec, .une rapidité dont
On ne crdirqit pa$ la main de l’hon^me capable
fi on ne le voyoit.
Il réfulte de la divifion du tra v a il, l’épargne
du tems qu’on perd en paffant d une efpece d ouvrage
a une autre. C et avantage eft beaucoup plus
grand qu’on ne le croiroit d abord. La perte du
tems tft moindre quand on n’eft pas obligé de
changer de lieu ; mais elle ne laifTe pas d'être
encore confidérable-Le moment ou un homme
quitte un ouvrage pour en prendre un autre eft