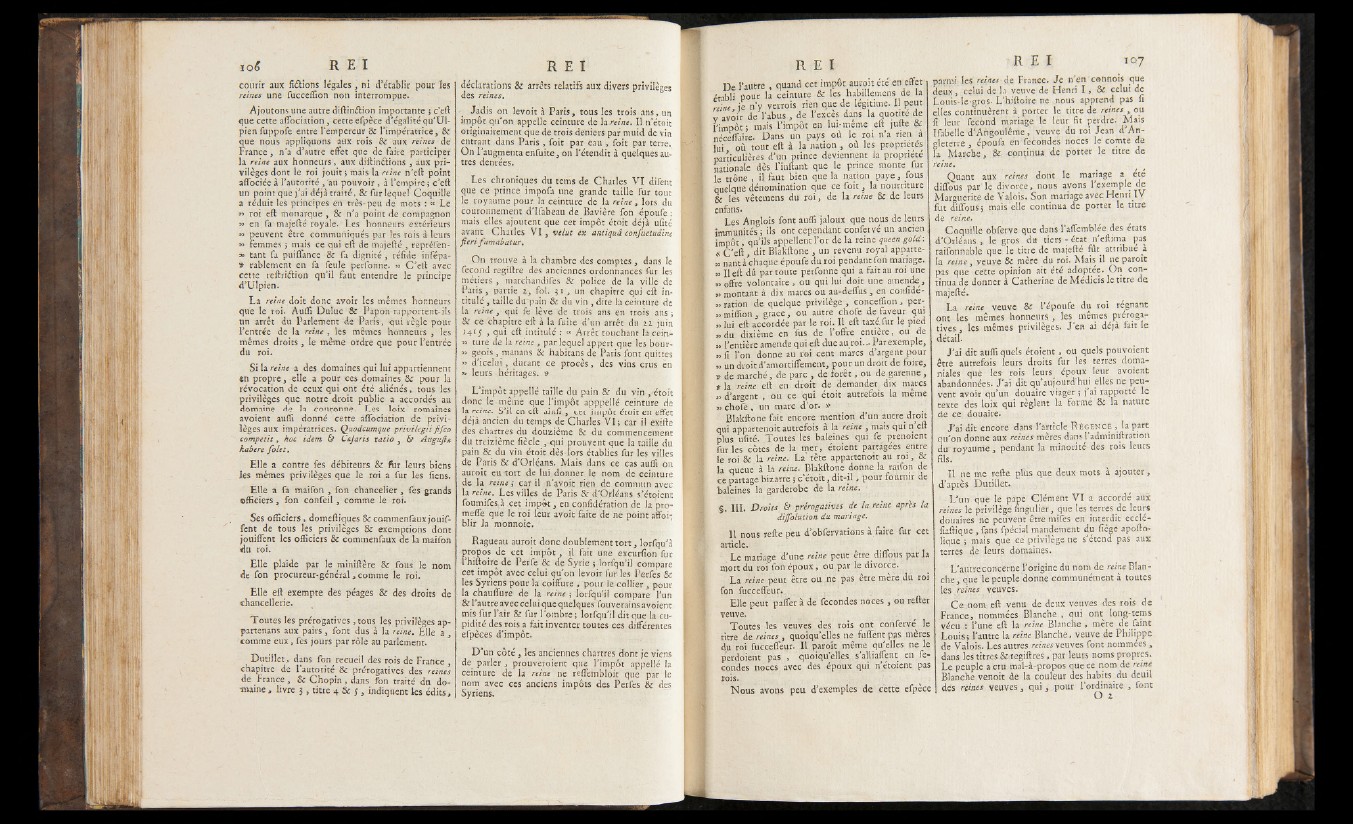
•ïq6 R E I
courir aux fixions légales, ni Rétablir pour les
reines une fucceflion non interrompue.
Ajoutons une autre diftin&ion importante ; c’eft
que cette affociation , cette efpèce d'égalité qu'Ul-
pien fuppofe entre l’empereur & l'impératrice, &
que nous appliquons aüx rois & aux reines de
France, n’a d'autre effet que de faire participer
la reine aux honneurs, aux diftin&ions , aux privilèges
dont le roi jouit; mais la reine n’eft point
affociée à l’autorité /au pouvoir , à l'empire} c'eft
un point que j’ai déjà traité, & fur lequel Coquille
a réduit les principes en très-peu de mots : « Le
» roi eft monarque , & n’a point de compagnon
» en fa majefté royale. Les honneurs extérieurs
» peuvent être communiqués par les rois à leurs
» femmes ; mais ce qui eft de majefté , repréfen-
» tant fa puiflance &: fa dignité, réfide infépa-
* rablement en fa feule perfonne. *> C ’eft avec
cette reftri&ion qu’il faut entendre le principe
d’Ulpien.
La reine doit donc avoir les mêmes honneurs
que le roi. Aufli Duluc & Papou rapportent-ils
un arrêt du Parlement de Paris, qui règle pour
l ’entrée de la reine , les mêmes honneurs , les
mêmes droits, le même ordre que pour l’entrée
du roi.
Si la reine a des domaines qui lui appartiennent
en propre , d i e a pour ces domaines & pour la
révocation de ceux qui ont été aliénés, tous les
privilèges que notre droit public a accordés au
domaine de la couronne. Les loix romaines
avoient auflî donné cette affociation de privilèges
aux impératrices. Quodcumque privilegiififeo
competit, hoc idem & Cs.Ja.ns ratio 3 & Augufis,
kabere folet.
Elle a contre fes débiteurs & fur leurs biens
les mêmes privilèges que le roi a fur les liens.
Elle a fa maifon , fon chancelier, fes grands
officiers y fon confeil, comme le roi.
Ses officiers, domeftiques &commenfauxjouif-
fent de tous les privilèges & exemptions dont
jouiffent les officiers & commenfaux de la maifon
du roi.
Elle plaide par le miniftère & fous le nom
de fon procureur-général, comme le roi.
Elle eft exempte des péages & des droits de
chancellerie.
Toutes les prérogatives ,tous les privilèges ap-
partenans aux pairs , font dus à la reine. Elle a ,
comme eux, fes jours par rôle au parlement.
Dutillet, dans fon recueil des rois de France ,
chapitre de l’autorité & prérogatives des reines
de France, & Chopin, dans fon traité du dom
in e , livre 3 , titre 4 & S , indiquent les édits.
R E I
déclarations 8c arrêts relatifs aux divers privilèges
des reines.
À Jadis on levoit à Paris, tous les trois ans, un
im pôt qu'on appelle ceinture de la reine. Il n’étoit
originairement que de trois deniers par rnuid de vin
entrant dans Paris , foit par eau , foit par terre.
On l ’augmenta enfuite, on l'étendit à quelques autres
denrées.
Les chroniques du tems de Charles V I difent
que ce prince impola une grande taille fur tout
le royaume pour la ceinture de la reine , lors du
couronnement d’ Ifabeau de Bavière fon époufe.:
mais elles ajoutent que cet impôt étoit déjà ufité
avant Charles VI , velut ex antiquâ confuetudinc
fieri famabatur.
On trouve à la chambre des comptes, dans le
fécond regiftre des anciennes ordonnances fur les
métiers , tnarchandifes & police de la ville de
Paris, partie 2, foh 3 1 , un chapitre qui eft intitulé
, taille du pain & du vin , dite la ceinture de
la reine , qui fe lève de trois ans en trois ans j
& ce chapitre eft à la fuite d’un arrêt du 22 juin
14*5 3 qui eft intitulé : c< Arrêt touchant la ceini-
» ture de la reine , par lequel appert que les bour-
» geois , manans & habitans de Paris font quittes
w d’icelui, durant ce procès, des vins crus en
» leurs héritages. »
L'impôt appellé taille du pain & du vin , ‘étoit
donc le même que l’impôt apppellé ceinture de
la reine. S’il en eft ainfi , cet impôt étoit en effet
déjà ancien du temps de Charles V I ; car il exifte
des Chartres du douzième & du commencement
du treizième fiècle , qui prouvent que la taille du
pain & du vin étoit dès lors établies fur les villes
de Paris & d'Orléans. Mais dans ce cas auflî on
auroit eu tort de lui donner le nom de ceinture
de la reine ; car il n’avoit rien de commun avec
la reine. Les villes de Paris & d’Orléans s’étpient
foumifes,à cet impôt, en confédération de Ja pro-
meflfe que le roi leur avoit faite de né point affoi-
blir la monnoie.
Ragueau auroit donc doublement to r t, lorfqu'à
propos de cet imp ôt, fait une excurfîon fur
l’hiftoire de Perfe & de Syrie ; lorfqu’il compare
cet impôt avec celui qu’on levoit fur les Perfes &
les Syriens pour la coiffure, pour le collier, pour
la chauffure de la reine ; lorfqu?il compare l’un
& l’autre avec celui que quelques fouverains avoient
mis fur l’air & fur l’ombre; lorfqu’il dit que la cupidité
des rois a fait inventer toutes ces différentes
efpèces d’impôt.
D'un c ô té , les anciennes Chartres dont je viens
de parler, proUveroient que l’impôt appellé la
ceinture de la reine ne reffembloit que par le
nom avec ccs anciens impôts des Perfes & des
Syriens.
R E I
De l’autre , quand cetimpôt aurait été en effet1
établi pour la ceinture & les habilleraens de U
reine je n’y verrois rien que de légitime. Il [>eut
v avoir de l’abus, de l’ excès dans la quotité de
îimpbt j mais l'impôt en lui-même eft jufte &
néceffaire. Dans un pays où le roi n'a rien a
lui où tout eft à la nation , où les propriétés
particulières d'un prince deviennent la propriété
nationale dès l'inftant que le prince monte fur
le trône , il faut bien que la nation paye, fous
quelque dénomination que ce foit , la nourriture
& les vêtemens du ro i, de la reine & de leurs
enfans.
Les Anglois font suffi jaloux que nous de leurs
immunités ; ils ont cependant confervé un ancien.
impôt, qu’ils appellent l’or de la reine queen gold :
« C ’eft, dit Blakftône , un revenu royal apparte-
» nant à chaque époufe du roi pendant fon mariage.
» Il eft dû partoute perfonne qui a fait au roi une
„ offre volontaire, ou qui lui dojt une amende,
» montant à dix marcs ou au-defîùs, en confide-
» ration de quelque privilège , conceffion , per-
» miffion grâce , ou autre chofe de faveur qui
»lui eft accordée par le roi. Il eft taxé.fur le pied
» du dixième en fus de l’offre entière, ou de
» l’entière amende qui eft due au roi... Par exemple,
» fi l’on donne au roi cent marcs d’argent pour
» un droit d’amorqffement, pour un droit de foire,
» de marché, de parc , de fo rê t, ou de.garenne,
»la reine eft en droit de demander dix marcs
» d’argent > ou ce qui etoit autrefois la meme
» chofe, un marc d ’or. »
Blakftône fait encore mention d’ un autre droit
qui appartenoit autrefois a la reine , mais qui n eft
plus ufité. Toutes les baleines qui fe {irenoient
fur les côtes de la mer, étoient partagées entre
le roi & la reine. La'tête appartenoit au roi , &r
la queue à 1a reine. Blakftône donne la raiCon de
ce partage bizarre, c’étoit, d it- il, pour fournir de
baleines la garderobe de la reine.
§ . III. Droits & prérogatives de la reine après la
dijfplution du mariage.
H nous refte peu d’obfervations à faire fur cet
article.
Le mariage d’une reine peut être diffous par la
mort du roi fon epoux, ou par le divorce.
La reine peut être ou ne pas être mère ,du roi
fon fucceffeur.
Elle peut paffer à de fécondés noces , ou relier
veuve.
Toutes les veuves des rois ont cohfervé le
titre de reines, quoiqu’elles ne fuffent pas meres
du roi fucceffeur. Il paraît même qu’elles ne le
perdoient pas , quoiqu’elles s’alliaffent en fécondés
noces avec des époux qui n’étoient pas
rois.
Nous avons peu d’exemples de cette efpèce
R E I 107
parmi les reines de France. Je n’en cannois que
deux, celui de la veuve de Henri I , & celui de
Louis-le gros. L’hiftoire ne nous apprend pas fi
elles continuèrent à porter le titre de reines, ou
fi leur fécond mariage le leur fit perdre. Mais
Ifabelle d’Angoulême, veuve dura i Jean d’ Angleterre
, époufa enTecondes noces le comte de
la Marche, & continua de porter le titre de
reine.
Quant aux reines dont le mariage a ete
diflbus par' le divorce, nous ayons l’exemple de
Marguerite de Valois. Son mariage avec Henri IV
fut diffous ; mais elle continua de porter le titre
de reine.
Coquille obferve que dans l’affemblée des états
d’Orléans * le gros dtr tiers - état n eftima pas
raifonnable que le titre de majefte fût attribue
la reine, veuve & mère du roi. Mais il ne paroit
pas que cette opinion ait été adoptée. On continua
de donner à Catherine de Medicis le titre de
majefté.
La reine veuve & l’époufe du roi régnant
ont les mêmes honneurs, les^ mêmes prérogatives
, les mêmes privilèges. J'en ai déjà fait le
détail.
J’ ai dit auflî quels étoient, ou quels pouvoient
être autrefois leurs droits fur les terres domaniales
que les- rois leurs époux leur avoient
abandonnées. J’ai dit qu'aujourd hui elles ne Peuvent
avoir qu'un douaire viager ; j ai rapporté le
texte des loix qui règlent la forme & la nature
de ce douaire.
J’ ai dit encore dans l’article Régence , la part
qu'on donne aux reines mères dans l’adminiftration
du royaume, pendant la minorité des rois leurs
fils.
Il ne me refte plîis que deux mots à ajouter,
d’après Dutillet.
L'un que le pape Clément V I a accordé aux
reines le privilège fingulier, que les terres de leurs
douaires ne peuvent être mifés en interdit ecclé-
fiaftique, fans fpécial mandement du fiège apofto-
lique ; mais que ce privilège ne s'étend pas aux
terres de leurs domaines.
L'autre concerne l’origine du nom de reine Blanche,
que le peuple donne communément à toutes
les reines veuves.
C e nom eft venu de deux veuves des rois de
France, nommées Blanche , qui ont long-tems
vécu : l'une eft la reine Blanche , mère de faint
Louis; l’autre la reine Blanche, veuve .de Philippe
de Valois. Les autres reines veuves font nommées,
dans les titres &<regiftres, par leurs noms propres.
Le peuple a cru mal-à-propos que ce nom de reine
Blanche venoit de la couleur des habits du deuil
dés reines veuves, q u i, pour l ’ordinaire , font
O i