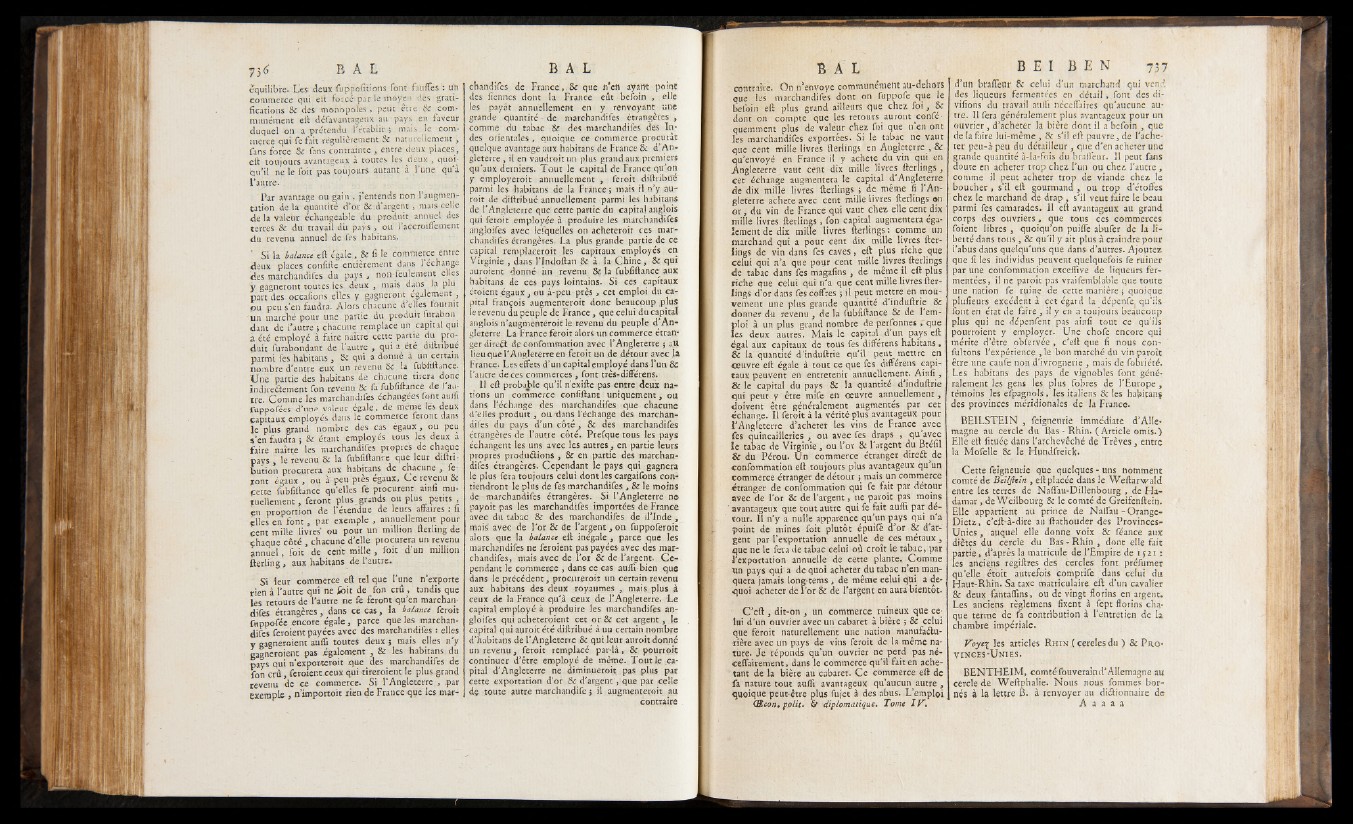
7 3 ^ B A L
équilibre. Les deux fuppofîtions font fuiftes : un
commerce qui eft forcé'par le moyen dès gratifications
8e des monopoles., peut être & conv
munément eft défavantageux au pays en faveur
duquel on a prétendu rétablir > mais, le commerce
qui fe fait régulièrement 8e naturellement >
fans force & fans contrainte , entre deux places,
eft toujours avantageux a toutes les deux , quoiqu'il
ne le foit pas toujours autant a 1 une qu a
l'autre.
Par avantage ou gain . j’entends non l'augmentation
de la quantité d'or & ; d'argent, mais celle
d elà valeur échangeable du. produit annuel des
terres 8e du travail du pays , ou l’accroiflement
du revenu annuel de fes habitans.
' Si la balance eft égale., & fi le commerce entre
deux places confifte entièrement dans l’échange
ides marchandifes du pays , non-feulement cl les
y gagneront toutes les deux , mais dans la plu
part des occafions elles y gagneront^ egalement ,
pu peu s’en faudra. Alors chacune d elles fournit
un marché pour une partie du produit furabon
dant de l’ autre > chacune remplace un capital qui
à été employé à faire naître cette partie du produit
furabondant de l'autre , qui ete diitribue
parmi fes habitans , 8c qui a donne à un certain
nombre d’entre eux un revenu 8e la fubfiftance.
Une partie des habitans de chacune tirera donc
indirectement fon revenu 8e fa fubfiftance de 1 autre.
Comme les marchandifes échangées font aufti
fuppofées d’une valeur .égale, de même les deux
Capitaux employés dans le commerce feront dans
le plus grand nombre des cas égaux, ou peu
s’en faudra , 8e étant employés tous les deux à
faire naître les marchandifes propres de chaque
p ay s , le revenu & la fubfiftance que leur diftri-
bution procurera aux habitans de chacune , feront
égaux , ou a peu près égaux. C e revenu &
perte fubfiftance quelles fe procurent ainfi mutuellement,
feront plus, grands ou plus _ petits ,
pn proportion de 1 etendue de leurs affaires i fi
plies en font , par exemple , annuellement pour
cent mille livres ou pour un million fterling de
çhaque côté , chacune d’elle procurera un revenu
Annuel, foit de cent mille , foit d’un million
fterling f aux habitans de l’autre.
Si leur commerce eft tel que l’une n’exporte
rien à l’autre qui ne foit de fon c rû , tandis que
les retours de l’autre ne fe feront qu’en marchandifes
étrangères, dans ce cas, la balancé feroit
fnppofée encore égale, parce que les marchandifes
feroient payées avec des marchandifes : elles
y gagneroient aufti toutes deux 5 mais elles n’y
gagneroient pas .également , & les habitans du
pays qui n’exporteroit que des marchandifes de
fon crû, feroient ceux qui tireroient le plus grand
revenu de ce commerce. Si l’Angleterre , .par
exemple, n’importoit rien de France que les mar-
B A L
çhandifes de France ,. & que n'en ayant point
des fiennes dont la France eût befoin , elle
les payât annuellement en y renvoyant une
grande quantité - de marchandifes étrangères ,
comme du tabac 8e des marchandifes des Indes
orientales, quoique ce commerce procurât
quelque avantage aux habitans de France 8e d’Angleterre
, il en vaudroit un plus grand aux premiers
qu’aux derniers. Tout le capital de France qu’on
y employeroit annuellement , feroit diftribué
parmi les habitans de la France ; mais il n’y au-
roit de diftribué annuellement parmi les habitans
de l’Angleterre que cette partie du capital anglois
qui feroit employée à produire les marchandifes
angloifes avec lefquelles on acheteroit ces marchandifes
étrangères- La plus grande partie de ce
capital remplaceroit les capitaux employés en
Virginie , dans l’Indoftan 8e à la Chine, 8e qui
auroient donné im revenu & la fubfiftance aux
habitans de ces pays lointains. Si ces capitaux
étoient égaux, ou à-peu près , cet emploi du capital
françois augmenteroit donc beaucoup .plus
le revenu du peuple de France, que celui du capital
anglois n’augmentéroit le revenu du peuple d’Angleterre
La France feroit alors un commerce étranger
direct de confommation avec l’Angleterre 5 au
lieu que l’Angleterre en feroit un de détour avec la
France- Les effets d’un capital employé dans l’un &
l’autre de ces commerces, font très-difïer.ens,
Il eft probable qu’il n’exifte pas entre deux nations
un commerce confiftant uniquement, ou
dans Rechange des marchandifes que chacune
d’elles produit, ou 'dans l’échange des marchandifes
du pays d’un c ô té , & des marchandifes
étrangères de l’autre côté. Prefque tous les pays
échangent les uns avec les autres, en partie leurs
propres productions 3 8e en partie des marchandifes
étrangères. Cependant le pays qui gagnera
le plus fera toujours celui dont les cargaiCbns contiendront
le plus de fes marchandifes , & le moins
de marchandifes étrangères. Si l’Angleterre ne
payoit pas les marchandifes importées de France
avec du tabac 8e des marchandifes de il’Inde ,
mais’ avec de l ’or & de l’argent, on fuppoferoit
alors que la balance eft inégale parce que les
marchandifes ne feroient pas payées avec des marchandifes,
mais avec de l’or 8e de l’argent. C e pendant
le commerce , dans ce cas aufti bien que
dans le précédent, procureroit un certain revenu
aux habitans des deux royaumes , mais plus à
ceux de la France qu’ à ceux de l’Aqgleterre. L e
capital employé à produire les marchandifes angloifes
qui acheteroient cet or & çet argent, le
capital qui ayroit été diftribué à un certain nombre
d’habitaos de l’Angleterre Se qui leur auroit donné
un revenu 3 feroit remplacé par-là, & pourroit
continuer d’être employé de même. Tout le capital
d’Angleterre ne diminyeroit pas plus par
cette exportation d’or & d’argent, que par celle
d.ç toute autre marchandife j il augmenteroit au
contraire
B A L
contraire. On n'eiwoye communément au-dehors
que fes marchandifes dont on fuppofe que le
befoin eft plus grand ailleurs que chez; fo i , &
dont on compte que les retours auront confe-
quemment plus de valeur chez foi que n-en ont
les marchandifes exportées- Si le tabac ne vaut
que cent mille livres fteriings en Angleterre , &
qu’envoyé en France il y acheté du vin qui en
Angleterre vaut cent dix mille livres fteriings,
cet échange augmentera le capital d Angleterre
de dix mille livres fteriings j de même fi l’Angleterre
acheté avec cent raille livres fteriings on
o r , du vin de France qui vaut chez elle cent dix
mille livres fteriings , fon capital augmentera également
de dix mille livres fteriings : comme un
marchand qui a pour cent dix mille livres fter-
lings de vin dans fes caves, eft plus riche que
celui qui n’a que pour cent mille livres fteriings
de tabac dans fes magafîns , de même il eft plus
riche que celui qui n’ a que cent mille livres fter-
lings d'or dans fes coffres j il peut mettre en mou-
vement une plus grande quantité d’induftrie 8e
donner du revenu , de la fubfiftance & de 1 emploi
à un plus grand nombre de personnes rque
les deux autres. Mais le capital d’un pays eft
égal aux capitaux de tous fes différens habitans,
8e la quantité d’induftrie qu’il peut mettre en
oeuvre eft égale à tout ce que fes différens capitaux
peuvent en entretenir annuellement. Ainfi,,
& le capital du pays 8e la quantité d’induftrie
qui peut y être mife en oeuvre annuellement,
doivent être généralement augmentés par cet
échange. Il feroit à la vérité plus avantageux pour
l’ Angleterre d’acheter les vins de France avec
fes quincailleries , ou avec fes draps , qu’avec
le tabac de Virginie, ou l’or & l’argent du Brefil
& du Pérou. Un commerce étranger direél de
confommation eft toujours plus avantageux qu’un,
commerce étranger de détour > mais un commerce
étranger de confommation qui fe fait par détour
avec de l’or & de l’argent, ne paroît pas moins
avantageux que tout autre qui fe fait aufti par détour.
Il n'y a nulle apparence qu’un pays qui jn’a
point de mines foit plutôt épuifé a’or 8e d’argent
par l’exportation annuelle de ces métaux,
que ne le fera de tabac celui où croît le tabac, par
l ’exportation annuelle de cette plante. Comme
un pays qui a de quoi acheter du tabac n’en manquera
jamais Iong-tems, de même celui qui a de-,
quoi acheter de l'or 8e de l’argent en aura bientôt.
C ’eft , dit-on , un commerce ruineux que celui
d’un ouvrier avec un cabaret à bière j & celui
que feroit naturellement une nation manufacturière
avec un pays de vins feroit de la même nature.
Je réponds qu’ un ouvrier ne perd pas né-
ceflairement, dans le commerce qu’il fait en achetant
de la bière au cabaret. C e commerce eft de
fa nature tout aufti avantageux qu’auçun autre,
quoique peut-être plus fujet à des abus. L ’emploi
(Econ. polit. & diplomatique. Tome I F .
B E I B E N 737
d'un brafteur & celui d’un marchand qui vend
des liqueurs fermentées en détail, font des di-
vifions du travail aufti néceflaires qu’aucune autre.
Il fera généralement plus avantageux pour un
ouvrier, d’acheter la bière dont il a befoin , que
de la faire lui-même , & s’ il eft pauvre, de l’acheter
peu-àpeu du détailleur , que d’en acheter une
grande quantité à-la-fois du brafleur. Il peut fans
doute en acheter trop chez l ’un ou chez l’autre ,
comme il peut acheter trop de viande chez le
boucher, s’ il eft gourmand , ou trop d’étoffes
chez le marchand de drap , s’ il veut faire le beau
parmi fes camarades. Il eft avantageux au grand
corps des ouvriers, que tous ces commerces
foient libres, quoiqu’on puifle abufer de la li-
bet té dans tous, 8e qu’il y ait plus à craindre pour
l’abus dans quelqu’ uns que dans d’autres. Ajoutez
que fi les individus peuvent quelquefois fe ruiner
par une confommation exceflive de liqueurs fermentées,
il ne paroît pas vraifemblable que toute
une nation fe ruine de cette manière j quoique
plufieurs excédent à cet égard la dépenfe qu’ ils
font en état de faire , il y en a toujours beaucoup
plus qui ne dépenfent pas ainfi tout ce qu’ils
pourroient y employer. Une chofe encore qui
mérite d’être obfervée , c’ eft que fi nous con-
fultôns l’expérience ,1e bon marché du vin paroît
être une caufe non d’ivrognerie , mais de fobriété,
Les habitans' des pays de vignobles font généralement
les gens les plus fobres de l’Europe,
témoins les espagnols, les italiens & les habitanç
des provinces méridionales de la France.
BEILSTEIN , feigneurie immédiate d’Allemagne
au cercle du Bas - Rhin. (Article omis.)
Elle eft fituée dans l’archevêché dç Trêves , entre
la Mofelle 8e le Hundfreick.
Cette feigneurie que quelques - uns nomment
comté de Beilfttin , eft placée dans le Weftarwald
entre les terres de NafTau-Dillenbourg , de Ha-
damar, de Wéilbourg 8e le comté de Greifenftein.
Elle appartient au prince de Nalfau - Orange-
Dietz, c’eft-à-dire au ftathouder des Provinces*-
Unie s , auquel elle donne voix 8e féance aux
diètes du cercle du Bas - Rhin , dont elle fait
partie, d’après la matricule de l’Empire de 1 f 21 :
les anciejis regiftres des cercles font préfumet
qu’elle étôit autrefois comprife dans celui du
Haut-Rhin. Sa taxe matriculaire eft d’un cavalier
8e deux fantaflins, ou de vingt florins en argent.
Les anciens règlemens fixent à fept florins chaque
terme de fa contribution à l’entretiçn de la
chambre impériale.
Voyt\ les articles R hin .( çerelçs du ) 8e Pr q «
v in c e s -Unies.
BENTHE IM, comté fouveralnd’Allemagne au
cercle de Weftphalie. Nous nous fommes bornés
à la lettre B. à renvoyer au di&ionnaire de
A a a a a