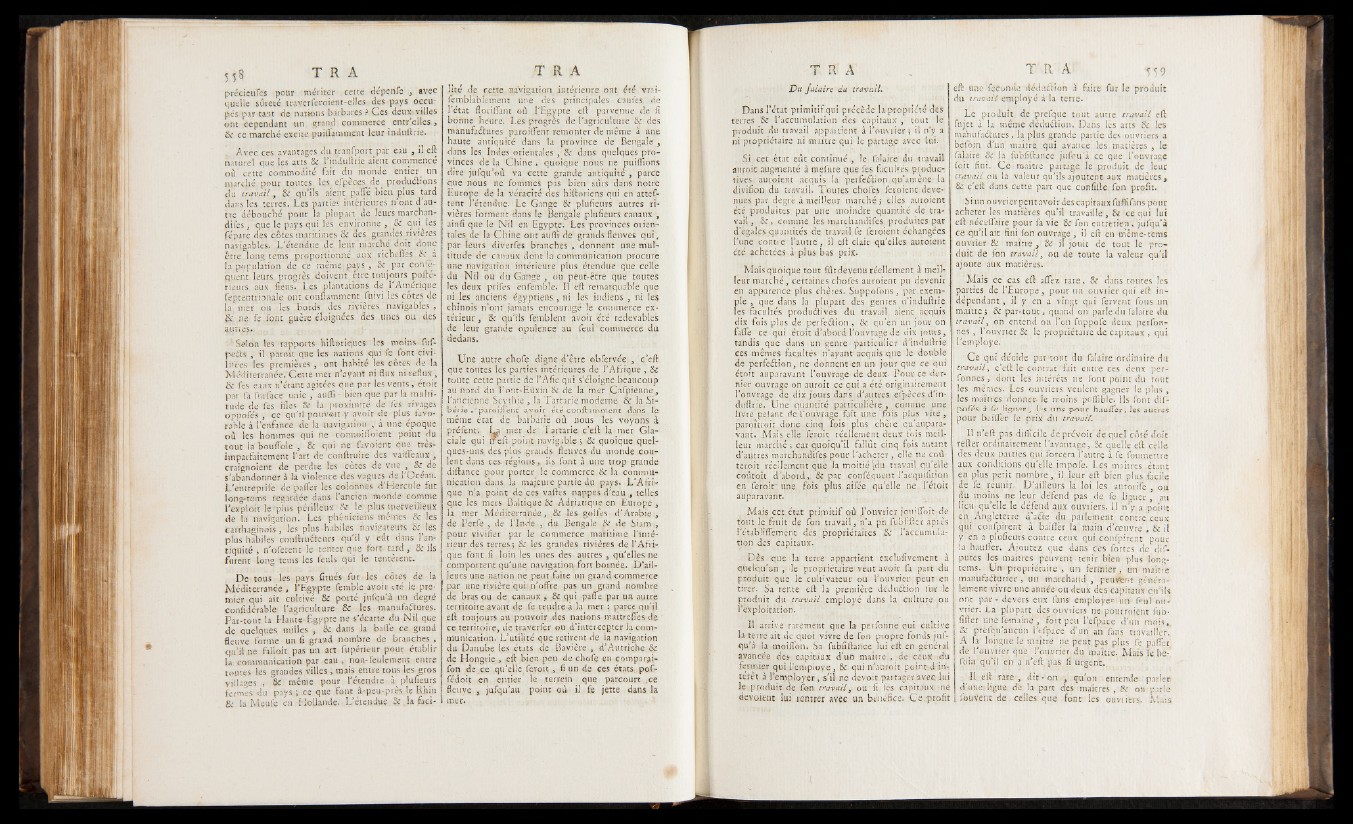
précieufes polir mériter cette dépenfe g avec
quelle sûreté travçrleroient-elJes des pays occupés
par tant de nations barbares ? Ces deux-villes
ont cependant un grand commerce entr,elles..,
8c ce marché excite puiliamment leur induftrie.
' Avec ces avantages du tranfport par eau , il eft
naturel que les arts & l’induftrie aient commencé
où cette commodité fait du monde entier un
marché pour toutes, lçs efpèc^s de produ&ions
du travail, 8c qu'ils aient païle bien plus tard
dans les terres. Les parties intérieures n’ont d autre
débouché pour la plupart de leurs marchan-
di f esque le pays qui les environne, 8c quMe.s
féparc des côtes maritimes & des gtandes rivieres
navigables. L ’étendue de leur marché' doit donc
être long tems proportionné . aux richefies & à
la population de ce même;pays, 8c par çonf£-
qtient leurs progrès doivent être toujours pofté-
rieurs aux liens. Les plantations de f Amérique
feptentrionale ont conftamment fuivi les côtes de
la mer ou les bords des rivières navigables ,
& ne fe.font guère éloignées des unes ou des
autres.. ,,
' Selon les rapports hiftoriques les moins Tuf-
pedS: j il paraît que les nations qui fe (ont civi-
filées les premières , ont habité les côtes de la
Méditerranée.'Cette-mér n'ayant ni flux ni reflux ,
& fes eaux n'étant agitées que par les vents étoit
par fa furface unie , suffi - bien que par la multitude
de fes ifles 8c la proximité de Tes rivages
oppofés , ce qu’il pouvoir y avoir de plus favorable
à 1 enfance de la navigation y à une époque
où les hommes qui ne connoilToient point du
tout la bouffoie , 8c qui ne favoient que- tres-
imparfaitement l’art de conftruire des vaiffeaux ,
craignoient de perdre les côtes de vue , & de
s’abandonner à la violence des vagues de l’Océan.
L ’entreprife de paffer les colonnes d’Hercule fut
long-téms regardée dans l’ancien -monde- comme
l ’exploit le'plus périîlëlt-x 8c le plus merveilleux
de la navigation.- Les plieniciens m èm.e$ & les
carthaginois, les plus habiles navigateurs StJ lés
plus habiles conftrudeurs qu’ il y eût dans 1 antiquité
, n’oferent le tenter que fort tard, 8c ils
furent long tems les feuls qui le tentèrent.
De tous les pays fîmes fur les côtes de la
Méditerranée , l’Egypte femble avoir cté le premier
qui ait cultivé & porté jufqu’ à un degré
confidérable l'agriculture 8c les manufactures.
Par-tout la Haute-Egypte ne s'écarte du Nil que
de quelques milles , 8c, dans la balfe ce grand
fleuve forme un fi graad nombre de branches ,
qu’il ne falloir pas un art fupérieur pour établir
la communication par eau , non-feulement entre
toutes les grandes villes, mais entre tous les gros
villages , & même pour l’ étendre à- piufieurs
fermes du pays; ce que font à-peu-près le Rhin
& la Meule en Hollande. L ’étendue .& ,1a faci-
Ilté de cette navigation intérieure ont été vrai-
femblablement une des principales caules de
l’état fl.o ri fiant ou l’Egypte efi parvenue de fi
bonne heure. Les progrès de l’agriculture 8ç des
manufactures paroilfent remonter de même à une
haute antiquité dans la province de Bengale ,
dans les Indes orientales , & dans quelques provinces
de la C h in e , quoique nous ne purifions
dite jufqu’où va cette grande antiquité', parce
que nous ne fommes pas bien sûrs dans notrè
Europe de la véracité des hiftoriens qui en attestent
l’étendue. Le Gange & piufieurs autres rivières
forment dans le Bengale piufieurs canaux ,
ainfi que le Nil en Egypte. Les provinces orientales^
de' la Chine ont aufiî de grands fleuves qui,
par leurs diverfes branches , donnent une multitude
de canaux dont la communication procure
une navigation intérieure plus étendue que celle
du Nil ou du Gange , ou peut-être que toutes
les deux prifes enfemble. Il eft remarquable que
ni les anciens égyptiens, ni les indiens , ni Ie$
chinois n’ont jamais encouragé le commerce extérieur
, 8c qu’ils femblent avoir été redevables
de leur grande opulence au feul commerce du
dedans.
Une autre ebofe digne d’ être obfervée , c’eft:
que toutes les parties intérieures de l’Afrique, &
toute cette partie de l’Afie qui s’éloigne beaucoup
aii nord du Pont-Eüxin & de la mer Cafpienne,
l’ancienne Scythie , Ja Tartarie moderne 8c la Sibérie
/paroiitent avoir été conftamment dans le
même état de barbarié où nous les voyons à
préfent. La mer de; Tartarie c’eft la mer Glaciale
qui treft point navigable ; & quoique quelques
uns des plus-grands fleuves du monde .coulent
dans ces. régions, iis font à ,une trop grande
diftance pour porter le commerce & la communication
dans, la majeure partie-d,u pays. L ’Afrique
'n’ a point de ces vaftes nappes d’eau , telles
que les mers Baltique 8ç Adriatique en Europe ,
la mer Méditerranée, & les golfes d’ Arabie ,
de Perfe , de l ’Inde , du. Bengale & de Siam -,
pour vivifier par le commerce maritime l’intérieur
des terres; 8c les grandes rivières de l’Afrique
font fi loin les unes des autres , qu’ elles ne
comportent qu’ une navigation fort bornée. .D’ailleurs
une nation ne peut .faire un grand, commerce
par une riyière qui n’ offre pas un grand nombre
de bras ou de canaux , 8c qui pâfîe par un autre
territoire avant de fe rendre à la mer : parce qu’il
eft toujours au pouvoir des nations maîtrejfes de
ce territoire, de trayerfer ou d’intercepter la communication.
L’ utilité que retirent de la navigation
du Danube les états de Bavière , d’Autriche 8c
de Hongrie , eft bien peu de chofe en compargi-
fon de ce qu’elle, feroit, fi un de ces états, pof-
fédoit en entier le ter^ein que parcourt .ce
fleuve jufqu’ au point où il fe jette dans la
mer.
Du Jaiaire du travail.
Dans l’état primitif qui précède la propriété des
terres 8c l’accumulation des capitaux , tout le
produit du travail appartient à l'ouvrier ; il n'y a
ni propriétaire ni maître qui le partage avec lui.
Si cet état eût continué,, le falaire du travail
aurait augmenté à mefure que fes facultés productives
: auroient acquis là perfeélion.;qu’amène la
divifion du travail. Toutes chofes feroient devenues
par degré à meilleur marché; elles auroient
été produites par une moindre quantité de. travail,
8c, comme les marçhandifes, produites par
d’égales quantités de travail fe feroient échangées
l’une contre l’autre, il eft clair qu’elles auroient
été achetées à plus bas prix.
Mais quoique tout fût devenu réellement à meiL
leur marché, certaines chofes auroient pu devenir
en apparence plus chères. Suppofons, par exemple
, que dans la plupart des genres d’indu,ftrie
les facultés productives du travail aient acquis
dix fois plus de perfection , 8c qu'en un jour on
Biffe ce qui étoit d’abord l’ouvrage de dix jours,
tandis que dans un genre particulier d’induftrie
ces mêmes fac.ültés n’ayant acquis que le double
dé perfection, ne donnent en un jour que ce qui
étoit auparavant l’ouvrage de deux. Pour ce dernier
ouvrage on auroit ce qui a été. originairement
l’ouvrage de dix jours dans d’autres efpèces d’induftrie.
Une quantité particulière , comme une
livre pefant de l’ouvrage fait une fois plus vîre,
paraîtrait donc- cinq fois plus .chère qu’aupara-
vant. Mais elle feroit réellement deux fois meilleur
marché ; car quoiqu’il fallût cinq fois autant
d’autres marçhandifes pour l'acheter, elle ne coû-
teroit réellement que Ta moitié fdu travail qu’elle
coutoit d’abord, & par copféquent l’aequilition
en feroit" une fois plus ai fée qu’elle ne l’étoit
auparavant.
Mais cet état primitif qù Eouvrier joujfîoit de
tout le. fruit de fon travail, n’a pu.iuhfifter après
1 ctablifiement des propriétaires 8c l’accumulation
des capitaux.
Dès que la terre appartient exclufivement à
quelqu’un, le propriétaire' veut avoir fa part du
produit que le cultivateur ou l’ouvrier peut en
tirer. Sa rente eft la première déduction fut le
produit du travail employé dans la culture ,ou
1 exploitation.
Il arrive rarement que la perfonne qui cultive
la terré ait.de quoi vivre de fon propre fonds jufqu’à'
la moifion. Sa fubuftance lui eft en général
avancée des capitaux d’un maître;, de ceux du
fermier qui l’empioye, & qui n’aitroit point d'intérêt
à l’employer , s’il ne devoit partager avec lui
Je,produit de fon travail, ou fi fes capitaux ne
dévoient lui rentrer avec un bénéfice. Ce.profit
eft une fécondé déduction à faite fur le produit
du travail employé.à la terre.
Le produit de prefque tout autre travail eft
fujet à la même déduéiion. Dans les arts & les
manufactures, la plus grande partie des ouvriers a
befoin d’un maître, qui avance les, matières , le
falaire Sç la fubfiftance jufqu’à ce que l’ouvrage
fo.it fini. C e maître partage le produit de leur
travail pu la valeur qu’ils ajoutent aux matières,
& c’eft dans cette part que confifte fon profit.
Si un ouvrier pentavoir des capitaux fuffifans pour
acheter les matières qu’il travaille, & ce qui lui
eft néceflaire pour fa vie 8c fon entretien , jufqu’à
ce qu’il ait fini fon ouvrage, il eft en trïême-tëms
ouvrier 8c maître, 8c il jouit de tout le produit
de fon travail3 ou de toute la valeur qu’il
ajoute aux matières.
Mais ce cas eft a fiez rare, 8c dans toutes les
parties de l’Europe, pour un ouvrier qui eft indépendant,
il y en a vingt qui fervent fous un
maître ; 8c par-tout, quand on parle du falaire du
travaily on entend ou l’on fuppofe deux perfon-
. nés , l’ouvrier 8c., le propriétaire de capitaux , qui
! l’employé.
C e qui décide partout du falaire ordinaire du
travail, c’eft le contrat fait entre ces deux per-
! Tonnes, dont les intérêts ne font point du tout
les mêmes. Les ouvriers veulent gagner le plus ,
les maîtres donner-Je moins poffiblé. Ils font dif-
pofés à fe liguer, les uns pour hauflêr, les autres
pour b.lifter Je prix du travail.
Il n’ eft pas difficile de prévoir de quel côté doit
refter ordinairement l'avantage,.Sc quelle eft celle
des deux parties qui forcera l’autrç à le fou mettre
aux conditions qu’elle impofe. Les maîtres .étant
en plus petit nombre, il leur eft bien plus facile
de fe réunir. D ’ailleurs la loi les autorife , ou
du mains ne leur défend pas de fe ligner, au
lieu.-qu’elle le défend aux ouvriers. 11 n’y a point
en Angleterre d’acte du parlement contre ceux
qui ’ çonfpirent à baiflèr la main d’oeuvre , 8c il
y en a piufieurs contre ceux qui çonfpirent pour
la ha u fier. Ajoutez que dans ces fortes de dif-
putres les maîtres peuvent • tenir bien plus^ long-
rems. ^ Un : propriétaire , un fermier, un maître
manufaélurier , un marchand , peuvent généralement
vivre une années ou deux des capitaux qu’ils
i ont par - devers eux fans employer un feul oii-
; vrier.Ta plupart des oiiyriets ne pourroient fub>
fifter une feinaine , fort peu l’efpace d’un mois,.
8c prèfqii’âucün l’efpace d’un an fans travailler.
A la longue le maître ne peut, pas plus fe paffer
; dé l’ouvrier que l’ouvrier, du maître. Mais le be-
> foin qu’il, en à n’eft pas fi urgent,.
Il eft rate , d it-on , qu’on entende parler
d’unetligue dé la part des maîtres , 8c on parle
ihuvent de celles que font les ouvriers. Abus