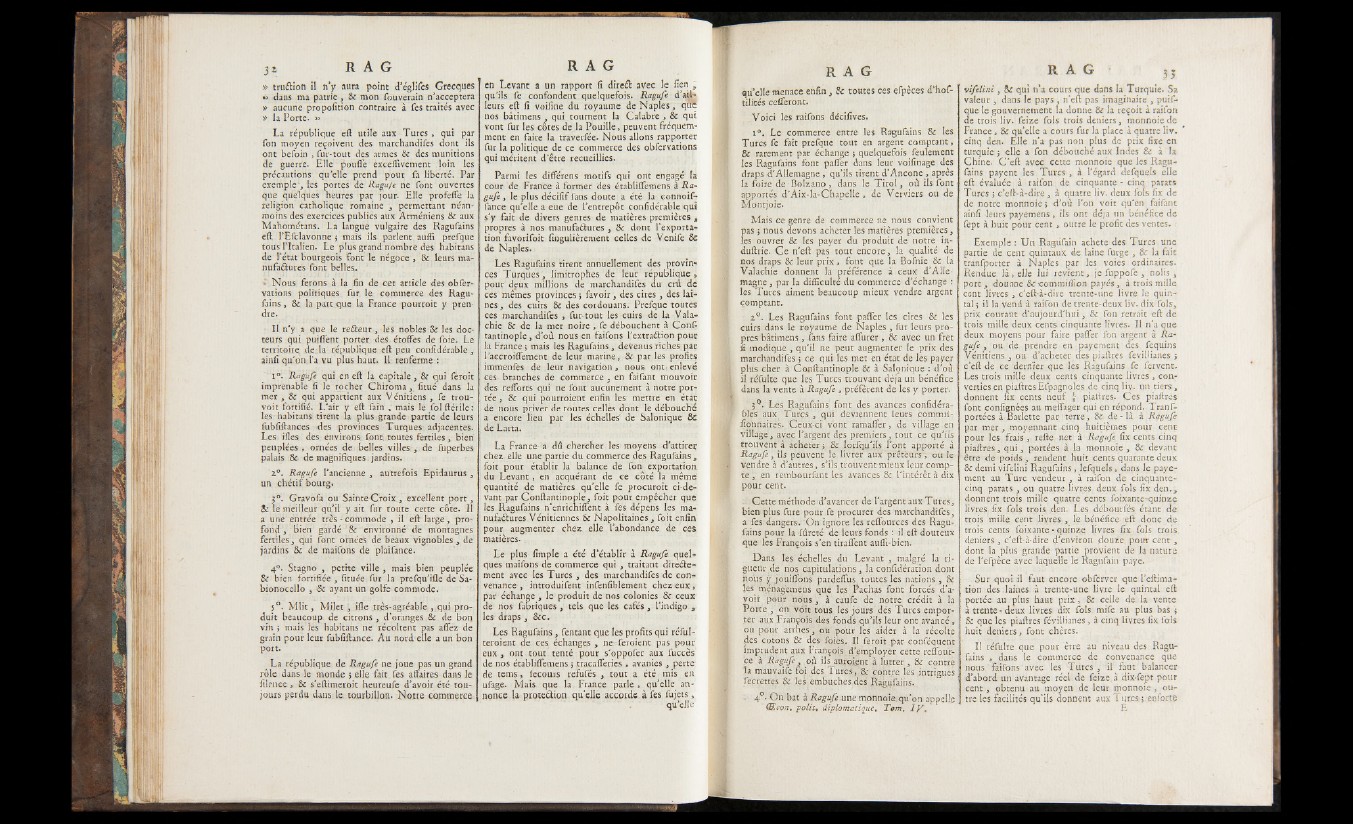
j z R A G
» truéHon il n’y aura point d’églifes Grecques
•» dans ma patrie, & mon fouverain n’acceptera
» aucune propofition contraire à fes traités avec
» la Porte. *
La république eft utile aux Turcs , qui par
Ton moyen reçoivent des marchandifes dont ils
ont befoin , fur-tout des armes & des munitions
de guerre. Elle pouffe exceffivement loin les
précautions qu’elle prend pour fa liberté. Par
exemple‘, tes portes de Raguje ne font ouvertes
que quelques heures par jour. Elle profeffe la
religion catholique romaine , permettant néanmoins
des exercices publics aux Arméniens & aux
Mahométans. La langue vulgaire des Ragufains
eft. l’Efclavonne j mais ils parlent aufli prefque
tous l’Italien. Le plus grand nombre des habitans
de lJétat bourgeois font le négoce , & leurs ma-
nufa&ures font belles.
» Nous ferons à la fin de cet article des obfer-
vations politiques fur le commerce des Ragu-
fains, & là part que la France pourroit y prendre.
.
• II n’y a que le re&eur, les nobles 8c les docteurs
qui puiffent porter des étoffes de foie. Le
territoire. de.:.!a république eft peu confidérable ,.
ainfi qu’on, l’a vu plus haut. II. renferme :
i° . Ragufe qui en eft la capitale, & qui feroit
Imprenable fi le rocher Chiroma 1 fitué dans la
mer , 8c qui appartient aux V énitiens , fe trou-
voit fortifié. L’air y eft fain , mais lé fol ftérile:
les habitans tirent la plus grande partie de leurs
fubfiftances des provinces Turques adjacentes.
Les ifles des environs, font, toutes fertiles 3 bien
peuplées , ornées de belles villesr,.de fuperbes
palais 8c de magnifiques, jardins.
2°. Ragufe l’ancienne 3 autrefois Epidaurus ,
un chétif bourg.
3°. Gravofa ou Sainte Croix , excellent p o r t,
8c le meilleur qu’il y ait fur toute, cette côte. Il
a une entrée très-commode , il eft large, profond
, Bien gardé environné dé montagnes
fertiles , qui font ornées de beaux vignobles , de
jardins 8c de maifons de plaifance.
4°. Stagno , petite v ille , mais bien peuplée
8c bien fortifiée, fituée fur la prefqu’ ifle de Sa-
bionocello , & ayant un golfe commode.
5°. M li t , Milet , ifle trcs-agréablej,.qui produit
beaucoup, de citrons , d’oranges & de bon
vin } mais lés habitans ne récoltent pas affez de
grain pour leur fubfiftance. Au nord elle a un bon
port.
La république de Ragufe ne joue pas un grand
rôle dans le monde i elle fait fes affaires dans le
filenee, & s’eftimeroit heureufe d’avoir été toujours
perdu dans Je tourbillon. Notre commerce.
R A G
en Levant a un rapport fi dire& avec le lien ;
qu'ils fe confondent quelquefois. Ragufe d’ailleurs
eft fi voifine du royaume de Naples, que
nos bâtimens , qui tournent la Calabre , & qui
vont fur les côtes de la Pouille, peuvent fréquemment
en faire la traverfée. Nous allons rapporter
fur la politique de ce commerce des obfervations
qui méritent d ’être recueillies.
Parmi les différens motifs qui ont engagé la
cour de France à former des établiffemens à Ragufe
y le plus décifif fans doute a été la connoif-
; fance qu’elle a eue de l’entrepôt confidérable qui
s’y fait de divers genres de matières premières ,
; propres à nos manufactures , 8c dont l’exportation
favorifoit fingulièrement celles de V enife &
de Naples.
; Les Ragufains tirent annuellement des provin*
; ces Turques, limitrophes de leur république*
pour deux millions de marchandifes du crû de
ces mêmes provinces j favoir, des cires , des laines
, des cuirs 8c des cordouans. Prefque toutes
ces marchandifes * fur-tout les cuirs de la Vala-
chie & de la mer noire * fe débouchent à ÇonG
tantinople, d’où nous en faifon$ l’extraétion pour
la France} mais les Ragufains, devenus riches par
’ l ’accroiffement de leur marine, & par les profits
immenfes de leur navigation* nous ont.enlevé
ces branches de commerce, en faifant mouvoir
des refforts qui ne font aucunement à notre porté
e , & qui pourroient enfin les mettre en état
de nous priver de toutes celles dont le débouché
a encore lieu par les échelle^ de Salonique 8c
de Larta.
La France- a dû chercher les moyens d’attirer
chez elle une partie du commerce des Ragufains,
foit pour établir la balance de fon exportation
du Levant, en acquérant de ce côté la même
quantité de matières qu’elle fe procuroit ci-devant
par Conftantinople, foit pour empêcher que
les Ragufains n’enrichiffent à fes dépens les manufactures
Vénitiennes & Napolitaines , foit enfin
pour augmenter chez elle l’abondance de ces
matières. .
Le plus fimple a été d’établir à Ragufe quelques
maifons de commerce qui , traitant directement
avec les Turcs , des marchandifes de convenance
, introduifent infenfiblement chez eux,
par échange , le produit de nos colonies & ceux
de nos fabriques, tels que les cafés , l’indigo ,
| les draps , & c .
Les Ragufains, fentant que les profits qui réful-
teroient de ces échanges , ne feroient pas pour
'e u x , ont tout tenté pour s’oppofer aux fuccès
de nos établiffemens ; tracafferies , avanies, perte
de tems, (ecours refufés , tout a été mis en
ufage. Mais que la. France parle , qu’elle annonce
la protection qu’elle accorde, à fes fujets ,
qu’elle
R A G
qu’elle menace enfin, & toutes ces çfpèces d’hof-
tilités cefferont.
JVoici les raifons décifîves.
i®. Le commerce entre les Ragufains 8c les
Turcs fe fait prefque tout en argent comptant,
& rarement par échange 5 quelquefois feulement
les Ragufains font paffer dans leur voifinage des
draps d’Allemagne , qu’ils tirent d’Ancone, après
la foire de Bolzano, dans le T ir o l, où ils font
apportés d’Aix-la-Chapelle, de Verviers ou de
Montjoie.
Mais ce genre de commerce ne nous convient
pas j nous devons acheter les matières premières,
les ouvrer & les payer du produit de notre in-
duftrie. C e n’eft pas tout encore , la qualité de
nos draps & leur prix, font que la Bofnie & la
Valachie donnent la préférence à ceux d’Allemagne,
par la difficulté du commerce d’échange :
les Turcs aiment beaucoup mieux vendre argent
çomptant.
2°. Les Ragufains font paffer les cires 8c les
cuirs dans le royaume de Naples , fur leurs propres
bâtimens , fans faire affurer, 8c avec un fret
& modique, qu’il ne peut augmenter le prix des
marchandifes j ce qui les met en état de les payer
plus cher à Conftantinople & à Salonique : d’où
il réfulte que les Turcs trouvant déjà un bénéfice
dans la vente à. Ragufe , préfèrent de les y porter.
3q. Les Ragufains font des avances confidéra-
bles aux Turcs , qui deviennent leurs commif-
fionnaires. Ceux-ci vont ramaffer, de village , en
village, avec l’argent des premiers, tout ce qu’ils
trouvent à acheter j & lorfqu’ils l’ont apporté à
Ragufe 3 ils’ peuvent le livrer aux prêtèurs, ou le
vendre à d’autres, s’ ils.trouvent mieux leur compte
, en rembourfant les avances & l’intérêt à dix
pour cent.
: : Cette méthode d’avancer de l’ argent aux Turcs,
bien plus fure pour fe procurer des marchandifes,
a fes dangers. On ignore les reffources des Ragu-,
fains pour la -fureté de leurs fonds : il eft douteux
que les François s’en tiraffent auffi-bien.
Dans les échelles du Levant , maigre la rigueur
de nos capitulations, la confédération dont
nous ÿ.jquiiTons pardeffus toutes les nations, &
les ménagemens que les Pachas font forcés d’ avoir
pour nous , à caufe de notre crédit à la
Porté , dn; voit tous les jours dés Turcs emporter
aux François des fonds qu’ils leur ont avancé,
ou pour arrhes, ou pour les aider à la récolte
dès cotons & des-foies. Il feroit par conféquent
imprudent aux François d’employer cette reffou'r-
ce à Ragufe 3 ou ils auroient à lutter, & contre
la mauvaife foi des Turcs, & cohtre les intrigues
feçrettes & les embûches des Ragiifains. , , '
- 40; On bat à Ragufe .une monnoie.qu’on appelle
Q£con. polie* diplomatique, Tçm, J y .
RAG 3 3
vifelini, $c qui n’ a cours que dans la Turquie. Sa
valeur , dans le pays, n’eft pas imaginaire , puif-
que le gouvernement la donne & la reçoit à raifon
de trois liy. feize fols trois deniers, monnoiede
France, 8c qu’elle a cours fur la place à quatre liv.
cinq den. Elle n’a pas non plus de prix fixe en
turquie ; elle a fon débouché aux Indes & à la
Chine. C ’eft avec cette monnoie que les Ragufains
payent les T u r c s , à l’égard defquels elle
eft évaluée à raifon de cinquante - cinq parats
Turcs 5 c’eft-à-dire, à quatre liv. deux fols fix de
de notre monnoie > d’où l’on voit qu’en faifant
ainfi leurs payemens, ils ont déjà un bénéfice de
fept à huit pour c en t, outre le profit des ventes.
Exemple : Un Ragufain acheté des Turcs une
partie de cent quintaux de laine furge , & la fait
tranfporter à Naples par les voies ordinaires.
Rendue là, elle lui revient, je fuppofe , noiis ,
p o r t, douane & -commiffion payés , à trois mille
cent livres , c’eft-à-dire trente-une livre le quintal
; il la vend à raifon de trente-deux liv. dix fols,
prix courant d’aujourd’h u i, & fon retrait eft de
trois mille deux cents cinquante livres. Il n’a que
deux moyens pour faire paffer fon argent à Ragufe
, ou de prendre en payement des fequins
Vénitiens., ou d’acheter des piaftres feviilianes ;
c’eft de ce dernier que les Ragufains fe fervent.
Les trois mille deux cents cinquante livres, converties
en piaftres Espagnoles de cinq liv. un tiers,
donnent fix cents neuf piaftres. Ces piaftres
font cônfignées au meffager qui en répond- Tranf-
portées à Barlette par • terre, & de-là. à Ragufe
par mer, moyennant cinq huitièmes pour cenç
pour les frais, refte net à Ragufe fix cents cinq
piaftres, q u i, portées à la monnoie, 8c devant
être de poids , rendent huit cents quarante deux
8c demi vifelini Ragufains, lefquels, dans le payement
au Turc vendeur , à raifon de cinquante-
cinq parats , ou quatre livres deux fols fix den.,
donnent trois mille quatre cents foixante-quinze
livres, fix fols trois :den. Les débouifés étant de
trois mille cent livres , le bénéfice eft donc de
trois cents foixante-quinze livres fix fols trois
deniers , c’ eft-à-dire d’environ douze poirr cent ,
dont la plus grande partie provient de la nature
de l’efpèce avec laquelle le Ragufain paye.
Sur quoi il faut encore obferver que l’eftima-
tion des.laines à trente-une livre le quintal eft
portée au plus haut prix, & celle de. la vente
à trente - deux livres dix fols: mife au plus ba$ $
& que les piaftres févillianes, à cinq livres fix fols
huit deniers, font chères.
Il réfulte que pour être au niveau des Ragufains
, dans le commerce de convenance que
nous faifons avec les Turcs , il faut balancer
d’abord un avantage réel de feize, à dix-fept pour
c en t, obtenu au moyen de leur monnoie, outre
les facilités qu’ils donnent aux Turcs > en forte