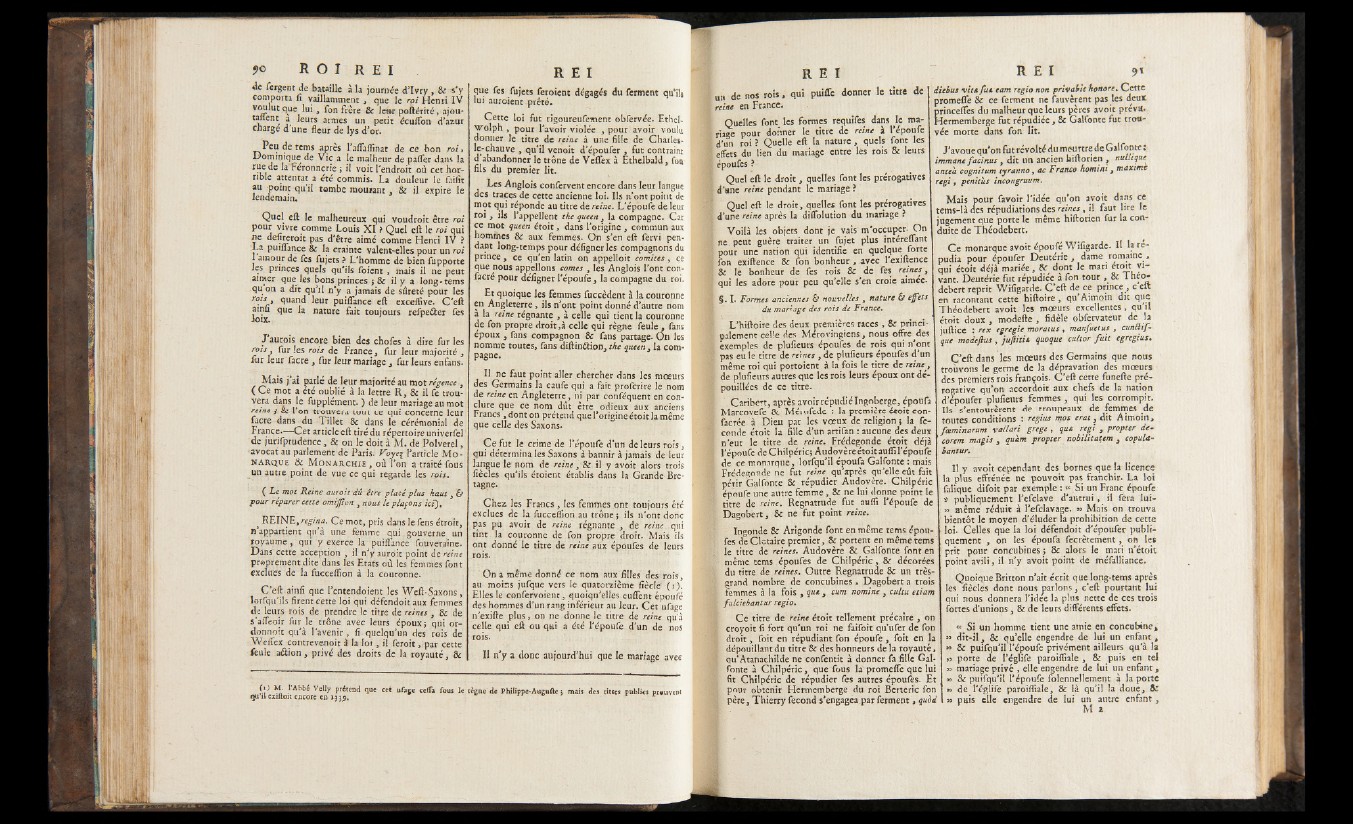
ile fergent de bataille à la journée d’Ivry , & s’ y
comporta fi vaillamment , que le rpi Henri IV
voulut que lu i , fon frère & le»r poftérité, ajou-
tailent a leurs armes un petit écuflon d’ azur
charge d une fleur de lys d’or.
Peu de tems après l’aflaflînat de ce bon roi ,
Dominique de Vie a le malheur de pafler dans la
«e k Feronnerie ; il voit l’endroit où cet horrible
attentat a été commis. La douleur le faifit
au point qu’il tombe mourant . & il expire le
lendemain.
Quel eft le malheureux qui voudroit être roi
Pou* vivre comme Louis X I ? Quel eft le roi qui
ne deureroit pas d’être aimé comme Henri IV ?
puiflance & la crainte valent-elles pour un roi
I amour de fes fujets ? L’homme de bien fupporte
les princes quels qu’ils foient , mais il ne peut
aimer quelles bons princes j & il y a long-tems
qu on a dit qu’il n’y a jamais de sûreté pour les
ro.ls » quand leur puiflance eft exceflîve. C ’eft
mnu que la nature fait toujours refpe&er fes
J’aurois encore bien des chofes à dire fur les
rois} fur les rois de France , fur leur majorité ,
fur leur facre , fur leur mariage 3 fur leurs enfans.
Mais j ai parlé de leur majorité au mot régence -,
( C e mot a été oublié à la lettre R , & il fe trouvera
dans le fupplément. ) de leur mariage au mot
reine ; & 1 on trouvera tout ce qui concerne leur
Facre dans du Tillet & dans le cérémonial de
France.——C e t article eft tiré du répertoire univerfel
de jurifprudence , & on le doit à M. de Polverel,
avocat au parlement de Paris. V-oyej l’article M o n
arque & M o n a r ch ie , où l’on a traité fous
un autre point de vue ce qui regarde les rois.
( Le mot Reine auroit dû être placé plus haut , &
pour réparer cette omijjion , nous le plaçons ici).
| REINE, regina. C e mot, pris dans le fens étroit,
n’appartient qu’à une femme qui . gouverne un
royaume, qui y exerce la puiflance fouveraine.
Dans cette acception , ji n’y auroit point de reine
proprement,dite dans les Etats où les femmes font
exclues de la fucceflion à la couronne.
C ’eft ainfi que l’entendoient les Weft-Saxons,
lorfqu’ils firent cette loi qui défendoitaux femmes
de leurs rois de prendre le titre de reines, & de
s ’afleoir fur le trône avec leurs époux; qiii ordonnât
qu’ à l’avenir, fi quelqu’un des rois de
Weflex contrevenoit à la lo i , il feroit, par cette
feule a&ion, privé des droits de la royauté, &
que fes fujets feroient dégagés du ferment qu’il*
lui auraient prêté.
Cette loi fut rigoureufement obfervée. Ethel-
w o lp h , pour l’avoir violée , pour avoir voulu
donner le titre de reine à une fille de Charles-
le-chauve , qu’ il venoit d’époufer , fut contraint
u abandonner le trône de Veflex à Ethelbald, foa
fils du premier lit.
Les Anglois confervent encore dans leur langue
des traces de cette ancienne loi. Ils n’ont point de
mot qui réponde au titre de reine. L ’époufe de leur
roi , ils l’appellent the queen, la compagne. Car
ce mot queen é toit, dans l’origine , commun aux
hommes & aux femmes. On s’en eft fervi pendant
long-temps pour défigner les compagnons du
prince, ce qu’en latin on appelloit comités, ce
que nous appelions cornes , les Anglois l’ont consacre
pour défigner l’époufe 3 la compagne du roi.
Et quoique les femmes fuccèdent à la couronne
en Angleterre, ils n’ont point donné d’autre nom
a la reine régnante , à celle qui tient la couronne
de fon propre droit,à celle qui règne feule , fans
époux , fans compagnon & fans partage. Gn les
nomme toutes, fans diftin&ion, the queen, la compagne.
Il ne faut point aller chercher dans les moeurs
des Germains la caufe qui a fait proferire le nom
de reine en Angleterre, ni par conféquent en conclure
que ce nom dût être odieux aux anciens
Francs, dont on prétend que l’origine étoit la même
que celle des Saxons.
C e fut le crime de l’époufe d’un de leurs rois,
qui détermina les Saxons à bannir à jamais de leur
langue le nom de reine, & il y avoir alors trois
fiècles qu’ils étoient établis dans la Grande Bretagne.
Chez les Francs , les femmes ont toujours été
exclues de la fucceflion au trône ; ils n’ont donc
pas pu avoir de reine régnante^ de reine..qui
tînt la couronne de fon propre droit. Mais ils
ont donné le titre de reine aux époufes de leurs
rois.
On a même donné ce nom aux filles des rois,
au moins jufque vers le quatorzième fièclë ( i ) .
Elles le confervoient, quoiqu’elles euflent époufé
des hommes d’ un rang inférieur au leur. C e t ufage
n’exifte plus, on ne donne le titre de reine qu’à
celle qui eft ou qui a été l’époufe d’ un de nos
rois.
Il n’y a donc aujourd’hui que le mariage avec
0 / M. I Abbe V e lly prétend que cet ufage cefTa fous le règne de Philippe-Aueufte ;
<ju î i cxifton encore en. s-3
mars des titres publics prouvent
U„ de nos rois, qui puiffe donner le titre de
reine en F tance.
Quelles font les formes requifes dans le maria
« pour donner le titre de reine à l’époufe
d’un roi ? Quelle eft la nature, quels font les
effets du lien du mariage entre les rois & leurs
époufes ?
Quel eft le dro it, quelles font les prérogatives
d'une reine pendant le mariage?
Quel eft le droit, quelles font les prérogatives
d’une reine après la diffolution du mariage ?
Voilà les objets dont je vais m'occuper-On
ne. peut guère traiter un fujet plus intereflant
pour une nation qui identifie en quelque forte
fon exiftence & fon bonheur , .avec 1 exiftence
& le bonheur de fes rois & ^ de fes reines,
qui les adore pour peu qu’elle s’en croie aimee.
§ . I. Formes anciennes & nouvelles , nature 6? effets
du mariage des rois de France.
L ’hiftoire des deux premières races , Sz princi-
! paiement celle des Mérovingiens, nous offre des
exemples de plufieurs époufes de rois qui n’ont
t pas eu le titre de reines , de plufieurs époufes d’un
= même roi qui portoient à la fois le titre de reine 3
i de plufieurs autres que les rois leurs époux ont dépouillées
de ce titre.
Caribert, apres avoir répudié Ingoberge, époufa
[ Marcovefe & Mérofede : la première étoit con-
[ facrée à Dieu par les voeux de religion; la fécondé
croit la fille d’un artifan : aucune des deux
diebus vite fus eam regio non privabit honore. Cette
promefle & ce ferment ne fauvèrent pas les deux
mneefles du malheur que leurs pères avoit prévu,
hermemberge fut répudiée, & Galfonte fut trouvée
morte dans fon lit.
J’avoue qu’on fut révolté du meurtre de Galfonte î
immane facinus , dit un ancien hiftorien , nullique^
antea cognitum tyranno, ac Franco homini , maxime
régi, penitiis incongruum.
Mais pour favoir l’idée qu’on avoit dans ce
tems-là des répudiations des reines % il faut lire le
jugement que porte le même hiftorien fur la conduite
n’eut le titre de reine. Frédegonde étoit déjà
i l’époufe de Chilpéric; Audovère étoit auflil’époufe
de ce monarque, lorfqu’ il époufa Galfonte : mais
! Frédegonde ne fut reine qu’après qu’elle eût fait
périr Galfonte & répudier Audovère. Chilpéric
| époufe une autre femme, & ne lui donne point le
| titre de reine. Regnatrude fut aufli l’ époufe de
? Dagobert, & ne fut point reine.
Ingonde & Arigonde font en même tems épou-
! fes de Clotaire premier, & portent en même tems
le titre de reines. Audovère & Galfonte font en
j même tems époufes de Chilpéric, & décorées
jr du titre de reines. Outre Regnatrude & un très-
I grand nombre de concubines, Dagobert a trois
I femmes à la fois , qu* 3 cum nomine , cultu etiam
| fulciebantur regio.
C e titre de reine étoit tellement précaire, on
I croyoit fi fort qu’un roi ne faifoit qu’ufer de fon
I droit, foit en répudiant fon époufe , foit en la
1 dépouillant du titre & des honneurs de la royauté,
I qu’Atanachilde ne confentit à donner fa fille Gal-
1 fonte à Chilpéric, que fous la promefle que lui
1 fit Chilpéric de répudier fes autres époufes. Et
m pour obtenir Hermemberge du roi Berteric fon
B père a Thierry fécond s’engagea par ferment, quôd
de Théodebert.
C e monarque avoit époufé Wifigarde. Il la répudia
pour époufer Deutérie , dame romaine ,
qui étoit déjà mariée, & dont le mari etoit vivant.
Deutérie fut répudiée à fon tour & Theo-
debert reprit Wifigarde. C ’eft de ce prince, c etc
en racontant cette hiftoire, qu Aimoin dit que
Théodebert avoit les moeurs excellentes, qu il
étoit d o u x , modefte, fidèle obfervateur de la
juftice * rex egregie moratus, manfuetus , cunttif-
que modeftus, juftitis quoque cultor fuit egregius.
C e f t dans les moeurs des Germains que nous
trouvons le germe de la dépravation des moeurs
des premiers rois françois. C ’eft cette funefte prérogative
qu’on accordoit aux chefs de la nation
d’epoufer plufieurs femmes, qui les corrompit.
Ils s’entourèrent de troupeaux de femmes de
toutes conditions : regius mos erat, dit Aimoin,
foeminarum vallari grege , qus régi , propter de-
corem mugis y quam propter nobilitatem 3 copula-
bantur.
Il y avoit cependant des bornes que la licence
la plus effrénée ne pouvoit pas franchir. La loi
falique difoit par exemple : «c Si un Franc époufe
» publiquement l’efclave d’autrui, il fera lui-
» même réduit à l’efclavage. » Mais on trouva
bientôt le moyen d’éluder la prohibition de cette
loi. Celles que la loi défendoit d’époufer publiquement
, on les époufa fecrètement, on les
prit pour concubines ; & alors le mari n’ étoit
point avili, il n’y avoit point de méfalliance.
Quoique Britton n’ait écrit que long-tems après
les fièclés dont nous parlons, c ’eft pourtant lui
qui nous donnera l’idee la plus nette de ces trois
fortes d'unions, & de leurs différents effets.
i « Si un homme tient une atnie en concubine*
» d it- il, & qu’elle engendre de lui un enfant t
*> & puifqu’il l’époufe privément ailleurs qu’à la
>j porte de l’églife paroifliale , & puis en tel
» mariage privé , elle engendre de lui un enfant,
» & puifqu’ il l’ époufe folennellement à la porte
»9 de l’églife paroifliale, & là qu’il la doue, ôz
» puis elle engendre de lui un autre enfant,
M 2