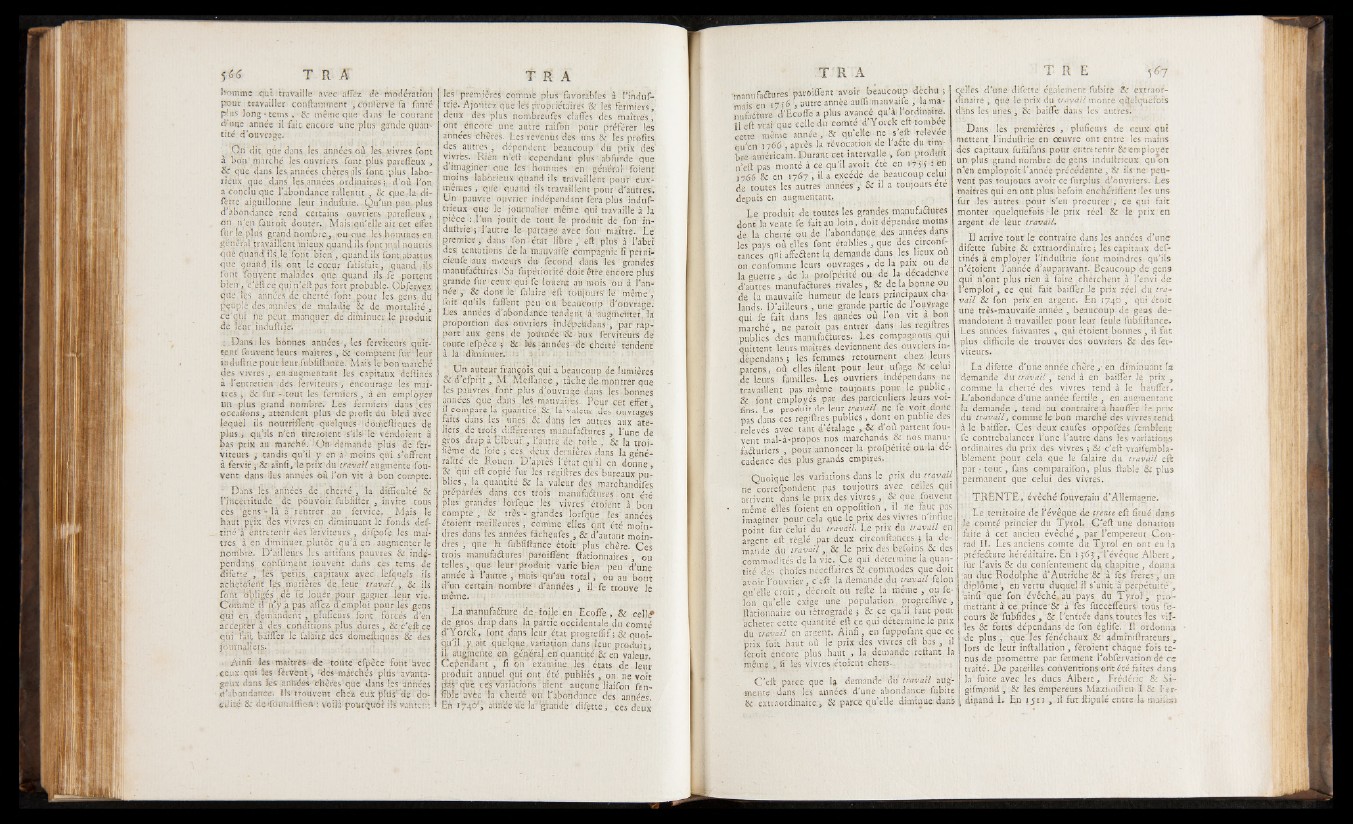
homme qui travaille àvec affez dè modération
pour travailler conftamment , conservé fa fant'é
p!u9 long - tems , & même que dans le courant
d’une année il fait- encore une plus ga'nde quantité
d’ouvrage.
On dit que dans les années où les, vivres font à bon marché les ouvriers font &. que dans 'années chères (ils', pfolunst ;ppalures ffelaubxo >r rai écuoxn cqluu eq u, 'dea rpàsb ole'ns'.daannncéee sr a.ollrednintaiti,re &s * qdu’eo-ùla ,T doni,
dffè’arbeo nadigauncilleo nrneen d lecuer rtianidnsu ftroieu.v«r Qierus’ unp apreefufe. puxlu s, founr leii ’epnlu sfa ugrraqnitd dnooumtberre,..,^ M ,pauis :qqqiet’ elelles ^aoitm crente eSf'efent gqué'en êqruala;rnradïy,ialsi'i,lléen fto mntie.buixe .nq u,a.qnuda,inlsd f piisn t fjonnatl, anboautrturiss; qfounet qTuoaunvde,n ilts m ôanla'td’ eles cqçueep, r qfuaannsdf âilist/-. qfeu apnodr tednist bquieen 'lje.cs êaftncneé eqsu di erî"’ ëdfite p rates , fofornt tp rpoobuarb lele. sO gbefensry; edzu; peuplé des années;:de maladie & de mortalité,
c è ’qui ne' peut jfiâhcjuer, de diminuer.îe produit,
ac lêurjnduffrïei' .
; Dans; les bonnes années , les ferviteurs .quittent
foirvenc leurs maîtres , & comptént fur‘ leur
induftr ie pour leur fubfiftancé. Mais le bon marché
des vivres, en augmentant les capitaux déftinés
à l’entretien ;des férviteurs V ■ encourage les'maîtres
j & fur - tout les fermiers, à en employer
un plus grand nombre. Les fermiers- dans |c'ë$
©ccaftons, attendent plus de profit dû bled avec
lequel ils noiarriffent -quelques - dôiùéftlques de
plus i qu’ils n’en tiretoient-s’ils'lé vémloi;ent à
bas prix au marché. -On-demande'plus de fer-
viteurs , tandis qu’il y e!n â: moins qui s’offrent
à ferviry& alnfi, le prfxdu travail augmente fou-
vent dans, fies années où l’on vit à bon compte.
• DànS lès années ,de . chçrté_, la difficulté &
rinçÇrtitÜd'ë , de pouvoir fubfiftér , invite, tous
cès g é n s !- l à a"jebtrer•.’ .au fervice. Mais le
haut prix, dès, yivresVëp. diminuant le fonds def-
tiiié'a' entretenir, des’ feryiteurs , difpofe les. maîtres.
à en diminuer plutôt qu’ à en . augmenter le
nombre. D ’ ailleurs les ârtitans pauvre? & jndé-
pendàris çqhfumènt fouvent dans ces rems de
difette ,;îè s ‘petits, capitaux avec lefquels ils
achçtôlèn't l&s mptietés ’dé,leur travail..y & ils
fonV obligés.de "fe Ibuéiypoiir gagner leur vie. :
Comme iTn’ÿ ’a pis affez cl, emploi pour des gens
qii,i èn demandént, plûffeûrs font forcé? d’en 1
accepter à des conditions plus .dures, & c’eft ce '
qui fait bà’iffef le falâirç des" domeÛiques & des i
journalier S-| t*
-■ Ainfi lés maîtres- de toute ;efpèce font "avec i
ceux-qui les fèrvenÇ, :des marchés plusjavança- !
geux dans les antréés- tfhèfés-que dans îès^hbees i
d’abondanêe. 11$' trouvent èhéz éük ! dqi 1
cilitç & de'founiiflîoB'; vbüà’pour^iréî ils vantent Î
l i s ! prehiiêrés coriimë plus -fàvorKblés à l’îndüfè
tqe. Ajoutez que les propriecai.res & les fermiers,
deux des plus iiorhbreufés clâffes dès maîtres ,
ont énerite une autre raifon pour préférer les
années chères. Les revenus des uns & les profits
des autres , dépendent beaucoup1 du prix des'
vivrès.. Rien n'dt cependant plus abfurde que
d imaginer1 que les hommes en général foient
moins laborieux quand ils travaillent pour' eux-
mêmes , qiiè . quand ils’travaillent polir d’autresî
Un pauvre ouvrier indépendant fera plus induf-
tfieux que le journalier même qui travaille à la
i pièce uj'un jouit de tout le produit dé fon in-
! dulirie ; l'autre le partage avec fon1 maître. Lé
| premier, dans fon-érat "libre , eft. plus à l’abri
i des; tentations de la mauvaife compagnie fi perni-
cienfe iaùx moeurs du fécond dans les grandes
manufactures.:Sa fupériorité doit être encore plus
grande fur ceux1 qui fe louent au mois ;ou à l’année1,
& dont'Le fsil4re;éft -toujours’ ‘.'le' ’mêifté',
fort qu'ils ■ fïflènt peu bu btaudou'p H’pùv'ràgëi
L’es années d’abondance ’fendent!k -augmerrter la
proportion des ouvriers inéé'pd.idans , par .rapport
aux gens.de journée Ht ’aux férviteurs' de
toute efpece j & lés ;inhées ’il t cherté tendent
à la diminuer.1 z u
Un auteur françois qui a beaucoup de lumières
St d efprit, Î\1 pMelfance , tache de-mpntrer que
les pauvres ..font plus d’ouvragé dans les ..bonnes
années’ que d’ans..les mnuvaijçs Pour cet effet
H comparé là quantité 8c la valeur des ouvrages
faits dans, les unes St dans les autres aux ateliers.
de trois différentes màaufaélures , l’une de
gros drap, à Çlb'cuf.,, J’,âû.tr'e "de ,tpil;e ,' & la troi-
fième de foie, ; cès deux dernières dans la généralité
de Rouen. D ’après l'état qu'il en donne,
& qui eft copié fur les ré'giftres des bureaux publics,
la quantité s: la valeur des marchandifes
préparées dans. Ces' trois mamiftfétiiresl'ont été
plus grandes lorfeue les vivres' étôieht à bón
compté , & très - gràndès lôrfqûé les-' années,
étoiént meilleures , comme elles ont été moindres
dans les années fâcheufes, & d’autant moindres
, que fa fubfilfartce étoit* plus chère. C e ï
trois manufaéluresépaffeifTënt ftationnaires, ou
telles, que leur’ produit, varie bien peu d’une
année à l’autre, nfais'qu’au total, ou au bout
d’un certain nombre" d’années, il.-fe trouve le
même. ’
La manpfaéture de,- toile:en. Hcofle , & cell?
de; gros drap dans la partie occidentale du comté
d’Ÿorck,"font ,'dâpsfjeur état progreffif; & quoiqu’il
jv ait .quelque,vari.a^iqn: dans glc'tuv produit 4 augmente en. generd en quan tiré & en valeur*
Ceiôéndarit ,'1,1 fi bh ex ami ne lès : états -de leur
produit annuel qui ont, été publiés , on ne voit
rfdè’çjtiè cèi’Variàtfehs’ÿient aucune,îiàifon fen-
«ble’avèc ’la cherté pu, l’abondance des années.
En lÿùîMj arin'éè 'de la'%'tandè difette ; ces deux
Ynanufaëtures pavoiffent avoir beaucoup déchu ;
mais en 17*6 , autre année auffi.mauvaife , la manufacture
d’Ecoffe a plus avancé qu’à; l’ordinâîre.
Il eft vrai que celle du comte d Yorck eft tombée
cette même année-, & qu’ello- ne s’ëft relevée -
qu’en 17:66 , après la révocation de l’aCte du timbre
américain.Durant cet intervalle , fon prodtM
n’ eft pas monté à ce qu’il avoit été en f j- y y i en
1766 & en 1767 , il a excédé de beaucoup celui
de toutes les autres années'y & il a toujours été t
depuis en augmentant,
Le produit de toutes les grandes manufactures
dont la vente fe fait au loin, doit dépendre moins
de la cherté ou de l’abondance des années dan?
les'' pays où elles font établies , que des circonf-;
tances qui affeCtent la demande dans les^ lieux ou ;
on confomme leurs ouvrages » de la paix ou. d e .
la guerre j de la profpérité ou de la décadence
d’autres manufactures rivales, & de la .bonne ou
de la mauvaife humeur de leurs principaux chalands.
D’ ailleurs , une grande partie de l’ouvrage
qui fe fait dans .les années où l’on vit à bon
marché , ne paroît pas entrer dans les regiftres
publics des manufactures. Les compagnons, qui
quittent leurs maîtres deviennent des ; ouvriers in-
dépendans j les femmes retournent chez leurs
parens, où elles filent pour leur ufage & celui
de leurs familles. Les ouvriers indépendans n e:
travaillent pas même toujours pour le public,
& font employés .par des particuliers leurs voi-
fins. Le produit de leur travail ne fe voit donc
pas dans ces regiftres publics , dont on publie des;
relevés avec tant d’étalage , & d’où partent fou-
vent mal-à-propos nos marchands & nos manufacturiers
, pour annoncer la profpérité ou4a décadence
des plus grands empires.. .
' Quoique les variations dans le prix du travail
hé correfpondent pas toujours avec celles qui;
arrivent dans le prix des vivres , & que .fouvent
même elles foient en oppofition , il_ ne faut pas
imaginer pour cela que le prix des vivres n’inftue
point fur celui du travail Le prix du travail en;
argent eft réglé par deux circonftanccs -, la de-î
mandé du travail, 8c le prix.des befoins & des|
commodités de la vie. C e qui détermine la quan- '
tiré des cho'fes néceffaires & commodes que doit
'avoir f ouyrier , c eft la demande du travail félon ;
quelle croît., décroît ou refte la même , pu fe-'
Ion qifelle exige une population prqgVeflîve ,
ftationnaire ou rétrograde i & ce qu’il faut pour
acheter cette quantité eft ce qui détermine le prix
du travail en argent. A in fi, en fuppofant que ce
prix foit haut où le prix des vivres eft bas , il
feroit encore plus haut , la demande reÛant la
même , fi" lçs vivres croient chers...
C ’eft parce que h demande' du travail augmente
• dans lés' années d’une abondance fubire
extraordinaire., & parce qu’ elle diminue dans
qeîîes d’une difetté également fubite extraordinaire,
que le prix du travail monte quelquefois
dahs lés unes, & baiffe dans les autres.
Dans lés premières , plufieurs de ceux- qui
mettent l’induftrie en oeuvre ont entre les mains
dès capitaux fuffifans. pour entretenir & employer
bit plus 'grand nombre de gens induftrieux qu on
nlën employôit l’année précédente, & ils ne peuvent
pas toujours avoir ce furplus d’ouvriers. Les
maîtres qui en ont plus; befoin enchériffent les uns
fur des autres pour !s’en procurer , ce qui fait
monter .quelquefois le prix réel & le prix en
argent de leur travail.
Il arrive tout le contraire dans les années d’une
difette fubite, & extraordinaire j lés capitaux def-
tinés à employer lJïndLiftrie font moindres qu’ils
n’ étôient l ’année d’auparavant. Beaucoup de gens
qui n’ont plus rien à faire cherchent à l’envi de
l’emploi, ce qui fait baiffer le prix réel du travail
& fon prix'en argent. En 1740, qui ctoit
une très-mauvaife année , beaucoup de geas de-
mandoient à travailler pour leur feule fubfiftance.
Les années fuivantes , qui étoient bonnes , il fut
plus difficile de trouver des ouvriers & des fer-
viteurs.
La difette d’une année' chère.»■ en diminuant la
demande du travail, tend à en baiffer le prix 3
comme la cherté des vivres tend à le hauffer.
L ’abondance d’une année fertile , en augmentant
la demande , tend au contraire à hauffer le prix
du travail, comme le bon marché des vivres tend
à .le baiffer. Ces deux caufes oppôfées fembfenc
fe contrebalancer l’une l’autre dans les variations
ordinaires du prix des vivres. > 8d c’ eft vraifembla-
blement pour cela que lé falâire du travail eft
par - to u t, fans comparaifon, plus ftable & plus
permanent que celui des vivres.
T R E N T E , évêché fouverain d’Allemagne.
..; Le territoire de l’évêque de trente eft fituéffans
le comté princier du T y roi. C ’eft une donation
faite à cet ancien évêché, par l’empereur C o n rad
II. Les anciens comte du Tyro l en ont eu la
préfecture héréditaire. En 13*63 / l’évêque Albert,
fur l’avis. & du confentement du chapitre , donna
'au duc Rodolphe d’Autriche ;& à fes ’frères, un
diplôme , en vertu duquel il s’unit à'perpétuité
'ainfi que fon évêché.»au pays du Ty ro l,, promettant
à ce. prince*&: à Tes fucceffeurs,1 tous fe-
cours & fubfides , l’entrée dahs, toutes lès villes
& forts dépendais de fon églife. Il ordonna
de plu s, que'Jes fénéchaux & admïniftrateurs ,
lors de leur inftallatrôn, féroient chaque fois te-
, nus de promettre par ferment l’obfervation de ce
traité. De pareilles conventions ont été faites dans
la fuite avec les ducs Alb e r t, Frédéric & Sï-
gifm.ond, -& les empereurs Maxi.nilién I & Ferdinand
I. En 1511 , il fut ftipulé entre la maiCo;ï