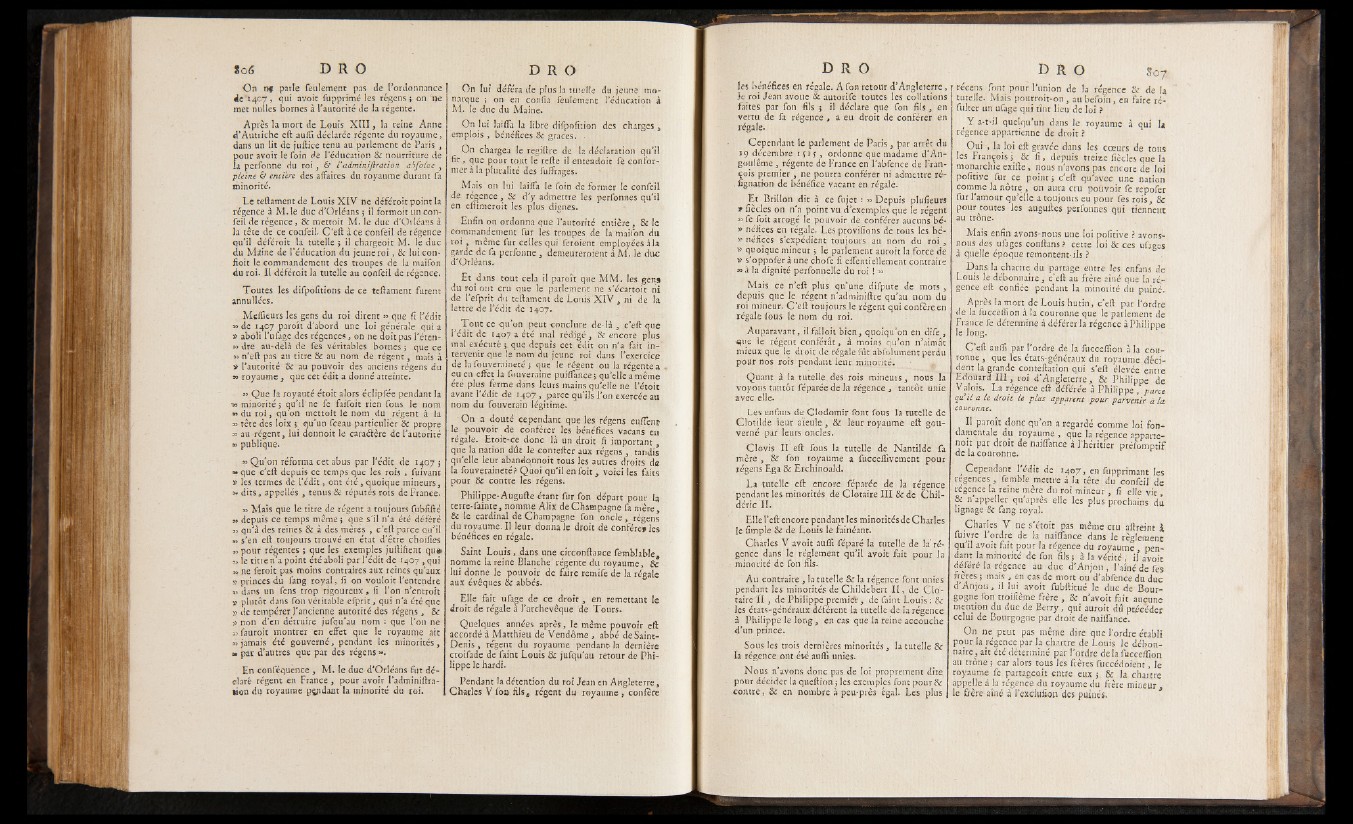
*0 6 D R O
O n nf parle feulement pas de l’ordonnance
de'1407, qui avoir fupprimé les régens > on "ne
met nulles bornes à l’autorité de la régente.
Après la mort de Louis X I I I , la reine Anne
d’Autriche eft aufli déclarée régente du royaume,
dans un lit de juftice tenu au parlement de Paris,,
pour avoir le foin de l ’éducation & nourriture de
la perfonne du ro i, & Vddminijlration abfolue ,
pleine & entière des affaires du royaume'durant fa
minorité.
Le teftament de Louis X IV ne déféroît point la
régence à M .le duc d’Orléans ; il formoit un con-
feil de régence , & mettoit M. le duc d’Orléans à
la tête de ce confeil. C ’eft à Ce confeil de régence
qu’il déféroit la tutelle ; il chargeoit M. le duc
du Mâine de l’éducation du jeune r o i , & lui confiait
le commandement des troupes de la maifon
du roi. Il déféroit la tutelle au confeil de régence.
Toutes les difpofitions de ce teftament furent
annullées.
Meilleurs les gens du roi dirent » que fi l’ édit
» d e 1407 paroît d’abord une loi générale quia
» aboli l’ufage des régences, on ne doit pas l’éten-
» dre au-delà de fes véritables bornes j que ce
» n’ eft pas au titre & au nom de régent, mais à
9 l’autorité & au pouvoir des anciens régens du
» royaume , que cet édit a donné atteinte.
» Que la royauté étoit alors éclipfée pendant la
■ » minorité > qu’il ne fe faifoit rien fous, le nom
» du ro i, qu’on mettoit le nom du régent à la
» tête des loix > qu’un fceau particulier & propre
» au régent , lui donnoit le caractère de l’autorité
» publique.
» Qu’on réforma cet abus par l’édit de 1407 j
» que c’eft depuis ce temps que les rois , fuivant
» les termes de l’ édit, ont é té , quoique mineurs,
» dits, appeilés , tenus & réputés rois de France.
» Mais que le titre de régent a toujours fubfifté
» depuis ce temps même j que s’il n’a été déféré
» qu’à des reines & à des mères , c ’eft parce qu’il
»s s’en eft toujours trouvé en état d’être choifies
as pour régentes $ que les exemples juftifient qu*
9> le titre n’a point été aboli par l’édit de t^oy, qui
99 ne feroit pas moins contraires aux reines qu’aux
» princes du fang royal, fi on vouloir l’entendre
« dans un fens trop rigoureux, fi l’on n’entroit
y plutôt dans fon véritable efprit, qui n’a été que
>> de tempérer l’ancienne autorité des régens, &
* non d’en détruire jufqu’au nom : que l’on ne
ss'fauroit montrer en effet que le royaume ait
33jamais été gouverné, pendant les minorités,
» par d’autres que par des régens ».
En conféquence , M. le duc d’Orléans fut déclaré
régent en France, pour avoir i’adminiftra-
Kon du royaume pendant la minorité du roi.
D R O
[ On lui déféra de plus la tutelle du jeune monarque
; on én confia feulement l’éducation à
M. le duc du Maine.
On lui laiffa la libre difpofition des charges ,
emplois , bénéfices & grâces. •
On chargea le regiftre de la déclaration qu’il
fit, que pour tout le refte il entendoic fe conformer
à la pluralité des fuffrages.
Mais on lui laiflfa le foin de former le confeil
de régence, & d’y admettre les perfonnes qu’ il
en eftimeroit les plus dignes.
Enfin on ordonna que l’autorité entière , & le
commandement fur les troupes de la maifon du
r o i , même fur celles qui feroient employées à la
garde de fa perfonne , demeureroient à M. le duc
d’Orléans.
Et dans tout cela il paroît que M M. les gens
du roi ont cru que le parlement ne s’écartoit ni
de l’efprit du teftament de Louis X IV , ni de la
lettre de l’édit de 1407.
Tout ce qu’on peut conclure de-là , c’eft que
l’edit de [407 a été mal rédigé, & encore plus
mal exécuté j que depuis cet édit on n’ a fait intervenir
que le nom du jeune roi dans l’exercice
de la fouvernineté j que le régent ou la régente a
eu en effet la fouveraine puiffance; qu’elle a même
été plus^ ferme dans leurs mains qu’elle ne l’étoic
avant 1 edit de 1407, parce qu’ils l’on exercée au
nom du fouverain légitime.
On a douté cependant que les régens enflent
Ie _ pouvoir de conférer les bénéfices vacans en
régale. Etoit-ce donc là un droit fi important ,
que la nation dût le contefter aux régens , tandis
qu’elle leur abandonnoit tous les autres droits de
la fouveraineté? Quoi qu’il en fo it , voici les faits
pour & contre les régens.
Philippe-Augufte étant fur fon départ pour la
terre-fainte, nomme Alix de Champagne fa mère,
& le cardinal de Champagne fon oncle, régens
du royaume. Il leur donna le droit de confère# les
bénéfices en régale.
Saint Louis».dans une circonftance femblable,
nomme la reine Blanche' régente du royaume, &
lui donne le pouvoir de faire remife de la régale
aux évêques & abbés.
Elle fait ufage de ce d ro it, en remettant le
droit de régale à l’archevêque de Tours.
Quelques années après, le même pouvoir eft
accordé à Matthieu de Vendôme , abbé de Saint-
Denis , régent du royaume pendant- la dernière
croifade de faint Louis & jufqu’au retour de Philippe
le hardi.
Pendant la détention du roi Jean en Angleterre ,
Charles V fou fils, régent du royaume , confère
d r o
les bénéfices en régale. A fon retour d’Angleterre,
le roi Jean avoue & autorife toutes les collations
faites par fon fils j il déclare que fon fils , en
vertu de fa régence, a eu droit de conférer en
légale.
Cependant le parlement de Paris, par arrêt du
39 décembre 1 f 1 y , ordonne que madame d’ An-
goulême, régente de France en l’abfence de François
premier, ne pourra conférer ni admettre ré-
. fignation de bénéfice vacant en régalé.
Et Brillon dit à ce fujet : » Depuis plufieurs
9 lîècles on n’a point vu d’exemples que le régent
» fe foit arrogé le pouvoir de conférer aucuns bé-
» néfices en régale. Les provifions de tous les bé-
>? néficès s’expédient toujours ati nom du r o i ,
» quoique mineur > le parlement auroit la force de
» s’oppofer à une chofe fi efifentiellement contraire
» à la dignité perfonnelle du roi ! »
Mais ce n’eft plus qu’une difpute de mots,
depuis que le régent n’adminiftre qu’au nom du
roi mineur. C ’eft toujours le régent qui confère,en
régale fous le nom du roi.
Auparavant, il falloit bien, quoiqu’on en dife ,
«lue le régent conférât, à moins qu’on n’aimât
mieux que le droit de régale fût abfolument perdu
pour nos rois pendant' leur minorité.
Quant à la tutelle des rois mineurs, nous la
voyons tantôt féparéede la régence , tantôt unie
avec elle.
Les enfans de Clodomir font fous la tutelle de
Clotilde leur aïeule., & leur royaume eft gouverné
par leurs oncles.
Clovis IL eft fous la tutelle de Nantilde fa
mère, & fon royaume a fuceeflivement pour
régens Ega & Erchinoald*
La tutelle eft encore féparée de la régence
pendant les minorités de Clotaire III & de Chil-
dcric II.
Elle l’eft encore pendant les minorités de Charles
le fimple & de Louis le fainéant.
Charles V avoit auflï féparé la tutelle de la régence
dans le réglement qu’il avoit fait pour la
minorité de fon fils.
Au contraire, la tutelle & la régence font unies
pendant les minorités de Childebert I I , de C lo taire
II , de Philippe premia, de faint Louis : &
les états-généraux défèrent la tutelle de la régence
à Philippe le long, en cas que la reine accouche
d’un prince.
Sous les trois dernières minorités, la tutelle &
la régence ont été aufli unies.
Nous n’avons donc pas de loi proprement dite
pour décider la queftion j les exemples font pour &
contre, & en nombre à peu-près égal. Les plus
D R O 807.
récens font pour l'union de la régence & de la
tutelle. Mais pourroit-on, au befoin, en faire ré-
fulter un ufage qui tînt lieu de loi ?
? Y a-t-il quelqu’un dans Je royaume à qui la
régence appartienne de droit ?
Gui , la loi eft gravée dans les coeurs de tous
les François j & f i , depuis treize fiècles que la
monarchie exifte, nous n’avons pas encore de loi
pofitive fur^ce point 5 c’eft qu’avec une nation
comme la nôtre , on aura cru pouvoir fe repofer
fur l’amour qu’elle a toujours eu pour fes rois, &
pourvûte s les auguftes perfonnes qui tiennent
au trône-
Mais enfin avons-nous une loi pofitive ? avons-
nous des ufages conftans ? cette loi & ces ufages
à quelle époque remontent-ils ?
Dans la chartre du partage entre les enfans de
Louis le débonnaire, c’eft au frère aîné que la régence
eft confiée pendant la minorité du puîné.
Après la mort de Louis hutin, c’eft par l’ordre
de la fuccéflîon à îa couronne que le parlement de
France fe détermine à déférer la régence à Philippe
le long.
C ’eft auffi par l’ordre de la fucceffion à la couronne
, que les états-généraux du royaume décident
la grande conteftation qui s’eft élevée entre
Edouard I I I , roi d’Angleterre, & Philippe de
Valois. La régence eft déférée à Philippe , parce
quil a Le droit le plus apparent pour parvenir à la.
couronne.
clamentale du royaume , que la régence apparte-
noit par droit de naiflance à l'héritier préfomptif
de la conronne.
, Cependant le d it de 1407, en fupprimant les
regences , femble mettre à la tête du confeil de
régence la reine mère du roi mineur , fl elle v i t ,
& n'appeller qu'après elle les plus prochains du
lignage & fang royal.
Charles V ne s'étoit pas même cru aftreint 4
fume l'ordre de la naiflance dans le règlement
qu'il avoit fait pour la régence du royaume, pendant
la minorité de fon fils ; à la vérité, ii avoit
déféré la régence au duc d'Anjou ; l'aîné de fes
frètes ; mais , en cas de mort ou d'abfence du duc
d'Anjou, il lui avoit fubftitué le duc de Bourgogne
fon troifième frère , & n'avoit fait aucune
mention du duc de Berry, qui auroit dû précéder
celui de Bourgogne par droit de naiflance.
On ne peut pas même dire que i'ordre établi
pour la régence parla chartre de Louis le débonnaire,
ait été déterminé par l’ordre delà fuccéflîon
an trône ; car alors tous les frères fuccédoient, le
royaume fe partageoit entre eux ; & la chartre
appelle à la régence du royaume du frère mineur,
le frère aîné à l’exclufion des puînés.