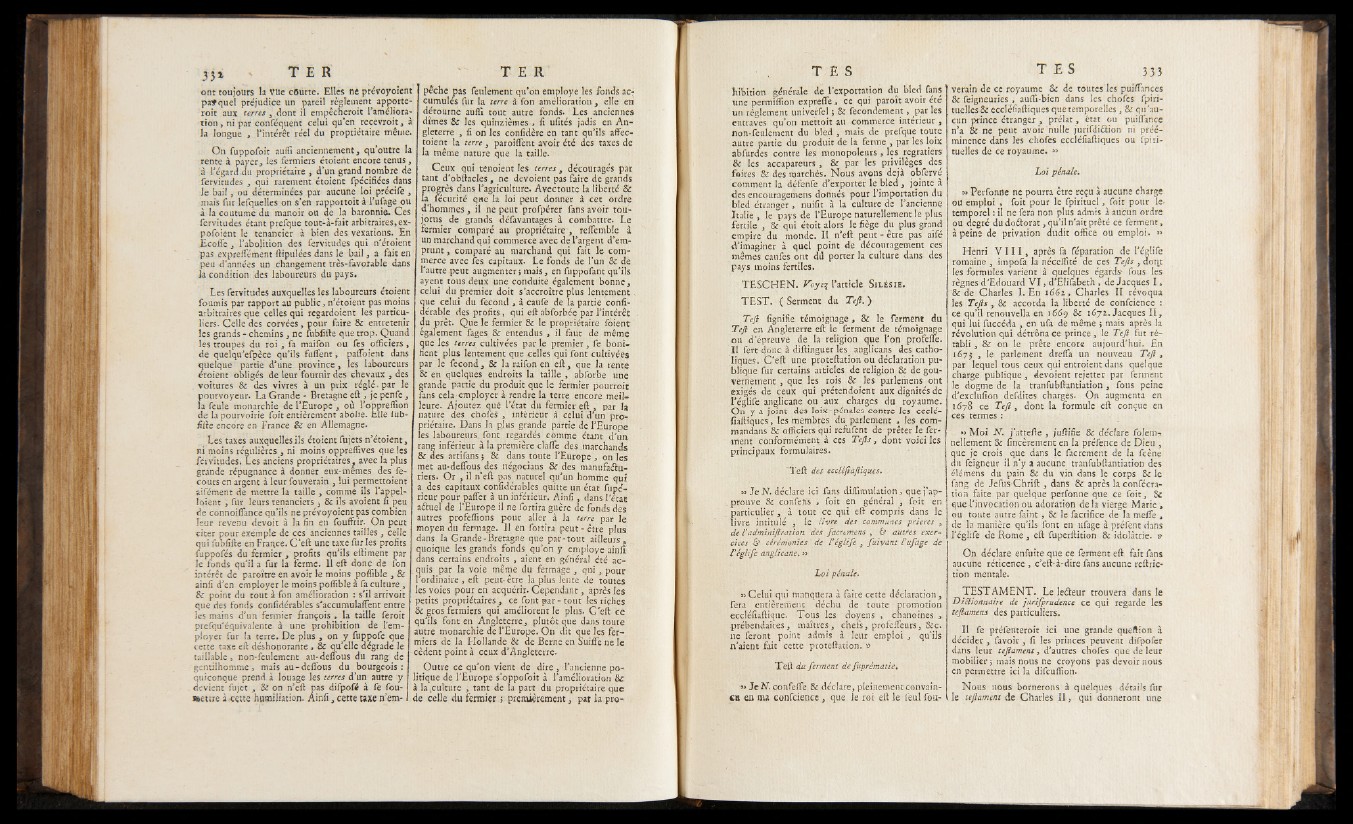
ont toujours la Vile courte. Elles ne prévoyoîent
paSquel préjudice un pareil règlement apporte-
roit aux terres , dont il empêcneroit l’amelioration
, ni par conféquent celui qu’en recevront , à
la longue , l’ intérêt réel du propriétaire même.
On fuppofoit auffi anciennement, qu’outre la
rente à payer, les fermiers étoient encore tenus,
à l’égard-du propriétaire , d’un grand nombre de
fervitudes , qui rarement étoient fpécifiées dans
Je b ail, ou déterminées par aucune loi précife ,
mais fur lefquelles on s’ en rapportoit à l’ ufage ou
à la coutume du manoir ou de la baronnie. Ces
fervitudes étant prefque tout-a-fait arbitraires,ex-
pofoient le tenancier à bien des vexations. En
E co lfe , l’abolition des fervitudes qui n’étoient
pas exprelfément ftipulées dans le bail, a fait en
peu d’années un changement très-favorable dans
la condition des laboureurs du pays.
Les fervitudes auxquelles les laboureurs étoient
fournis par rapport au public, n’étoient pas moins
arbitraires que celles qui regardoient les particuliers.
Celle des corvées, pour faire & entretenir
les grands - chemins, ne fubfifte que trop. Quand
les troupes du roi , fa maifon ou fes officiers ,
de quelqu’efpèce qu’ils fuffent y palfoient dans
quelque partie d’une province, les laboureurs
étoient obligés de leur fournir des chevaux , des
voitures & des vivres à un prix réglé. par le
pourvoyeur. La Grande - Bretagne eft > je penfe,
la feule monarchie de l’Europe , où l’oppreffion
de la pourvoirie foit entièrement abolie. Elle fub-
fifle encore en France & en Allemagne.
Les taxes auxquelles ils étoient fujets n’étoient,
ni moins régulières , ni moins oppreffives que les
iervitudes. Les anciens propriétaires, avec la plus
grande répugnance à donner eux-mêmes des fe-
cours en argent à leur fouverain , lui permettoient
ai Cément de mettre la taille , comme ils l’appel-
loient ^ fur leurs tenancieTS , & ils avoient fi peu
de connoiflance qu’ils ne prévoyoient pas combien
leur revenu devoit à la fin en fouffrir. On peut
citer pour exemple de ces anciennes tailles, celle
qui fubfifte en France. C ’eft une taxe fur ies profits
fuppofés du fermier , profits qu’ ils eftiment par
le fonds qu’il a fur la ferme. 11 eft donc de fon
intérêt de paroître en avoir le moins poffible , &
ainfi d’en employer le moins poffible à fa culture,
& point du tout à fon amélioration : s’il arrivoit
que des fonds confidérables s’accumulaflent entre
les mains d’un fermier françois , la taille feroit
prelqu’équivalente à une prohibition de l’employer
fur la terre. De plus , on y fuppofe que
cette taxe eft déshonorante, & qu’elle dégrade le
taillable, non-feulement au-deffous du rang de
gentilhomme , mais au-deffous du bourgeois :
quiconque prend à louage les terres d’un autre y
devient fujet , & on n’eft pas difpofé à fe fou-
»eure à cette humiliation. Ainfi, cette taxe n’empêche
pas feulement qu’on employé les fonds accumules
fur la terre à fon amélioration, elle en
détourne auffi tout autre fonds. Les anciennes
dîmes & les quinzièmes, fi ufités jadis en Angleterre
, fi on les confidère en tant qu’ils affec-
toient la terre, paroiffenc avoir été des taxes de
la même nature que la taille.
Ceux qui tenoient les terres, découragés par
tant d’obftacles, ne dévoient pas faire de grands
progrès dans l’agriculture. Avectoute la liberté &
la fécurité que la loi peut donner à cet ordre
d’hommes, il ne peut profpérer fans avoir tou-
jorus de grands défavantages à combattre. Le
fermier comparé au propriétaire , reffemble à
un marchand qui commerce avec de l’argent d’emprunt,
comparé au marchand qui fait le commerce
avec fes capitaux. Le fonds de l’un & de
l’autre peut augmenter i mais, en fuppofant qu’ils
ayent tous deux une conduite également bonne,
celui du premier doit s’accroître plus lentement -
que celui du fécond , à caufe de la partie confî-
dérable des profits, qui eft abforbée par l’intérêt
du prêt. Que le fermier & le propriétaire fbienc
également fages & entendus , il faut de même
que les terres cultivées par le premier, fe bonifient
plus lentement que celles qui font cultivées
par le fécond, & la raifon en e ft, que la rente
& en quelques endroits la taille , abforbe une
grande partie du produit que le fermier pourroit
fans cela employer à rendre la terre encore meilleure.
Ajoutez qué l’état du fermier eft , par la
nature des chofes , inférieur à celui d’ un pror
priétaire. Dans la plus grande partie de l’Europe
les laboureurs font regardés comme étant d’un
rang inférieur à la première claffe des marchands
& des artifans j & dans toute l’Europe , on les
met au-deffous des négocians & des manufacturiers.
Or , il n’eft pas naturel qu’ un homme qui
a des capitaux confidérables quitte un état fupé-
rieur pour paffer à un inférieur. Ainfi , dans l ’étae
aCtuel de l’Europe il ne fortira guère de fonds des
autres profeffions pour aller à la terre par le
moyen du fermage. 11 en fortira peut - être plus
dans la Grande-Bretagne que par-tout .ailleurs,
quoique les grands fonds qu’on y employé ainfi
dans certains endroits , aient en général été acquis
par la voie même du fermage , q u i, pour
l’ordinaire , eft peut-être la plus lente de toutes
les voies pour en acquérir. Cependant, après les
petits propriétaires, ce font p ar-tout les riçhes
& gros fermiers qui améliorent le plus. C ’ eft ce
qu’ils font en Angleterre, plutôt que dans toute
autre monarchie de l’Europe. On dit que les fermiers
de la Hollande & de Berne en Suiffe ne le
cèdent point à ceux d’Angleterre.
Outre ce qu’on vient de d ire, l ’ancienne politique
de l’Europe s’oppofoit à l’amélioration &
à la .culture , tant de la part du propriétaire que
de celle du fermier ; premièrement, par la prohibition
générale de l ’exportation du bled fans
une permiflion expreffe, ce qui paroît avoir été
un règlement univerfel ; & fecondement, par les
entraves qu’on mettoit au commerce intérieur ,
non-feulement du bled , mais de prefque toute
autre partie du produit de la ferme , par les loix
abfurdes contre les monopoleurs , les regratiérs
& les accapareurs, & par les privilèges des
foires &: des marchés. Nous avons déjà obferve
comment la défenfe d’exporter te bled , jointe à
des encouragemens donnés pour l ’importation du
bled étranger, nuifit à la culture de l’ancienne
Italie, 1e pays de l’Europe naturellement 1e plus
fertile , & qui écoit alors le fiège du plus grand
empire du monde. Il n’eft peut - être pas aifé
d’imaginer à quel point de découragement ces
mêmes caufes ont dû porter la culture dans des
pays moins fertiles.
T E S CH E N . Voyez l’article Silésie.
T E S T . ( Serment du Tefi. )
Tefi fignifie témoignage, & le ferment du
Tefi en Angleterre eft le ferment de témoignage
ou d ’épreuve de la religion que l’on profeffe.
II fert donc à diftinguer les anglicans des catholiques.
C ’eft une proteftation ou déclaration publique
fur certains articles de religion & de gouvernement
, que les rois & les parlemens ont
exigés de ceux qui prétendoient aux dignités de
l’églife anglicane ou aux charges du royaume.
On y a joint des loix^pénales contre les ecclé-
fiaftiques, les membres du parlement , les com-
mandans & officiers qui refufent de prêter 1e ferment
conformément à ces Tefis, dont voici les
principaux formulaires.
'Teft des eccléfîafiiques.
m Je N. déclare ici fans diffimulation, que j’approuve
& confens , foit en général , foit en
particulier, à tout ce qui eft compris dans le
livre intitulé , 1e livre des communes prières' ,
de Vadminifiration des facrtmens , & autres exercices
& cérémonies de féglife , fuiyaru Uufage de
réglife anglicane. «
Loi pénale.
« Celui qui manquera à faire cette déclaration,
fera entièrement déchu de toute promotion
eccléfiaftique. Tous tes doyens , chanoines ,
prébendaires, maîtres, chefs, profeffeurs, &c.
ne feront point admis à leur emploi , qu’ils
n’aient fait cette proteftation. »
Tell du ferment de fuprématie.
Je N", confelfe & déclare, pleinement convaincu
en ma confcience, que le roi eft 1e feul fonverain
de ce royaume & de toutes les puiflances
& feigneuries , auffi-bien dans tes chofes fpirituelles
& eccléfiaftiques que temporelles, & qu’aucun
prince étranger , prélat , état ou puiflance
n’a & ne peut avoir nulle jurifdidtion ni prééminence
dans les chofes eccléfiaftiques ou fpi rituelles
de ce royaume. «
Loi pénale.
» Perfonne ne pourra être reçu à aucune charge
otl emploi , foit pour 1e fpirituel, foit pour le-
temporel : il ne fera non plus admis à aucun ordre
ou degré du doélorat, qu’il n’ait prêté ce ferment,
à peine de privation dudit office ou emploi. ”
Henri V I I I , après fa féparation de l’églife
romaine , impofa la néccffité de ces Tefis , dont
les formules varient à quelques égards- fous tes
règnes d ’Edouard V I , d’Elifabeth , de Jacques I ,
& de Chartes I. En i 66z , Charles II révoqua
les Tefis, & accorda la liberté de confcience :
ce qu’il renouvella en 1669 & 1672. Jacques I I ,
qui lui fuccéda , en ufa de même j mais après la
révolution qui détrôna ce prince, te Tefi fut rétabli
, & on 1e prête encore aujourd’hui. En
1675 , 1e parlement drelfa un nouveau Tefi ,
par lequel tous ceux qui entroient dans quelque
charge publique, dévoient rejetter par ferment
le dogme de la tranfubftantiation , fous peine
d’exclufion defdites charges. On augmenra en
1678 ce Tefi, dont la formule eft conçue en
ces termes :
w Moi N. j’attefte , j'uftifie & déclare folem-*
nellement & fincèrement en la préfence de Dieu ,
que je crois que dans 1e facrement de la fcène
du feigneur il n’y a aucune tranfubftantiation des
élémens du pain & du vin dans 1e corps & le
fang de Jefus-Chrift , dans & après la confécra-
tion faite par quelque perfonne que ce fo it, &
que-l’invocation ou adoration delà vierge Marie ,
ou toute autre faint , & 1e facrifice de la mefle ,
de la manière qu’ils font en ufage à préfent dans
J’églife de Rome , eft fuperftition & idolâtrie. »
On déclare enfuite que ce ferment eft fait fans
aucune réticence , c’eli-à-dire fans aucune reftric-
tion mentale.
T E S T AM E N T . Lele&eur trouvera dans le
Dictionnaire de jurifprudence ce qui regarde les
tefiamens des particuliers.
Il fe préfenteroit ici une grande queftion à
décider, favoir, fi tes princes peuvent difpofer
dans leur teftament, d’autres chofes que de leur
mobilier} mais nous ne croyons pas devoir nous
en permettre ici la difcuffion.
Nous nous bornerons à quelques détails fur
le tefiament de Charles I I , qui donneront une