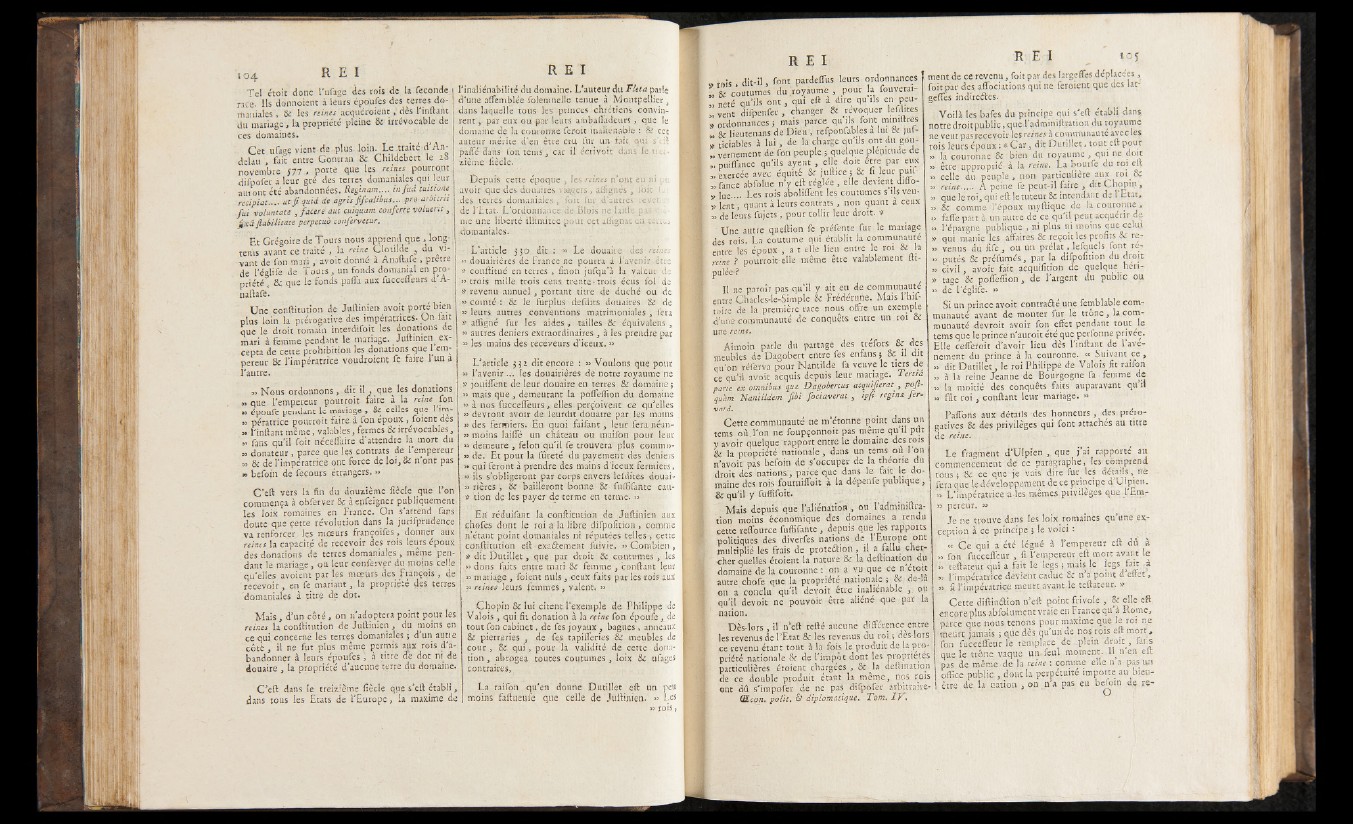
104 R E I
Tel étoit donc l'ufage des fois de la fécondé
race. Us donnoient à leurs époufes des terres domaniales
, & les reines acquérbientdes 1 inftant
du mariage, la propriété pleine & irrévocable de
ces domaines.
C e t ufage vient de plus loin. Le traité d'An-
delau , fait entre Gontran 8e Childebert le aB
novembre J77 , porte que les reines pourront ,
difpofer à leur gré des terres domaniales qui leur
auront été abandonnées. Reginam....infuâ tuitione
recipiat.... ne f i quid de àgris fifcalibus... pre arbitm
fu i voluntate , faeere aut cuiquam conferre voluent ,
fixa Jlakilhaie perpétua confervetur.
Et Grégoire de Tours nous apprend que , long-.
tems avant ce traite , la reine Clotildé s du ^vivant
de fon mari, avoit donné à Anaftafe, prêtre
de l’églife de T ou r s , un fonds domanial en propriété
, 8e que le fonds palfa aux fucceffeurs d’A-
naftafe.
Une conftitution de Juftinien avoit porté bien
plus loin la prérogative des impératrices. Qn fait
que le droit romain interdifoit les donations de;
mari à femme pendant le mariage. Juftinietn excepta
de cette prohibition les donations que 1 em~
pereur & l'impératrice voudroiçnt fç faire 1 un a
l ’autre.
% Nous ordonnons , dit i l , que^ les donations
» que l’empereur pourroit faire a la reine ^fon
»> époufe pendant le mariage * & celles que 1 im-
» pératrice pourroit faire a fon epoux >^foient dçs
» l'inllant même» valables, fermes & irrévocables,
T, fans qu'il foit nécelfaire d'attendre la mort du
=, donateur, parce que les contrats de l'empereur
m & de l'impératrice ont force de loi, 8c n pnt pas
» befoin de feçours étrangers, *■
C ’eft vers la fin du douzième fiècle que l’on
commença à obferver & à enfeigner publiquement
les loix romaines en France. On s'attend fans
doute que cette révolution dans la jurifprudence
va renforcer les moeurs françqifes, donner aux
reines la capacité de recevoir des rois leurs époux
des donations de terres domaniales , mêipe pendant
le mariage, ou leur conferver du mojns celle
qu'elles avoient par les moeurs des François , de
recevoir, en fe mariant, la propriété clés terres
domaniales à titre de dot.
M a is, d'un c ô té , pn n’adoptera point pour les
reines la conftitution de Juftinien , du moins en
ce qui concerne les terres domaniales ; d un autie
c ô té , il ne fut plus même permis aux rois d’abandonner
à leurs époufes \ à titre de dot ni de
douaire , la propriété d’aucune terre du domaine.
C ’eft dans le treizième fiècle que s’ eft établi,
dans tous les Etats de l’Europe> la maxime de
R E l
l’inaliénabilité du domaine. L’auteur du Fleta parle
d'une affemblée folemnelle tenue à Montpellier,
dans laquelle tous les princes chrétiens convinrent,
par eux ou par leurs ambaffadeurs > que le
domaine de la couronne feroit inaliénable : 8c cet
au.teur m.é.rite d’en être cru lur un fait, qui s‘
pafte dans ion teins . cai; il écrivoit dans fe.tt
zième fiècle.
Depuis cette époque , les reines n’ont eu ni
avoir que des douaires vMgers, aflig nés , foit
des terres domaniales., foit fur d’sutres revel
de l'Etat. L'ordonnance.: de Blois rie lailïe pas s:
me une liberté illimitée pour cet affignat eu tei
domaniales.
L’article 3 30 dit » Le douaire des r e in e s
»■> douairières de France ne pourra à l’avenir erre
» conftitué en terres > finon jufqu’à la valeur de
» trois mille trois cens trente-trois écus fol de
» revenu annuel, portant titre de duché ou de
» com té : 8c le furplus defdits douaires 8c de
» leurs autres conventions matrimoniales, fera
» afligné fur les aides , tailles 8c équivalens,
» autres deniers extraordinaires, à les prendre par
» les mains des receveurs d’iceux. È
L’ article 532 dit encore : » Voulons que pour
» l’avenir... les douairières de notre royaume ne
» jouiffent de leur douaire en terres 8c domaine;
» mais que , demeurant la poffeffion du domaine
» à nos fucceffeurs, elles perçoivent ce qu’elles
» devront avoir de leurdit douaire par les mains
» des fermiers. En quoi faifant, leur fera néan-
» moins laiffé un château ou maifon pour leur
» demeure , félon qu’il fe trouvera plus commo-
» de. Et pour la fureté du payement des deniers
» qui feront à prendre des mains d’iceux fermiers,
» ils s’obligeront par corps envers lefdites douai-
» riçres | 8c bailleront bonne 8c fuffifante cau-
» tion dç les payer de terme en terme. »
En réduifant la conftitution de Juftinien aux
chofes dont le roi a la libre difpofition , comme
n’étant point domaniales ni réputées telles -, cette I
co’nftitution eft • exactement fuivie, »C ombien, I
» dit Outiller, que. par droit 8c, coutumes, les
» dons faits entre mari 8c femme , confiant leur I
33 mariage , foient nuis, ceux -faits par les rois aux
» reines leurs femmes , valent, n
Chopin & lui citent l’exemple de Philippe de
Valois , qui fit donation à la reine fon époufe , de
tout fon cabinet, de fes joyaux, bagnes , anneaux
& pierreries , de fqs tapifferies & meubles de
c o u r , 8c qui , pour là validité de cette donation
, abrogea toutes coutumes, loix 8c ufages
contraires,.
La raifon qu’en donne Dutillet eft un peu
moins faftueufe que celle de Juftinien. »3 Les
33 rois,
R E I
mi s , dit-il, font pardeffus leurs ordonnances
■ Rr coutumes du royaume , pour la fouverai-
neté qu'ils ont , qui eft à dire qu'ils en peu- j
„ vent difpenfer, changer 8r révoquer lefdites
, ordonnances ; mais parce qu'ils font mimftre_s
*, & lieutenans de D ieu , refponfables a lui & )ul-
* ticiables à lu i, de la charge qu’ils ontçlu gou-
ot vernement de fon peuple ; quelque plénitude de
„ puiffance qu’ils ayent , elfe doit etre par eux
„ exercée avec équité Sc jufticéj & fi leur puif-
„ fance abfolue n'y eft réglée , elle devient diflo-
» lue-— Les rois aboliCTent les coutumes s ils veuillent
" quant à leurs contrats', non quant à ceux
„ de leurs fujets, pour tollir leur droit. »
Une autre quçftion fe préfente fur le mariage
des rois, La coutume qui établit la-communauté
entre les époux , a t elle lieu entre le roi & la
reine ? pourroit-elle même être valablement iti-
pulée*?
Il ne paroît pas qu’ il y ait eu de communauté
entre Charles-le-Simple 8c Frédérurie. Mais 1 hif-
toire de la première race nous offre un exemple
d’une communauté de conquets entre un roi 8c.
une reine.
Aimoin parle du partage des tréfors & des
meubles de Dagobert entre fes enfans 5 8c il dit
qu’on réferva pour Nantilde fa veuve le tiers de
ce qu’ il avoit acquis depuis leur mariage. Terua
varie ex omnibus qus. Dxigobertus acquifierat , pojt-
quarn Nantildem fibi fociaverat , ipfi regins. Jer-
yatâ. • . / ■
Cette communauté ne m’étonne point dans un
tems où .l’on ne foupçonnoit pas même qu’ il put
y avoir quelque rapport entre 1e domaine des rois
& la propriété nationale, dans un tems ou 1 on
n’avoit pas befoin de s’occuper de la théorie du
droit des nations, parce que dans le-fait le domaine
des rois fourniffoit à la depenfe publique,
& qu’il y fuffifoit.
Mais depuis que l’aliénation, oip l adminiftra*
tion moins économique des domaines a rendu
cette reffource fuffifante, depuis que les rapports
politiques des diverfes nations de 1 Europe ont
multiplié les frais de protection , il a fallu chercher
quelles étoient la nature'& la deltination du
domaine de la couronne : on a vu que ce n etoit
autre chofe que la propriété nationale; de-la
011 a conclu qu’il devoit etre inaliénable où
qu’il devoit ne pouvoir être aliéné que par la
nation.
Dès-lors, il- n’eft refté aucune différence entre
les revenus de l’Etat & les revenus du roi,î des-lors
ce revenu étant tout a la fois le produit de la pio-..
priété nationale & de 1 impôt dont les propriétés
particulières étoient chargées , & Ja deftination
de ce double produit étant la même, nos rois
ont dû s’impofer de ne pas difpofer arbitraire-,
(Econ. polie. & diplomatique. Tom. IV ,
R E I 105
ment de ce revenu, foit par des largeffes déplacées,
foit par des, affociations qui ne feraient que des lar-
géffes indirectes.
Voilà les bafes du principe qui s’ eft établi dans,
notre droit public, que l’adminiftration du royaume
rie veut pas^ecevoir \e$ reines a communauté avec les
rois leurs époux : « C a r , dit Dutillet, tout eft pour
33 la couronne & bien du royaume , qui ne doit
33 être approprié à la reine. La bourfe du roi eft
»3 celle du peuple 3 non particulière aux roi ôc
33 reine..... A peine fe peut-il faire , dit Chopin ,
»» que fe roi, qui eft le tuteur & intendant de l Etat,
33 & comme l’époux myftique de la couronne ,
» faffe part à un autre de ce qu’il peut acquérir dç
»3 l ’épargne publique , ni plus ni moins que celui
» qui manie les affaires 8c reçoit les profits 8c re-
33 venus du fife, ou un prélat, lefquels font r%
•33 pûtes 8c préfumés, par la difpofition du droit
33 c iv il, avoir fait acquifition de quelque heri-
» tage 8c poffeffion, de l ’argent du public ou
33 de 1 eglife. *3
Si un prince avoit contracté une .femblable communauté
avant de monter fur fe trône, la communauté
devroit avoir fon effet pendant tout le
tems que le prince n’auroit été que perfonne privée.
Elle cefferoit d’avoir lieu dès l ’inftant de 1 ave-
nement du prince à la couronne. « Suivant ce ,
» dit Dutillet , 1e roi Philippe de Valois fit raifon
33 à la reine Jeanne de Bourgogne fa femme de
33 la moitié des conquêts faits auparavant qu ii
33 fût r o i , confiant leur mariage. 33
1 Paffons aux détails des honneurs, des prérogatives
8c des privilèges qui font attaches au titre
de reine.
Le fragment d’Ulpien , que j ai rapporte au
commencement de ce paragraphe, les comprend
tous ; 8c ce que je vais dire fur les décarisne
.fera que le développement de ce principe d’Ulpien.
» L’impératrice a les, mêmes privilèges que l’Em-
| pereur. 33
Je ne trouve dans les loix romaines qu’une exception
à ce principe ; le voici :
‘ ce C e qui a cté légué à l’empereur eft dû à
,'» fon fucceffeur , fi l’empereur eft mort avant le
L tefiateur qui a fait le legs '; mais le legs fak -à
33 F impératrice dévient caduc 8c n’à point d effet,
3> fi l’impératrice meurt ayant.le teftateur. »
Cette diftinétion n’ eft point frivole , 8c elle eft
encore plus abfoiument vraie en France qu a Rome,
parce que nous tenons pour maxime que fe roi ne
j meurt jamais 5 que dès qu un de nos rois eft mort*
fon fucceffeur 1e remplace de - plein drok , fatfe
que 1e trône vaque un feul moment. 11^ n en eft
1 pas de même de la reine : comme elle n a pas lin
office public , dont la perpétuité importe au bien-
I être de la nation , on V a pas eu befoin dq re