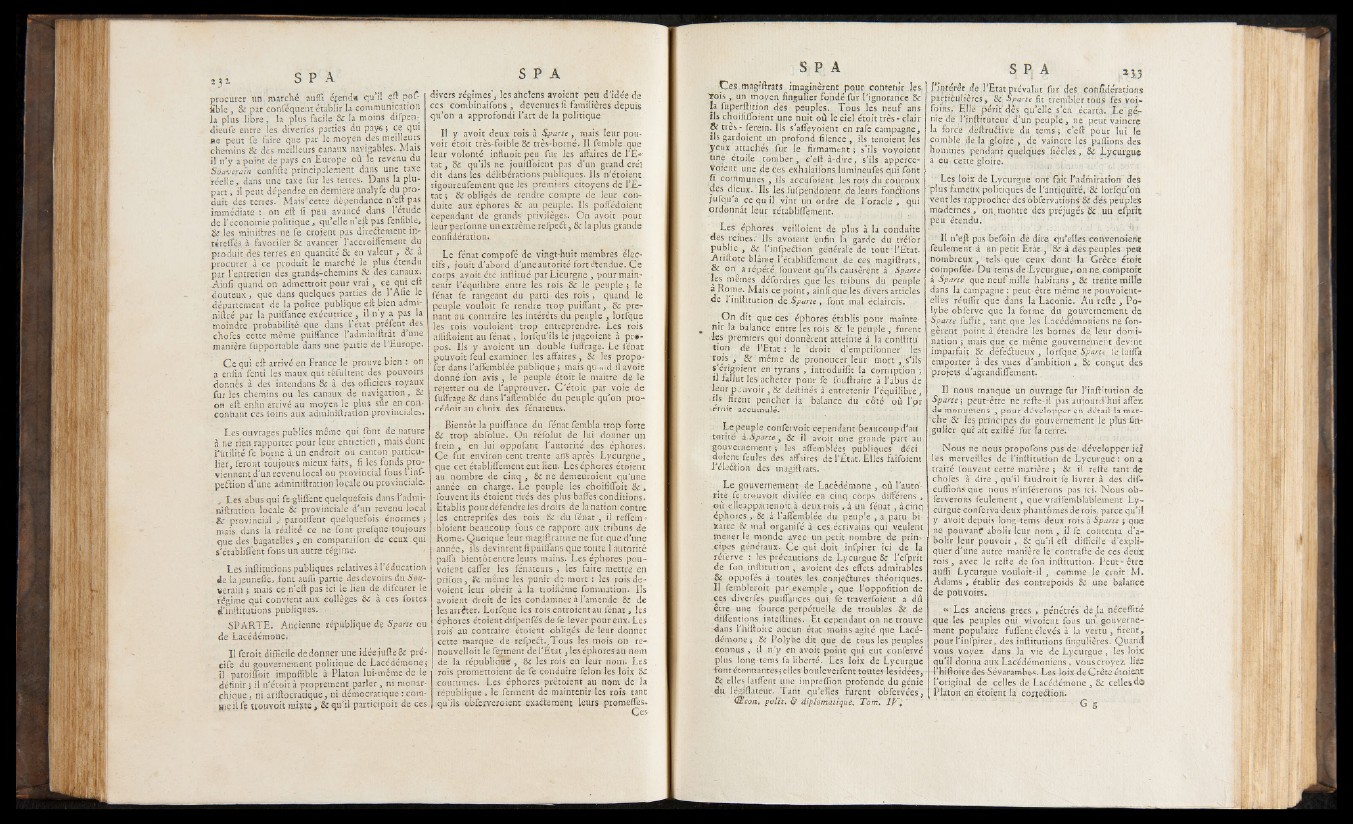
5 3 i S P A S P A
procurer un, marché auffi éf end« qu’ i! eft Ppf-
fible, & par conlequent établir la communication
la plus libre, la plus facile & la moins difpen*
dieufe entre les diverfes parties du payé ; ce qui
us peut fe faire que par le moyen des meilleurs
chemins & dés meilleurs canaux navigables-Mais
il n’ y a point de pays en Europe où le revenu du
Souverain confine principalement dans une taxe
réelle, dans une taxe fur les terres. Dans la plupart
, il peut dépendre en derniere analyfe du produit
des terres. Mais'cette' dépendance n’eftpas
immédiate : on eft li peu avancé dans l’ étude
de réconomie politique , qu’elle n’ eft pas fenfible,
& les, minières ne fe croient pas directement in-
téreffés à favorifer 8z avancer l’accroiffement du
produit des terres en quantité & en valeur » & a
procurer à ce produit le marché le plu« étendu
par l’entretien des grands-chemins & des canaux.
Ainfî- quand on admettroit pour vrai , ce^ qui eft
douteux, que dans quelques parties de l’Afie le
département de la police publique eft „bien admi-
niftré par la puiffance exécutrice 3 il n’y a pas la
moindre probabilité que dans l’état prefent des
chofes cette même puiffance l’adminiftrât dune
manière fupportable dans une partie de l'Europe.
C e qui eft arrivé enJFrance le prouve bien : on
a enfin fenti les maux qui réfultent des pouvoirs
donnés à des intendans & à des officiers royaux
fur les chemins ou les canaux de navigation, &
on eft enfin arrivé au moyen le plus sûr en con-
confiant ces foins aux adminiftration provinciales.
Les ouvrages publics même qui font de nature
à ne rien rapporter pour leur entretien , mais dont
l’Utilité fe borne à un endroit ou canton particulier,
feront toujours mieux faits, fi les fonds proviennent
d’un revenu local ou provincial fous l'inf-
peétion d’une adminiftration locale ou provinciale.
, Les abus qui fe gliffent quelquefois dans l’admi-
niftration locale & provinciale d’ un revenu local
&■ provincial P paroiffent quelquefois énormes ;
mais dans la réalité ce ne font prefque toujours
que des bagatelles, en comparaifon de ceux .qui
s’établiftent fous un autre régime. ,
Les inftitutions publiques relatives à l’éducation
de la jeunefle, .fQnt auffi partie des devoirs du Souverain
; mais ce n’ eft pas ici le lieu de difcuter le
regime qui convient aux collèges & à ces fortes
d’inftitijtiqns publiques. •
SPAR TE . Ancienne république de Sparte ou
de Lacédémone,
Il feroit difficile de donner une idéejufte & précife
du gouvernement politique de Lacédémone y
il paroifloit impoffible à Platon lui-même de le
définir 5 il n’étoir à proprement parler, ni monarchique
, ni ariftocratique, ni démocratique : com-
Eïçftfç trouvoit r a i î t t e q u ’il participée de ces,
divers régimes", les ahcîens avoient peu d’idée de
ces combinaifons j devenues fi familières depuis
qu’on a approfondi Part de la politique
II y avoit deux rois à Sparte, mais leur pouvoir
étoit très-foible & très-borné. 11 femble que
leur volonté in fl noie peu fur les affaires de l’É--
ta t, & qu’ ils ne jouiffoient pas d’un grand créa
dit dans les délibérations publiques. Ils n’étoient
rigoureufement que les premiers citoyens de l’Etat
; & obligés de rendre compte de leur conduite
aux éphores & au peuple. Ils poffédoient
cependant de grands privilèges. On avoit pour
leur perfonnè un extrême îe fp ed , & la plus grande
confidération.
Le fénat compofé de vingt-huit membres électifs
, jouit d’abord d’jiné autorité fort étendue. C e
corps avoit été inftitué par Licurgne , pour maintenir
l’équilibre entre les rois & le peuple ; le
fénat fe rangeant du parti des rois , quand le
peuple vouloit fe rendre trop puiffant, & prenant
au contraire les intérêts du peuple , lorfque
les rois voulolent trop entreprendre. Les rois
alfiftoient au fénat, lorfqu’ ils le jugeofent à propos.
Ils y avoient un double fuffrâge. Le fénat
pquvoit feul examiner les affaires, & les propo-
\ fer dans l’aftemblée publique 3 mais qu.t«sd il avoit
donné Ton av is , le peuple étoit le maître de le
rejetter ou de l ’approuver. C ’étoit par voie de
fuffrâge & dans l’aflemblée du peuple qu’on proc
éd â t au choix des fénateurs.
Bientôt la puiffance du fénat fembla trop forte
& trop abfolue. On rélolut de lui donner un
frein , en lui oppofant l’autorité des éphores.
C e fut environ cent trente ans après Lycurgue,
que cet établilfement eut lieu. Les éphores étoient
au nombre de c in q , & ne demeuroient qu'une
année en charge. Le peuple les choififfoit & ,
fouvent ils étoient tirés des plus baffes conditions.
Etablis pour défendre les droits de la nation contre
les entreprifes des rois & du fénat , il reffem>
bioient beaucoup fous ce rapport aux tribuns de
Rome. Quoique leur magiftrattire ne fut que d’ une
année, ils devinrent fi puiffans que toute l'autorité
paifa bientôt entre leurs mains,. Les éphores pou-
voient cafter les fénateurs, les faire mettre en
prifon, & même les punir de mort : les rois dévoient,
leur pbéir à la troifième fommation. Ils
avoient droit de les condamner à l’amende & de
les arrêter. Lorfque les rois entroient au fénat, les
éphores étoient difpenfés de fe lever pour eux. Les
rois" au contraire étoient obligés de leur donner
cette marque de refpeél. Tous les mois on renouvelait
le ferment de l’É ta t, les éphores au nom
de la république, & les rois en leur nom. Les
1 rois promettaient de fe conduire félon-les loix &
coutumes. Les éphores prêtoient au nqm de la
république, le ferment de maintenir les fois tant
qu’ils obferveroient exactement leurs promettes.
S P A
Ces.magtftrats imaginèrent pour contenir Içs.
Tois , un moyen fingulier fondé für l ’ignorance 8c
la fuperfticion des peuples. Tous les neuf ans
ils choifiifoient une nuit où le ciel étoit très - clair
& très - ferein. Us s’atteyoient en rafe campagne,
ils gardoient un profond filence , ils tenoient les
yeiix attachés ,fur le firmament; s’ils voyoient;
Vn5 étoile .tomber, c’eft à-dire, s’ils apperce-
vqient une,de ces exhalaifpns lûmineufes qui font
fi communes , ils acciffoient les pois cju Côdroùx
• s <y>eux* üs le? fufpendoient de leurs fondions |
jufqu’à ce qu il vînt un ordre de l'oracle , qui:
ordonnât leur rétabliffement.
Les éphores Veilloient de plus à la conduite
des-reines.' Us avoient enfin la garde du tréfor
public , 8c l’infpeétion générale de tout T É fa t .1
Ariftote blâme l’établiffement ,de ces .magiftrats,
& on a répété fouvent qu’ îls causèrent à Sparte
les mêmes défordres que les tribuns dû peuple
a Rome. Mais ce point, ainiîquelcs divers articles
de 1 inftitution de.Sparte , font mal éclaircis. '
On dit que ces éphores établis pour maintenir
la balance entre les rois & le peuple,- furent
les premiers qui donnèrent atteinte à la conftitp
tion dé l’Etat : le droit d’emprifonnef les:
V & même de prononcer leur mort , s’ils
s érigoient en tyrans , introduifit la corruption ;
il fallut les acheter pour fe fouftraire à l’abus de
leur pouvoir, & deftinés à entretenir l’équilibré , i
ijs firent pencher la balance du côté où l ’or
'étoit accumulé/
Le peuple confervoit cependant beaucoup d’au
tarifé à-Spurte y & il avoir une grande part a'u I
■ gouvernement 3 les affemblées publiques déci
dotent feules des affaires de l’État. Elles fàifoient
i ’éleélion des vnagiftrats.
Le gouvernement de Lacédémone, où l’auto-'
titéTe .trpuvpit divifée en cinq corps différens ,
où e, 1 leappai:tenoit-, à deux rois , à un fénat, à cinq
éphores , & ;à l’affemblée du peuple , a paru bi-
zarre & mal organifé à ces,écrivains qui veulent
mener le monde avec un petit nombre de principes
généraux. C e qui doit infpirer ici de lai
réferve : les précautions de Lycurgue & l’efprit
de fon inftitution , avoient des effets admirables
& oppofés à toutes les conjectures théoriques.
Il fembleroit par- exemple , q:ue l’oppofition de
ces diverfes puiflances qui, fe traverfoient a dû
être une fource perpétuelle de troubles 8r de
diffentions inteftinès. Et cependant on ne trouve
dans l’hiftoke aucun état moins agité que Lacédémone;
& Polybe dit que de tous les peuples
connus , il .n’y en avoit point qui eut confervé
plus long-tems fa liberté. Les loix de Lycurgue
•font étomTantesi elles bouleverfent toutes- lesidées,
& elles îaiftent une impreffipn profonde du génie
4u Jé^iflateur. Tant qu’ elles furent obfervée.s ,
QEcon. polit. & diplomatique. Toni. Ip~i '
S P. A
l’/ntérêt de TEtat prévalut fur des conff.dérations
particulières , & Sparte fit trembler tou$ fes voi-
Toiris. Elle périt dès qu’ elle .s’èiï écàrtâ. JLe'génie
de rinftifuteur d’un peuple, ne peut vaincre
la forcé deftru&ive du tems; c’eft pour lui le
comble ffe,la gloire , de vaincre lés.pallions des
hommes pènd'anc quelques fiecîes., & Lycurgue
a eu > c'etee gloire.
Les lbix de Lycurgue ont fait l'admiration des
'pluç.fameux politiques de l ’antiquité, & lorfqu’o’ii
Teüt les-ràpprpcher de^ ôbfefVan'oh^ & dés peuples
modernes ,' on.mohçre des préjugés & un c^ rit
peu étendu.
■ Il n’eft pas befoin dédire cju’ elles cohvenoieht
Xèulement à un petit Etat & à dés peuples pea
■ nombreux, ;t-els-que ceux dont la Grèce étoit
coinpofée; Dû tems de Lycurgue, on ne comptait
à Sparte que neuf mille habitans , & tfente mille
dans la campagne : peut-être même ne pouvoient-
e 1 le s féüflir que dans la Laconie. Au refte , Polybe
obferve que la forme du gouvernement de
■ Sparte, fuffjit , tant.que les Lacédémoniens ne fon-
gèrent .point à. étendre les bornes de. leur domination
; mais que ce même gouvernement devint
imparfait .& défééfueux , l o r f q u e ' l e J a i f l a
emporter à - des vues d’ambition , & conçut de$
projets d’agrandiffement.
Il nous manque un ouvrage fur rinft'tution de
Sparte ; peut-être ne refte-il pas aujourd’hui affez
de monumens , pour développer en détail la mar-
'che ,& les principes du gouvernement le plus fin-
:gülier qui ait exifté fùr la terre.
Nous ne nous propofons pas de développer ici
les merveilies de l’ihftitûtion dé Lycurgue : on a
traité fouvent cette matière ; &: il refte tant de
chofes a dire , qu’il faudroit fe livrer à des dif-
cuflîons que nous n’ inférerons pas ici. Nous ob-
feryerons feulement, que vraifemblablemeitt Lycurgue
conferva deux pbantômes de rois, parce qu’il
y avoit depuis long-tems deux rois à Sparte ; que
ne pouvant abolir leur nom , il fe contenta d’abolir
leur pouvoir, ■ & qu’il eft difficile d'expliquer
d’ une aut're manière lê'contrafte de ces deux
rois, avec le refte de fon inftitution. Peut-être
auffi Lycurgue voûloit-il , comme , Je croit M.
Adams > établir des contrepoids & une balance
de pouvoirs.
: « Les anciens-grecs , pénétrés de la néceffité
que les peuples qui yivoient.'fous un. gouverné-
ment populaire fuffentélevés à la vertu, firent,
pour l’infpirer, des inftitutions fingultères. Quand
vous voyez dans la vie de Lycurgue , les loix
qu’ il donna aux Lacédémoniens , vous croyez 'liée
•l’hi-ftofte-des- Sév-a-mmbes. Les loix de Crète étoient
l’original de celles de Lacédémone , & celles d©
Platon eh étoient la corteélion.
G g