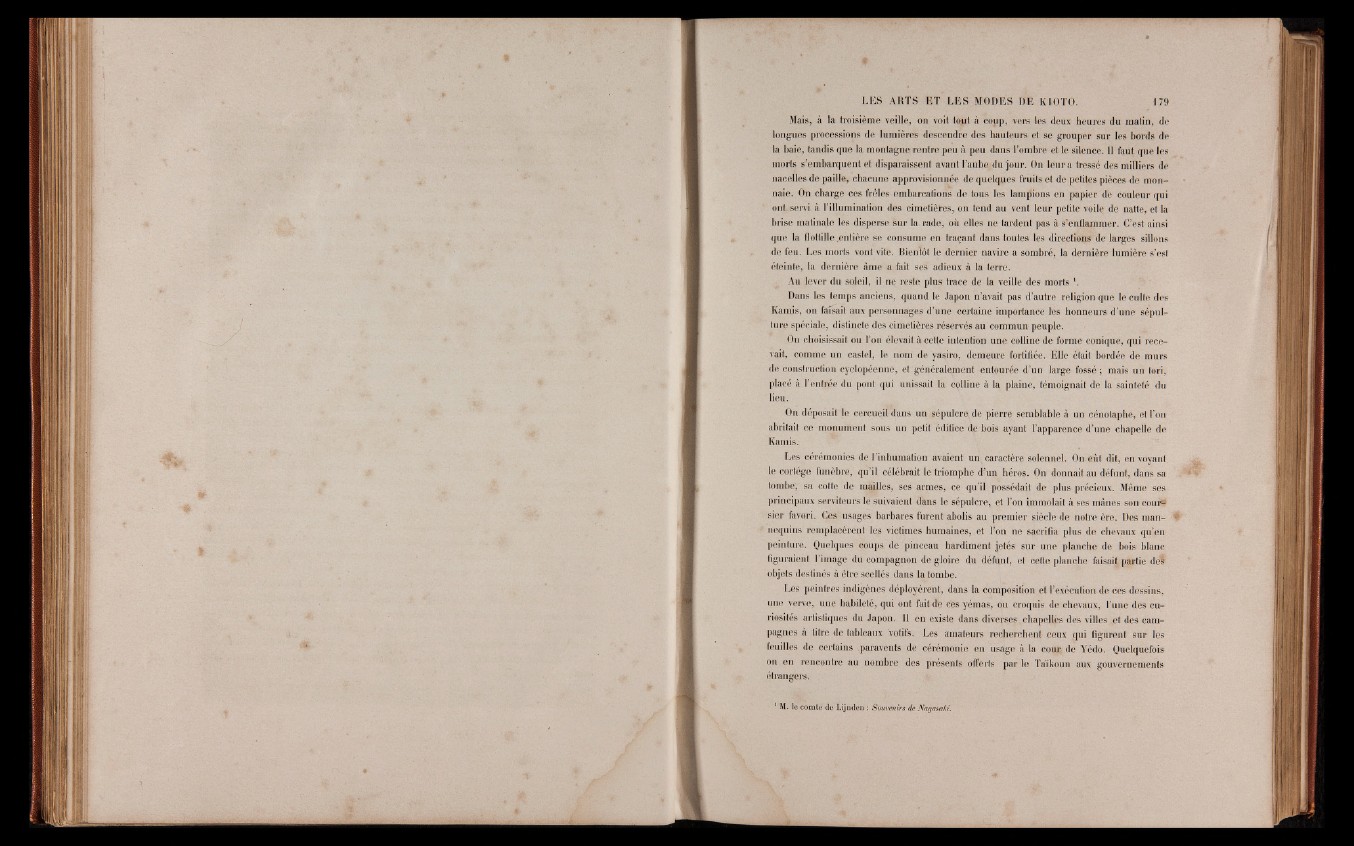
Mais, à la troisième veille, on voit tout à copp, vers les deux heures du matin, de
longues processions de lumières descendre des hauteurs et se grouper sur les hords de
la baie, tandis que la montagne rentre peu à peu dans l’ombre et le silence. 11 faut que les
morts s’embarquent et disparaissent avant l’aube du jour. On leur a tressé des milliers de
nacelles de paille, chacune approvisionnée de quelques fruits et de petites pièces de monnaie.
On charge ces frêles embarcations de tous les lampions en papier de couleur qui
ont. servi à l’illumination des cimetières, on tend au vent leur petite voile de natte, et la
brise matinale les disperse sur la rade, où elles ne tardent pas à s’enflammer. C’est ainsi
que la flottille .entière se consume en traçant dans toutes les directions de larges sillons
de feu. Les morts vont vite. Bienïôt le dernier navire a sombré, la dernière lumière s’esl
éteinte, la dernière âme a fait ses adieux à la terre.
Au lever du soleil, il nç reste plus trace de la veille des morts l .
Dans les temps anciens, quand le Japon n’avait pas d’autre religion que le culte des
Kamis, on faisait aux personnages d’une certaine importance les honneurs d’une sépulture
spéciale, distincte des cimetières réservés au commun peuple.
On choisissait ou l’on élevait à cette intention une colline de forme conique, qui recevait,
comme un castel, le nom de yasiro, demeure fortifiée. Elle était bordée de murs
de construction cyclopéenne, et généralement entourée d’un large fossé; mais un tori,
placé à l’enfrée du pont qui unissait la cçlline à la plaine, témoignait de la sainteté du
lieu.
On déposait le cercueil dans un sépulcre de pierre semblable à un cénotaphe, et l’on
abritait ce monument sous un petit édifice de bois ayant l’apparence d’une chapelle de
Kamis.
Les cérémonies de l’inhumation avaient un caractère solennel. On eut dit, envoyant
le cortège funèbre, qu’il célébrait le triomphe d’un héros. On donnait au défunt, dans sa
tombe, sa cotte de mailles, ses armes, ce qu’il possédait de plus précieux. Même ses
principaux serviteurs le suivaient dans le sépulcre, et l’on immolait à ses mânes son cour5^
sier favori. Ces usages barbares furent abolis au premier siècle de notre ère. Des mannequins
remplacèrent les victimes humaines, et l’on ne sacrifia plus de chevaux qu’en
peinture. Quelques coups de pinceau hardiment jetés sur une planche de bois blanc
figuraient l’image du compagnon de gloire du défunt, et cette planche faisait partie de!'
objets destinés à être scellés dans la tombe.
Les peintres indigènes déployèrent, dans la composition et l’exécution de ces dessins,
une verve, une habileté, qui ont fait de ces yémas, ou croquis de chevaux, l’une des curiosités
artistiques du Japon. Il en existe dans diverses chapelles des villes et des campagnes
à titre de tableaux votifs. Les amateurs recherchent ceux qui figurent sur lés
feuilles de certains paravents de cérémonie en usage à la cour de Yédo. Quelquefois
on en rencontre au nombre des présents offerts par le Taïkoun aux gouvernements
étrangers.
M. le comte de Lijnden : Souvenirs de Nagasaki.