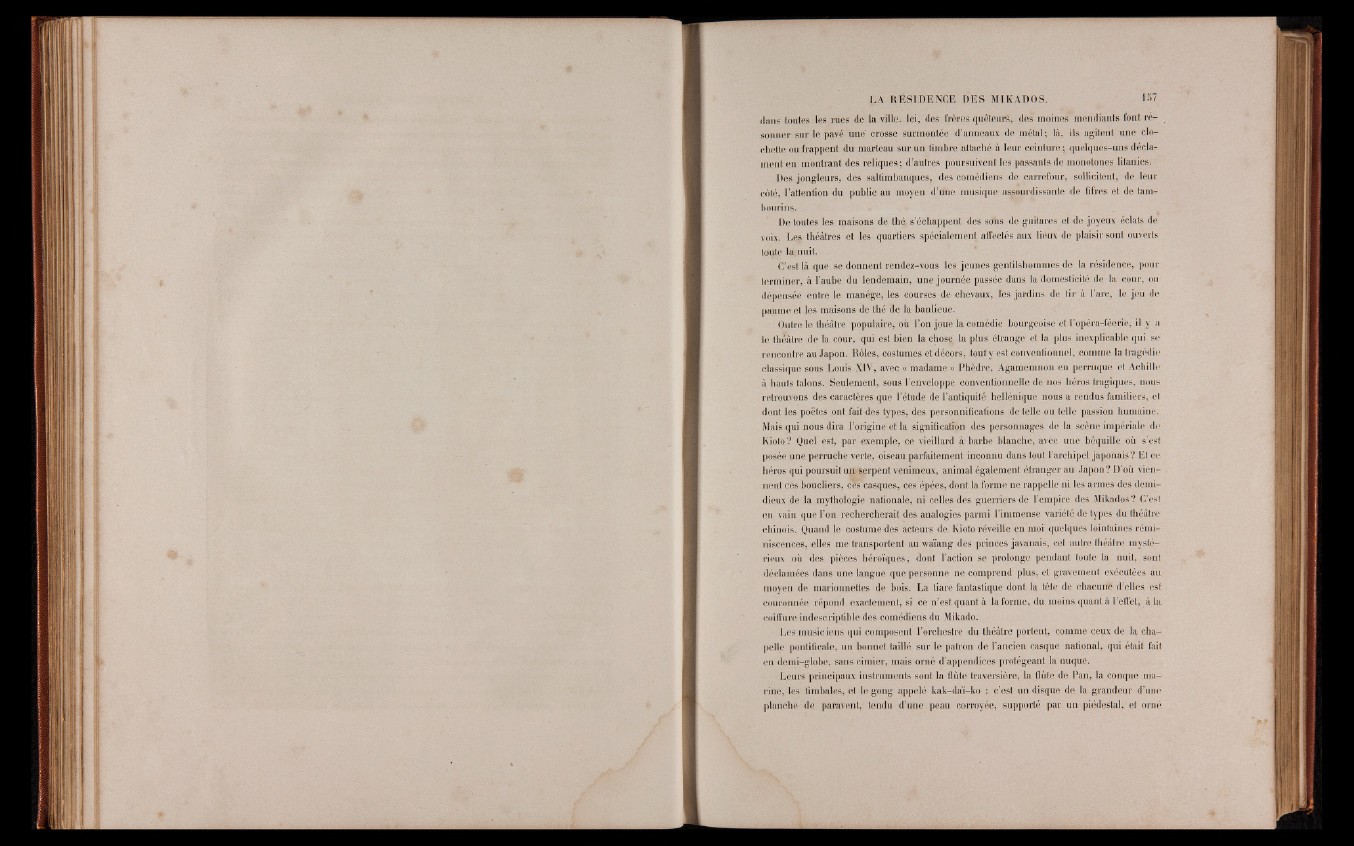
dans toutes les rues de la ville. Ici, des frères quêteurs, des moines mendiants font résonner
sur le pavé une crosse surmontée d’anneaux de métal ; là, ils agitent une clochette
ou frappent du marteau sur un timbre attaché à leur ceinture ; quelques-uns déclament
en montrant des reliques; d’autres poursuivent les passants de monotones litanies.
Des jongleurs, des saltimbanques, des comédiens de carrefour, sollicitent, de leur
côté, l’attention du public au moyen d’une musique' assourdissante de fifres et de tam-
bourins.
De toutes les maisons de thé s’échappent des soiis de guitares et de joyeux éclats de
voix. Les théâtres et les quartiers spécialement affectés aux lieux de plaisir sont ouverts
toute la nuit.
C’est là que se donnent rendez-vous les jeunes gentilshommes de la résidence, pour
terminer, à l’aube du lendemain, une journée passée dans la domesticité de la cour, ou
dépensée entre le manège, les courses de chevaux, lès jardins de tir à l’arc, le jeu de
paume et les maisons de thé de la banlieue.
Outre le théâtre populaire, où l’on joue la comédie bourgeoise et l’opéra-féerie; il y a
le théâtre de la cour, qui est bien la chose, la plus étrange et la plus inexplicable qui se
rencontre au Japon. Rôles, costumes et décors, tout y est conventionnel, comme la tragédie
classique sous Louis XIV, avec « madame » Phèdre, Agamemnon en perruque et Achille
à hauts talons. Seulement, sous l’enveloppe conventionnelle de nos héros tragiques, nous
retrouvons des caractères que l’étude de l’antiquité hellénique nous a rendus familiers, et
dont les poètes ont fait des types, des personnifications de telle ou telle passion humaine.
Mais qui nous dira l’origine et la signification des personnages de la scène impériale de
Kioto? Quel est, par exemple, ce vieillard à barbe blanche, avec une béquille où s’est
posée une perruche verte, oiseau parfaitement inconnu dans tout l’archipel japonais? Et ce
héros qui poursuit un serpent venimeux, animal également étranger au Japon? D’où viennent
ces boucliers, ces casques, ces épées, dont la forme ne rappelle ni les armes des demi-
dieux de la mythologie nationale, ni celles des guerriers de l’empire des Mikados? C’est
en vain que l’on rechercherait des analogies parmi l’immense variété de types du théâtre
chinois. Quand le costume des acteurs de Kioto réveille en moi quelques lointaines réminiscences,
elles me transportent au waïang des princes javanais, cet autre théâtre mystérieux
où des pièces héroïques, dont l’action se prolonge pendant toute la nuit, sont
déclamées dans une langue que personne ne comprend plus, et gravement exécutées au
moyen de marionnettes de bois. La tiare fantastique dont la tête de chacune d’elles est
couronnée répond exactement, si ce n’est quant à la forme, du. moins quant à l’effet, à la
coiffure indescriptible des comédiens du Mikado.
Les music iens qui composent l’orchestre du théâtre portent, comme ceux de la chapelle
pontificale, un bonnet taillé sur le patron de l’ancien casque national, qui était fait
en demi-globe, sans cimier, mais orné d’appendices protégeant la nuque.
Leurs principaux instruments sont la flûte traversière, la flûte de Pan, la conque marine,
les timbales, et le gong appelé kak-daï-ko : c’est un disque de la grandeur d’une
planche de paravent, tendu d’une peau corroyée, supporté par un piédestal, et orné