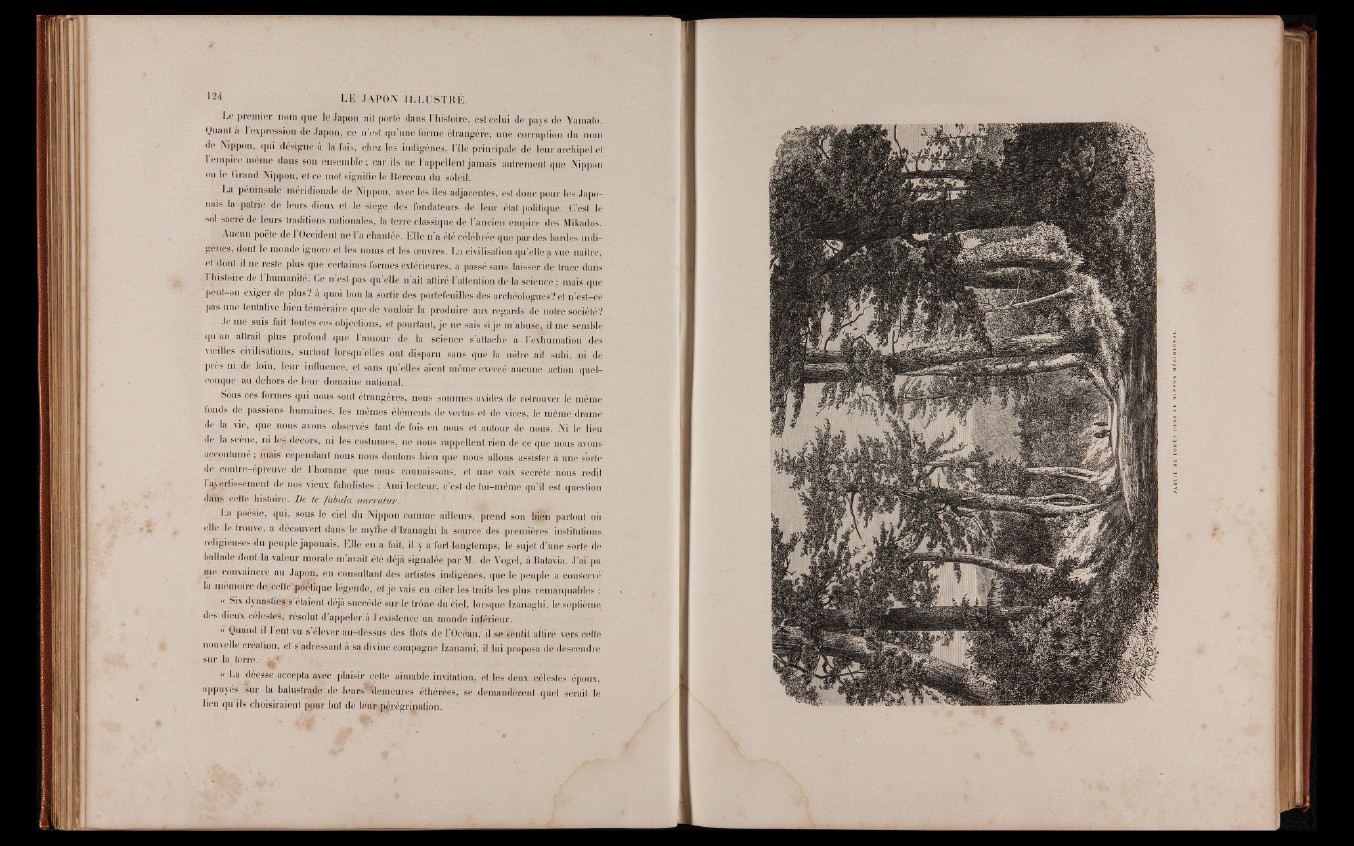
Le premier nom que le Japon ait porté dans l’histoire, est celui de pays de Yamato.
Uuantà l’expression de Japon, ce n ’est qu’une forme étrangère, une corruption du nom
de Nippon, qui désigne à la fois, chez les indigènes, l’île principale de leur archipel el
l’empire même dans son ensemble ; car ils ne l’appellent jamais autrement que Nippon
ou le Grand Nippon, et ce mot signifie le Berceau du soleil.
La péninsule méridionale de Nippon, avec les îles adjacentes, est donc pour les Japonais
la patrie de leurs dieux et le siège des fondateurs de leur état politique. C’est le
sol sacré de leurs traditions nationales, la terre classique de l’ancien empire des Mikados.
Aucun poëte de l’Occident ne l’a chantée. Elle n ’a été célébrée que par des bardes indigènes,
dont le monde ignore et les noms et les oeuvres. La civilisation qu’elle a vue naître,
et dont il ne reste plus que certaines formes extérieures, a passé sans laisser de trace dans
l’histoire de l’humanité: Ce n’est pas qu’elle n’ait attiré l’attention de la science ; mais que
peut-on exiger de plus? à quoi bon la sortir des portefeuilles des archéologues? et n’est-ce
pas une tentative bien téméraire que de vouloir la produire aux regards de notre société?
Je me suis fait toutes ces objections, et pourtant, je ne sais si je m’abuse, il me semble
qu un attrait plus profond que l’amour de la science s’attache à l’exhumation des
vieilles civilisations, surtout lorsqu’elles ont disparu sans que la nôtre ait subi, ni de
près ni de loin, leur influence, et sans qu elles aient même exercé aucune action quelconque._
au dehors de leur domaine national.
Sous ces formes qui nous sont étrangères, nous sommes avides de retrouver le même
fonds de passions humaines, les mêmes éléments de vertus et de vices, le même drame
de la vie, que nous avons observés tant de fois en nous et autour de nous. Ni le lieu
de la scène, ni les décors, ni les costumes, ne nous rappellent rien de ce que nous avons
accoutumé ; mais cependant nous nous doutons bien que nous allons assister à une sorte
de contre-épreuve de 1 homme que nous connaissons, et une voix secrète nous redit
I avilissement de nos vieux fabulistes : Ami lecteur, c’est de toi-même qu’il est question
dans cette histoire. De te fabula narratur.
La poésie, qui, sous le ciel du Nippon comme ailleurs, prend son bien partout où
elle le trouve, a découvert dans le mythe d’Izanaghi la source des premières institutions
religieuses du peuple japonais. Elle en a fait, il y a fort longtemps, le sujet d’une sorte de
ballade dont la valeur morale m’avait été déjà signalée par M. de Yogel, à Batavia. J ’ai pu
me convaincre au Japqn, en consultant des artistes indigènes, que le peuple a conservé
la mémoire:de^cette*poétique légende, et je vais en citer les traits les plus remarquables :
« Six dynasties^s étaient déjà succédé sur le trône du ciel, lorsque Izanaghi, le séptième
des dieux célestes, résolut d’appeler à l’existence un monde inférieur.
« Quand îLFeut vu s’élever au-dessus des flots de l’Océan, il se sentit attiré vers .cette
nou\ellé création, et s adressant à sa divine compagne Izanami, il lui proposa de descendre
sur la, terre. ÆËÊ |
« La déesse, accepta/avec plaisircette aimable, invitation, etMes deux .célestes, époux,
appuyés sur la balustrade de leurs%emeures éthérées, se demandèrent quel serait le
lieu qu’ils choisiraient pour but de leur pérégrination.