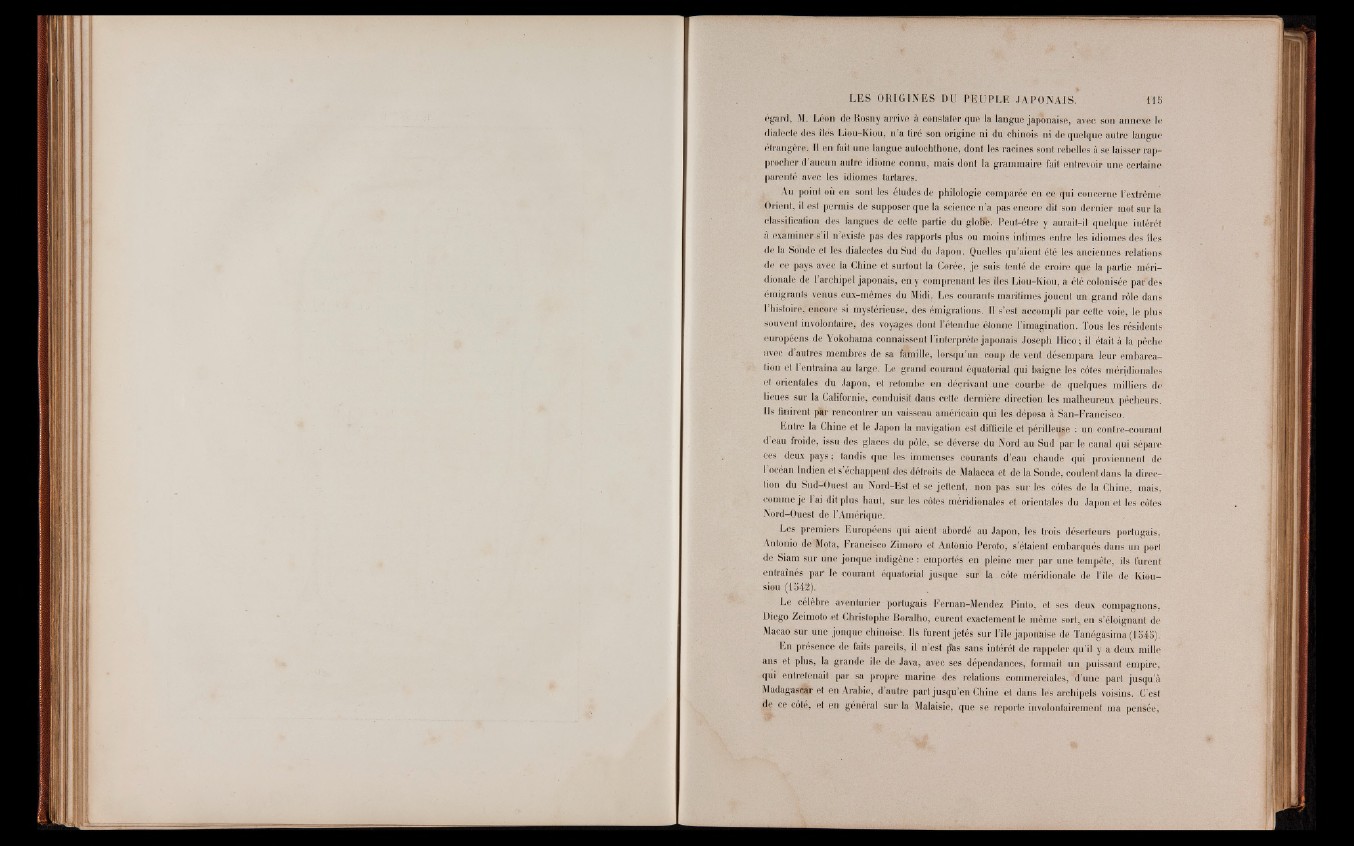
égard, M. Léon de Rosny arrive à constater que la langue japonaise, avec son annexe le
dialecte des îles Liou-Kiou, n ’a tiré son origine ni du chinois ni de quelque autre langue
étrangère. Il en fait une langue autochthone, dont les racines sont rebelles à se laisser rapprocher
d’aucun autre idiome connu, mais dont la grammaire fait entrevoir une certaine
parenté avec les idiomes tartares.
Au point où en sont les études de philologie comparée en ce qui concerne l’extrême
Orient, il est permis de supposer que la science n’a pas encore dit son dernier mot sur la
classification des langues de cette partie du gloBfe. Peut-être y aurait-il quelque intérêt
à examiner s’il n’existe pas des rapports plus ou moins intimes entre les idiomes des îles
de la Sonde et les dialectes du Sud du Japon. Quelles qu’aient été les anciennes relations
de ce pays avec la Chine et surtout la Corée, je suis tenté de croire que la partie méridionale
de l’archipel japonais, en y comprenant les îles Liou-Kiou, a été colonisée par des
émigrants venus eux-mêmes du Midi. Les courants maritimes jouent un grand rôle dans
l’histoiré, encore si mystérieuse, des émigrations. 11 s’est accompli par cette voie, le plus
souvent involontaire, des voyages dont l’étendue étonne l’imagination. Tous les résidents
européens de Yokohama connaissent l’interprète japonais Joseph Hico ; il était à la pêche
avec d autres membres de sa famille, lorsqu’un coup de vent désempara leur embarcation
et l’entraîna au large. Le grand courant équatorial qui baigne les côtes méridionales
et orientales du Japon, et retombe en décrivant une courbe de quelques milliers de
lieues sur la Californie, conduisit dans cette dernière direction les malheureux pêcheurs.
Ils finirent par rencontrer un vaisseau américain qui les déposa à San-Francisco.
Entre la Chine et le Japon la navigation est difficile et périlleuse : un contre-courant
d eau froide, issu des glaces du pôle, se déverse du Nord au Sud par le canal qui sépare
ces deux pays ; tandis que les immenses courants d’eau chaude qui proviennent de
1 océan Indien et s échappent des détroits de Malacca et de la Sonde, coulent dans la direction
du Sud-Ouest au Nord-Est et se jettent, non pas sur les côtes de la Chine, mais,
comme je l’ai dit plus haut, sur les côtes méridionales et orientales du Japon et les côtes
Nord-Ouest de l’Amérique.
Les premiers Européens qui aient abordé au Japon, les trois déserteurs portugais,
Antonio de Mota, Francisco Zimoro et Antônio Peroto, s’étaient embarqués dans un port
de Siam sur une jonque indigène : emportés en pleine mer par une tempête, ils furent
entraînés par le courant équatorial jusque sur la côte méridionale de l’île de Kiou-
siou (1542).
Le célèbre -aventurier portugais Fernan-Mendez Pinto, et ses deux compagnons,
Diego Zeimoto et Christophe Boralho, eurent exactement le même sort, en s’éloignant de
Macao sur une jonque chinoise. Ils furent jetés sur l’île japonaise de Tanégasima (1545).
En présence de faits pareils, il n’est i&s sans intérêt de rappeler qu’il y a deux mille
ans et plus, la grande île de Java, avec ses dépendances, formait un puissant empire,
qui entretenait par sa propre marine des relations commerciales, 'd’une part jusqu’à
Madagascar et en Arabie, d’autre part jusqu’en Chine et dans les archipels voisins. C’est
de ce côté, et en général sur la Malaisie, que se reporte involontairement ma pensée,