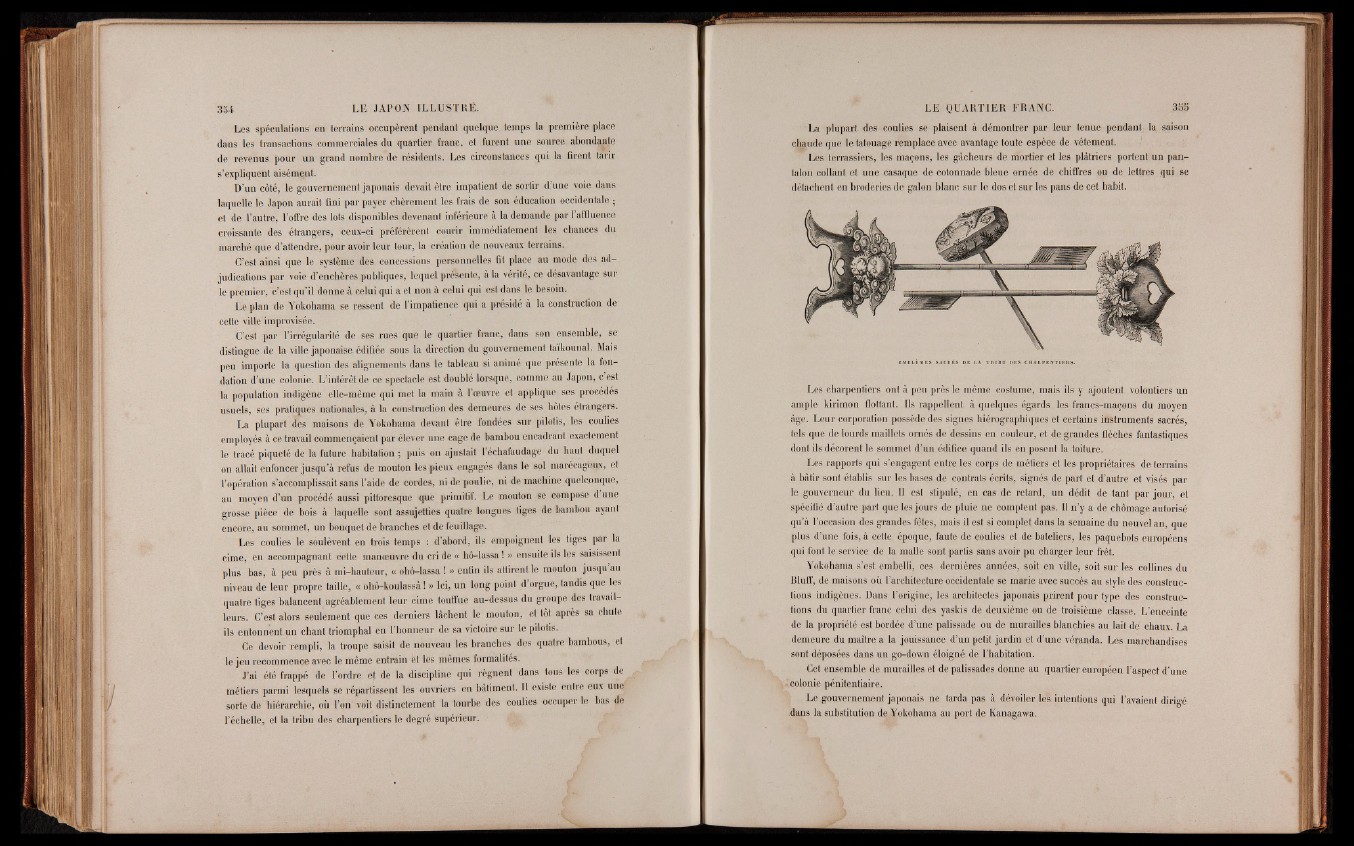
Les spéculations en terrains occupèrent pendant quelque temps la première place
dans les transactions commerciales du quartier franc, et furent une source abondante
de revenus pour un grand nombre de résidents. Les circonstances qui la firent tarir
s’expliquent aisément.
D’un côté, le gouvernement japonais devait être impatient de sortir d’une voie dans
laquelle le Japon aurait fini par payer chèrement les frais de son éducation occidentale ;
et de l’autre, l’offre des lots disponibles devenant inférieure à la demande par l’affluence
croissante des étrangers, ceux-ci préférèrent courir immédiatement les chances du
marché que d’attendre, pour avoir leur tour, la création de nouveaux terrains.
G’est ainsi que le système des concessions personnelles fit place au mode des adjudications
par voie d’enchères publiques, lequel présente, à la vérité, ce désavantage sur
le premier, c’est qu’il donne à celui qui a et non à celui qui est dans le besoin.
Le plan de Yokohama se ressent de l’impatience qui a présidé à la construction de
cette ville improvisée.
C’est par l’irrégularité de ses rues que le quartier franc, dans son ensemble, se
distingue de la ville japonaise édifiée sous la direction du gouvernement taikounal. Mais
peu importe la question des alignements dans le tableau si animé que présente la fondation
d’une colonie. L’intérêt de ce spectacle est doublé lorsque, comme au Japon, c est
la population indigène elle-même qui met la main à l’oeuvre et applique ses procédés
usuels, ses pratiques nationales, à la construction des demeures de ses hôtes étrangers.
La plupart des maisons de Yokohama devant être fondées sur pilotis, les coulies
employés à ce travail commençaient par élever une cage de bambou encadrant exactement
le tracé piqueté de la future habitation ; puis on ajustait l’échafaudage du haut duquel
on allait enfoncer jusqu’à refus de mouton les pieux engagés dans le soi marécagèux, et
l’opération s’accomplissait sans l’aide de cordes, ni de poulie, ni de machine quelconque,
au moyen d’un procédé aussi pittoresque que primitif. Le mouton se compose d une
grosse pièce de bois à laquelle sont assujetties quatre longues tiges de bambou ayant
encore, au sommet, un bouquet de branches et de feuillage.
Les coulies le soulèvent en trois temps : d’abord, ils empoignent les tiges par la
cime, en accompagnant cette manoeuvre du cri de « hô-lassa ! » ensuite ils les saisissent
plus bas, à peu près à mi-hauteur, « ohô-lassa ! » enfin ils attirent le mouton jusqu au
niveau de leur propre taille, « ohô-koulassâ ! » Ici, un long point d’orgue, tandis que les
quatre tiges balancent agréablement leur cime touffue au-dessus du groupe des travailleurs
C’est alors seulement que ces derniers lâchent le mouton, et tôt après sa chute
ils entonnent un chant triomphal en l’honneur de sa victoire sur le pilotis.
Ce devoir rempli, la troupe saisit de nouveau les branches des quatre bambous, et
le jeu recommence avec le même entrain èt les mêmes formalités.
J’ai été frappé de l’ordre et de la discipline qui régnent dans tous les corps de
métiers parmi lesquels se répartissent les ouvriers en bâtiment. Il existe entre eux une
sorte de hiérarchie, où l’on voit distinctement la tourbe des coulies occuper le bas de
l’échelle, et la tribu des charpentiers le degré supérieur.
La plupart des coulies se plaisent à démontrer par leur tenue pendant la saison
chaude que le tatouage remplace avec avantage toute espèce de vêtement.
Les terrassiers, les maçons, les gâcheurs de mortier et les plâtriers portent un pantalon
collant et une casaque de cotonnade bleue ornée de chiffres ou de lettres qui se
détachent en broderies de galon blanc sur le dos et sur les pans de cet habit.
EMBLÈMES SACRÉS' DE LA TRIBU DES CHARPENTIERS.
Les charpentiers ont à peu près le même costume, mais ils y ajoutent volontiers un
ample kirimon flottant. Ils rappellent à quelques égards les francs-maçons du moyen
âge. Leur corporation possède des signes hiérographiques et certains instruments sacrés,
tels que de lourds maillets ornés de dessins en couleur, et de grandes flèches fantastiques
dont ils décorent le sommet d’un édifice quand ils en posent la toiture.
Les rapports qui s’engagent entre les corps de métiers et les propriétaires de terrains
à bâtir sont établis sur les bases de contrats écrits, signés de part et d’autre et visés par
le gouverneur du lieu. Il est stipulé, en cas de retard, un dédit de tant par jour, et
spécifié d’autre part que les jours de pluie ne comptent pas. Il n ’y a de chômage autorisé
qu’à l’occasion des grandes fêtes, mais il est si complet dans la semaine du nouvel an, que
plus d’une fois, à celte époque, faute de coulies et de bateliers, les paquebots européens
qui font le service de la malle sont partis sans avoir pu charger leur frêt.
Yokohama s’est embelli, ces dernières années, soit en ville, soit sur les collines du
Bluff, de maisons où l’architecture occidentale se marie avec succès au style des constructions
indigènes. Dans l’origine, les architectes japonais prirent pour type des constructions
du quartier franc celui des yaskis de deuxième ou de troisième classe. L’enceinte
de la propriété est bordée d’une palissade ou de murailles blanchies au lait de chaux. La
demeure du maître a la jouissance d’un petit jardin et d’une véranda. Les marchandises
sont déposées dans un go-down éloigné de l’habitation.
Cet ensemble de murailles et de palissades donne au quartier européen l’aspect d’une
colonie pénitentiaire.
Le gouvernement japonais ne tarda pas à dévoiler lès intentions qui l’avaient dirigé
dans la substitution de Yokohama au port de Kanagawa.