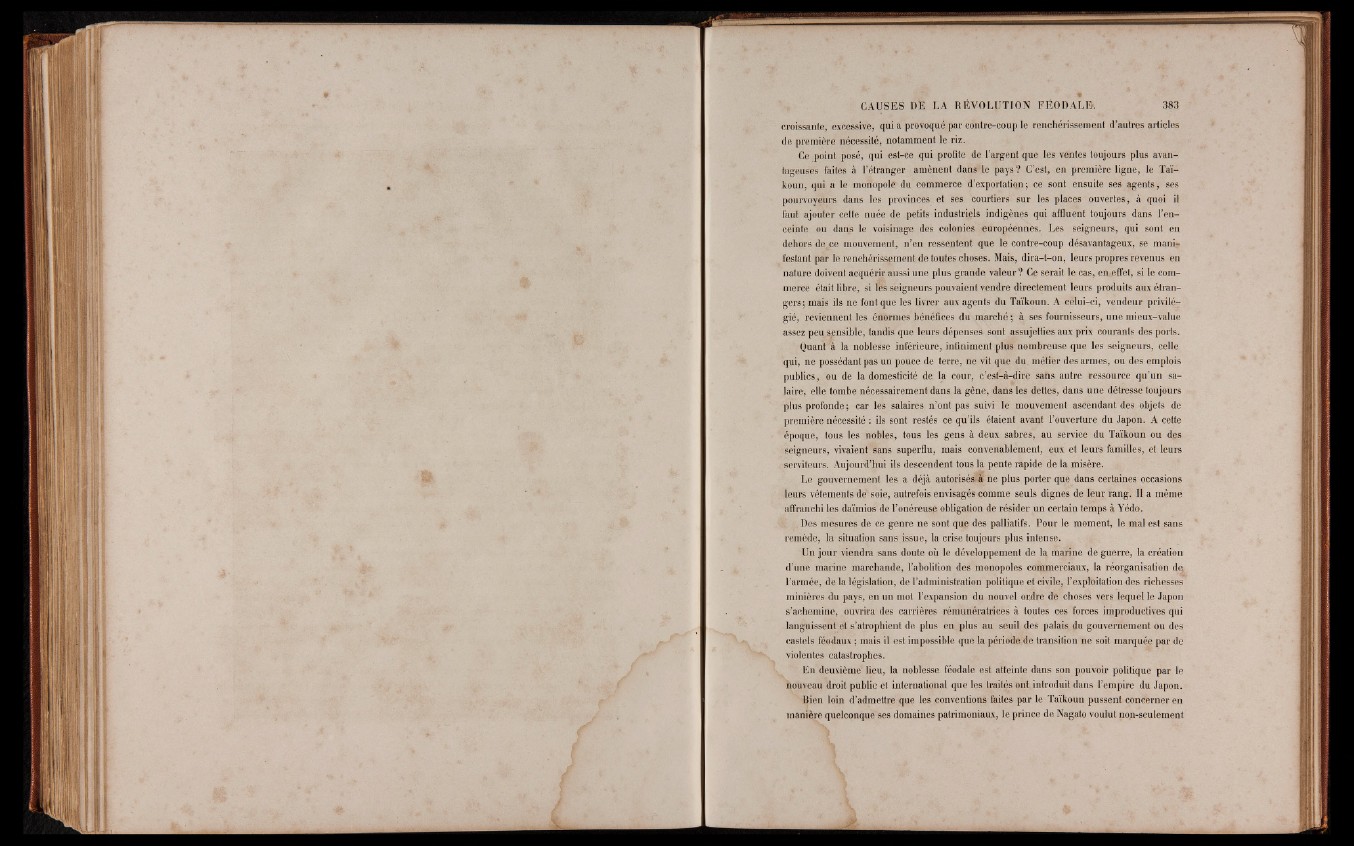
CAUSES DE LA RÉVOLUTION FÉODALE. 383
croissante, excessive, qui a provoqué par contre-coup le renchérissement d’autres articles
de première nécessité, notamment le riz.
Ce point posé, qui est-ce qui profite de l’argent que les ventes toujours plus avantageuses
faites à l’étranger amènent dans le pays? C’est, en première ligne, le Taï-
koun, qui a le moriopotè du commerce d’exportation ; ce sont ensuite ses agents, ses
pourvoyeurs dans les provinces et ses courtiers sur les places ouvertes, à quoi il
faut ajouter cette nuée de petits industriels indigènes qui affluent toujours dans l’enceinte
ou dan,s le voisinage des colonies européennes. Les seigneurs, qui sont en
dehors de ce mouvement, n’en ressentent que le contre-coup désavantageux, se mani^
festant par le renchérissement de toutes choses. Mais, dira-t-on, leurs propres revenus en
nature doivent acquérir aussi une plus grande valeur? Ce serait le cas, en effet, si le commerce
était libre, si lès seigneurs pouvaient vendre directement leurs produits aux étrangers;
mais ils ne font que les livrer aux agents du Taïkoun. A cèlui-ci, vendeur privilégié,
reviennent les énormes bénéfices du marché ; à ses fournisseurs, une mieux-value
assez peu sensible, tandis que leurs dépenses sont assujetties aux prix courants des ports.
Quant à la noblesse inférieure, infiniment plus nombreuse que les seigneurs, celle
qui, ne possédant pas un pouce de terre, ne vit que du métier des armes, ou des emplois
publics, ou de la domesticité de la cour, c’est-à-dire sans autre ressource qu’un salaire,
elle tombe nécessairement dans la gène, dans les dettes, dans une détresse toujours
plus profonde ; car les salaires n’ont pas suivi le mouvement ascendant des objets de
première nécessité : ils sont restés ce qu’ils étaient avant l’ouverture du Japon. A cette
époque, tous les nobles, tous les gens à deux sabres, au service du Taïkoun ou des
seigneurs, vivaient sans superflu, mais convenablement, eux et leurs familles, et leurs
serviteurs. Aujourd’hui ils descendent tous la pente rapide de la misère.
Le gouvernement les a déjà autorisés à ne plus porter que dans certaines occasions
leurs vêtements de' soie, autrefois envisagés comme seuls dignes de leur rang. Il a même
affranchi les daïmios de l’onéreuse obligation de résider un certain temps à Yédo.
Des mesures de ce genre ne sont que des palliatifs. Pour le moment, le mal est sans
remède, la situation sans issue, la crise toujours plus intense.
Un jour viendra sans doute où le développement de la marine de guerre, la création
d’une marine marchande, l’abolition des monopoles commerciaux, la réorganisation de,
l’armée, de la législation, de l’administration politique et civile, l’exploitation des richesses
minières du pays, en un mot l’expansion du nouvel or,dre de choses vers lequel le Japon
s’achemine, ouvrira des carrières rémunératrices à toutes ces forces improductives qui
languissent et s’atrophient de plus en plus au seuil des palais du gouvernement ou des
castels féodaux ; mais il est impossible que la période de transition ne soit marquée par de
violentes catastrophes.
En deuxième lieu, la noblesse féodale est atteinte dans son pouvoir politique par le
nouveau droit public et international que les traités ont introduit dans l’empire du Japon.
Bien loin d’admettre que les conventions faites par le Taïkoun pussent concerner en
manière quelconque ses domaines patrimoniaux, le prince de Nagato voulut non-seulement