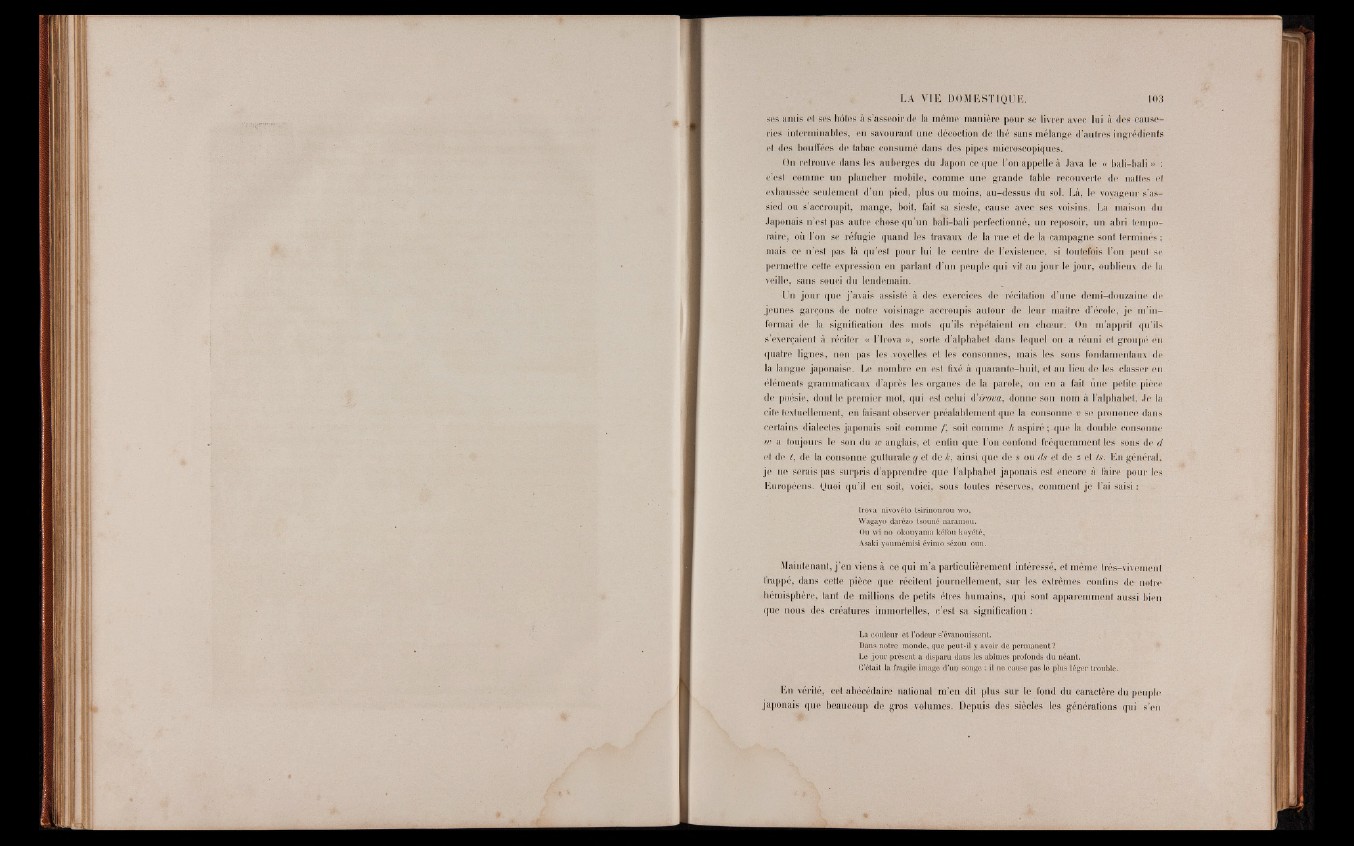
ses amis et ses hôtes à s’asseoir de la même manière pour se livrer avec lui à des causeries
interminables, en savourant une décoction de thé sans mélange d’autres ingrédients
et des bouffées de tabac consumé dans des pipes microscopiques.
On retrouve dans les auberges du Japon ce que l’on appelle à Java le « bali—bali » :
c’est comme un plancher mobile, comme une grande fable recouverte de nattes et
exhaussée seulement d’un pied, plus ou moins, au-dessus du sol. Là, le voyageur s’assied
ou s’accroupit, mange, boit, fait sa sieste, cause avec ses voisins. La maison du
Japonais n’est pas autre chose qu’un bali—bali perfectionné, un reposoir, un abri temporaire,
où l’on se réfugie quand les travaux de la rue et de la campagne sont terminés ;
mais ce n’est pas là qu’est pour lui le centre de l’existence, si toutefois l’on peut se
permettre cette expression en parlant d’un peuple qui vit au jour le jour, oublieux de la
veille, sans souci du lendemain.
Un jour que j ’avais assisté à des exercices de récitation d’une demi-douzaine de
jeunes garçons de notre voisinage accroupis autour de leur maître d’école, je m’informai
de la signification des mots qu’ils répétaient en choeur. On m’apprit qu’ils
s’exerçaient à réciter « l’Irova », sorte d’alphabet dans lequel on a réuni et groupé en
quatre lignes, non pas les voyelles et les consonnes, mais les sons fondamentaux de
la langue japonaise. Le nombre en est fixé à quarante-huit, et au lieu de les classer en
éléments grammaticaux d’après les organes de la parole, on en a fait une petite pièce
de poésie, dont le premier mot, qui est celui d'irova, donne son nom à l’alphabet. Je la
cite textuellement, en faisant observer préalablement que la consonne v se prononce dans
certains dialectes japonais soit comme f, soit comme h aspiré ; que la double consonne
w a toujours le son du w anglais, et enfin que l’on confond fréquemment les sons de d
et de t, de la consonne gutturale g et de k, ainsi que de s ou ds et de z et Is. En général,
je ne serais pas surpris d’apprendre que l’alphabet japonais est encore à faire pour les
Européens. Quoi qu’il en soit, voici, sous toutes réserves, comment je l’ai saisi :
Irova nivovéto tsirinourou wo,
Wagayo darézo tsouné naramou.
Ou \vi no okouyama kéfou koyété,
Asaki youmémisi évimo sézou oun.
Maintenant, j ’en viens à ce qui m’a particulièrement intéressé, et même très-vivement
frappé, dans cette pièce que récitent journellement, sur les extrêmes confins de notre
hémisphère, tant de millions de petits êtres humains, qui sont apparemment aussi bien
que nous des créatures immortelles, c’est sa signification :
La couleur e t l’odeur s’évanouissent. ■
Dans notre monde, que peut-il y avoir de permanent ?
Le jo u r présent a disparu dans les abîmes profonds du néant.
C’était la fragile image d’un sônge : il ne cause pas le plus léger trouble.
En vérité, cet abécédaire national m’en dit plus sur le fond du caractère du peuple
japonais que beaucoup de gros volumes. Depuis des siècles les générations qui s’en