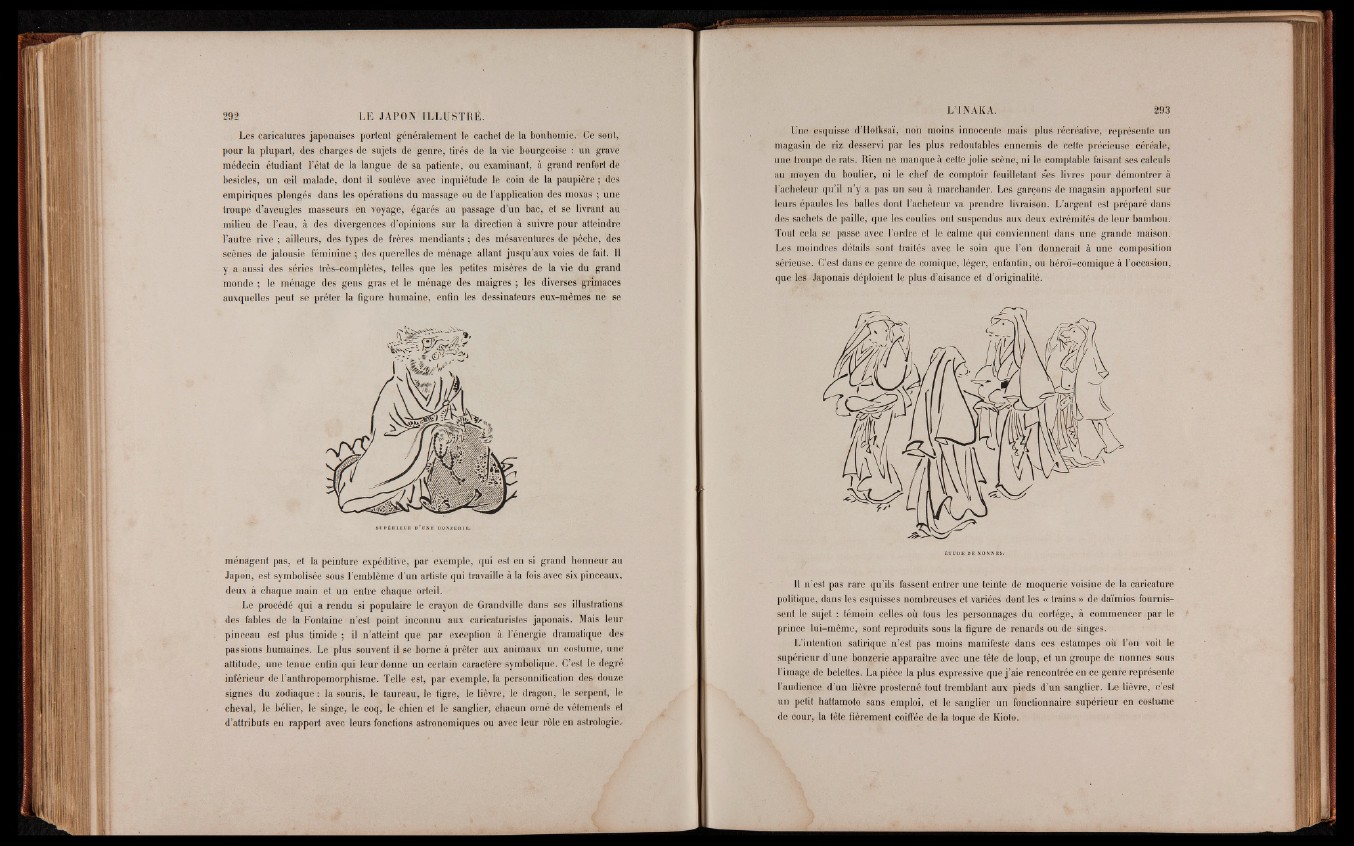
Les caricatures japonaises portent généralement le cachet de la bonhomie. Ce sont)
pour la plupart, des charges de sujets de genre, tirés de la vie bourgeoise : un grave
médecin étudiant l’état de la langue de sa patiente, ou examinant, à grand renfort de
besicles, un oeil malade, dont il soulève avec inquiétude le coin de la paupière ; des
empiriques plongés dans les opérations du massage ou de l’application des moxas ; une
troupe d’aveugles masseurs en voyage, égarés au passage d’un bac, et se livrant au
milieu de l’eau, à des divergences d’opinions sur la direction à suivre pour atteindre
l’autre rive ; ailleurs, des types de frères mendiants ; des mésaventures de pêche, des
scènes de jalousie féminine ; des querelles de ménage allant jusqu’aux voies de fait. 11
y a aussi des séries très-complètes, telles que les petites misères de la vie du grand
monde ; le ménage des gens gras et le ménage des maigres ; les diverses grimaces
auxquelles peut se prêter la figure humaine, enfin les dessinateurs eux-mêmes ne se
SUPÉRIEUR d’ une b o n z e r i e .
ménagent pas, et la peinture expéditive, par exemple, qui est en si grand honneur au
Japon, est symbolisée sous l’emblème d’un artiste qui travaille à la fois avec six pinceaux,
deux à chaque main et un entre chaque orteil.
Le procédé qui a rendu si populaire le crayon de Grandville dans ses illustrations
des fables de la Fontaine n’est point inconnu aux caricaturistes japonais. Mais leur
pinceau est plus timide ; il n’atteint que par exception à l’énergie dramatique des
passions humaines. Le plus souvent il se borne à prêter aux animaux un costume, une'
attitude, une tenue enfin qui leur donne un certain caractère symbolique. C’est le degré
inférieur de l’anthropomorphisme. Telle est, par exemple, la personnification des douze
signes du zodiaque : la souris, le taureau, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le
cheval, le bélier, le singe, le coq, le chien et le sanglier, chacun orné de vêtements et
d’attributs en rapport avec leurs fonctions astronomiques ou avec leur rôle en astrologie.
Une esquisse d’Bofksaï, non moins innocente mais plus récréative, représente un
magasin de riz desservi par les plus redoutables ennemis de cette précieuse céréale,
une troupe de rats. Rien ne manque à cette jolie scène, ni le comptable faisant ses calculs
au moyen du boulier, ni le chef de comptoir feuilletant ses livres pour démontrer à
l’acheteur qu’il n’y a pas un sou à marchander. Les garçons de magasin apportent sur
leurs épaules les balles dont l’acheteur va prendre livraison. L’argent est préparé dans
des sachets de paille, que les coulies ont suspendus aux deux extrémités de leur bambou.
Tout cela se passe avec l’ordre et le calme qui conviennent dans une grande maison.
Les moindres détails sont traités avec le soin que l’on donnerait à une composition
sérieuse. C’est dans ce genre de comique, léger, enfantin, ou héroï-comique à l’occasion,
que les Japonais déploient le plus d’aisance et d’originalité.
11 n’est pas rare qu’ils fassent entrer une teinte de moquerie voisine de la caricature
politique, dans les esquisses nombreuses, et variées dont les « trains » de daïmios fournissent
le sujet : témoin celles où tous les personnages du cortège, à commencer par le
prince lui-même, sont reproduits sous la figure de renards ou de singes.
L’intention satirique n’est pas moins manifeste dans ces estampes où l’on voit le
supérieur d’une bonzerie apparaître avec une tête de loup, et un groupe de nonnes sous
l’image de belettes. La pièce la plus expressive que j ’aie rencontrée en ce genre représente
l’audience d’un lièvre prosterné tout tremblant aux pieds d’un sanglier. Le lièvre, c’est
un petit hattamoto sans emploi, et le sanglier un fonctionnaire supérieur en costume
de cour, la tête fièrement coiffée de la toque de Kioto.