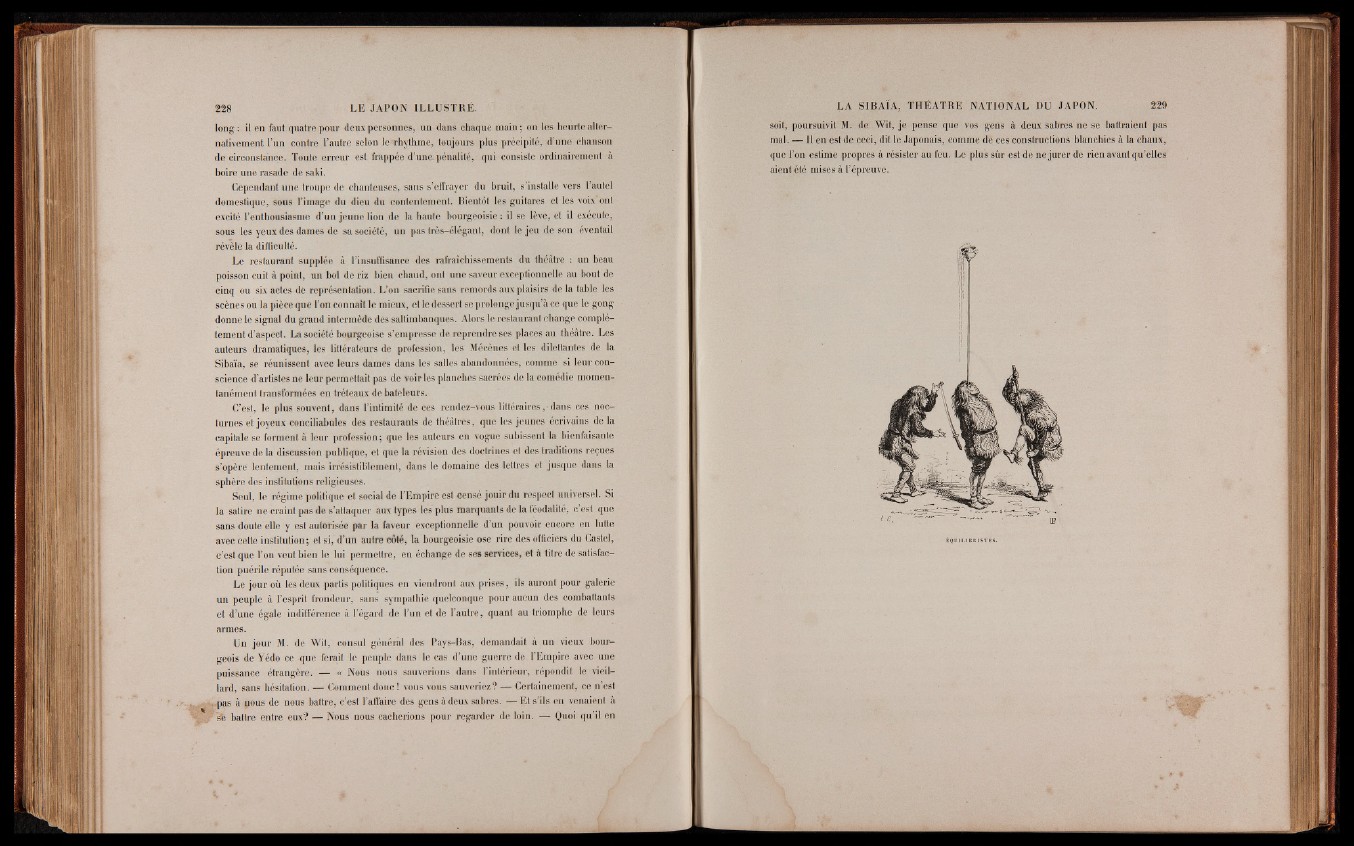
f i lm
ü l l
228 L E JAPON IL LU STR É .
long : il en faut quatre pour deux personnes, un dans chaque main ; on les heurte alternativement
l’un contre l’autre selon le rhythme, toujours plus précipité, d’une chanson
de circonstance. Toute erreur est frappée d’une, pénalité, qui consiste ordinairement à
boire une rasade de saki.
Cependant une troupe de chanteuses, sans s’effrayer du bruit, s’installe vers l’autel
domestique, sous l’image du dieu du contentement. Bientôt les guitares et les voix ont
excité l’enthousiasme d’un jeune lion de la haute bourgeoisie : il se lève, et il exécute,
sous les yeux des dames de sa société, un pas très-élégant, dont le jeu de son éventail
révèle la difficulté.
Le restaurant supplée à l’insuffisance des rafraîchissements du théâtre : un beau
poisson cuit à point, un bol de riz bien chaud, ont une saveur exceptionnelle au bout de
cinq ou six actes de représentation. L’on sacrifie sans remords aux plaisirs de la table les
scènes ou la pièce que l’on connaît le mieux, et le dessert se prolonge jusqu’à ce que le gong
donne le signal du grand intermède des saltimbanques. Alors le restaurant change complètement
d’aspect. La société bourgeoise s’empresse de reprendre ses places au théâtre. Les
auteurs dramatiques, les littérateurs de profession, les Mécènes et les dilettantes de la
Sibaïa, se réunissent avec leurs dames dans les salles abandonnées, comme si leur conscience
d’artistes ne leur permettait pas de voiries planches sacrées de la comédie momentanément
transformées en tréteaux de bateleurs.
C’est, le plus souvent, dans l’intimité de ces rendez-vous littéraires,-dans ces nocturnes
et joyeux conciliabules des restaurants de théâtres, que les jeunes écrivains de la
capitale se forment à leur profession ; que les auteurs en vogue subissent la bienfaisante
épreuve de la discussion publique, et que la révision des doctrines et des traditions reçues
s’opère lentement, mais irrésistiblement, dans le domaine des lettres et jusque dans la
sphère des institutions religieuses.
Seul, le régime politique et social de l’Empire est censé jouir du respect universel. Si
la satire ne craint pas de s’attaquer aux types les plus marquants de la féodalité, c’est que
sans doute elle y est autorisée par la faveur exceptionnelle d’un pouvoir encore en lutte
avec cette institution; et si, d’un autre côté, la bourgeoisie ose rire des officiers du Castel,
c’est que l’on veut bien le lui permettre, en échange de ses services, et à titre de satisfaction
puérile réputée sans conséquence.
Le jour où les deux partis politiques en viendront aux prises, ils auront pour galerie
un peuple à l’esprit frondeur, sans sympathie quelconque pour aucun des combattants
et d’une égale indifférence à l’égard de l’un et de l’autre, quant au triomphe de leurs
armes.
Un jour M. de Wit, consul général des Pays-Bas, demandait à un vieux bourgeois
de Yédo ce que ferait le peuple dans le cas d’une guerre de l’Empire avec une
puissance étrangère. — « Nous nous sauverions dans l’intérieur, répondit le vieillard,
sans hésitation. — Comment donc! vous vous sauveriez? — Certainement, ce n’est
*fpas à nous de nous battre, c’est l’affaire des gens à deux sabres. — Et s’ils en venaient à
battre entre eux? — Nous nous cacherions pour regarder de loin. — Quoi qu’il en
soit, poursuivit M. de Wit, je pense que vos gens à deux sabres ne se battraient pas
mal. — Il en est de ceci, dit le Japonais, comme de ces constructions blanchies à la chaux,
que l’on estime propres à résister au feu. Le plus sûr est de ne jurer de rien avant qu’elles
aient été mises à l’épreuve.
ÉQGILlBIt ISTES.