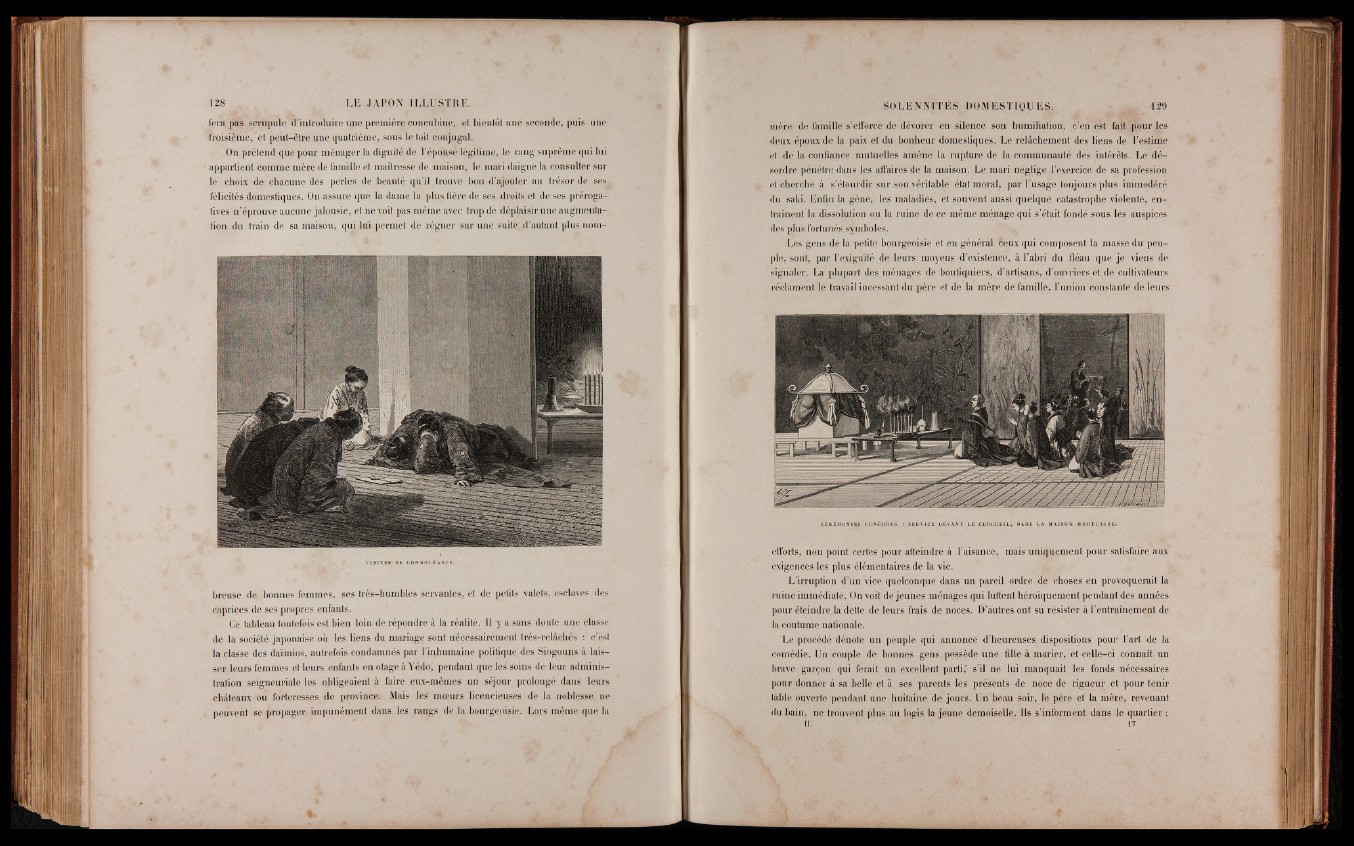
fera pas scrupule d’introduire une première concubine, et bientôt une seconde, puis une
troisième, et peut-être une quatrième, sous le toit conjugal.
On prétend que pour ménager la dignité de l’épouse légitime, le rang suprême qui lui
appartient comme mère de famille et maîtresse de maison, le mari daigne la consulter sur
le choix de chacune des perlés de beauté qu’il trouve bon d’ajouter au trésor de ses
félicités domestiques. On assure que la dame la plus fière de ses droits et de ses prérogatives
n ’éprouve aucune jalousie, et ne voit pas même avec trop de déplaisir une augmentation
du train de sa maison, qui lui permet de régner sur une suite d’autant plus nommère
breuse de bonnes femmes, ses très-humbles servantes, et de petits valets, esclaves des
caprices de ses propres enfants.
Ce tableau toutefois est bien loin de répondre à la réalité. Il y a sans doute une classe
de la société japonaise où les liens du mariage sont nécessairement très-relâchés : c’èst
la classe des daïmios, autrefois condamnés par l’inhumaine politique des Siogouns à laisser
leurs femmes et leurs enfants enotage àYédo, pendant que les soins de leur administration
seigneuriale les obligeaient à faire eux-mêmes un séjour prolongé dans leurs
châteaux ou forteresses de province. Mais les moeurs licencieuses de la noblesse ne
peuvent se propager impunément dans les rangs de la bourgeoisie. Lors même que la
de famille s’efforce de dévorer en silence son humiliation, c’en est fait pour les
deux époux de la paix et du bonheur domestiques. Le relâchement des liens de l’estime
et de la confiance mutuelles amène la rupture de la communauté des intérêts. Le désordre
pénètre dans les affaires de la maison. Le mari néglige l’exercice de sa profession
et cherche à s’étourdir sur son véritable état moral, par l’usage toujours plus immodéré
du saki. Enfin la gêne, les maladies, et souvent aussi quelque catastrophe violente, entraînent
la dissolution ou la ruine de ce même ménage qui s’était fondé sous les auspices
des plus fortunés symboles.
Les gens de la petite bourgeoisie et en général èeux qui composent la masse du peuple,
sont, par l’exiguïté de leurs moyens d’existence, à l’abri du fléau que je viens de
signaler. La plupart des ménages de boutiquiers, d’artisans, d’ouvriers et de cultivateurs
réclament le travail incessant du père et de la mère de famille, l’union constante de leurs
CÉRÉMONIES FUNÈBRES :• SERVICE DEVANT LE CERCUEIL, DANS LA MAISON MORTUAIRE.
efforts, non point certes pour atteindre à l’aisance, mais uniquement pour satisfaire aux
exigences les plus élémentaires de la vie.
L’irruption d’un vice quelconque dans un pareil ordre de choses en provoquerait la
ruine immédiate. On voit de jeunes ménages qui luttent héroïquement pendant des années
pour éteindre la dette de leurs frais de noces. D’autres ont su résister à l’entraînement de
la coutume nationale.
Le procédé dénote un peuple qui annonce d’heureuses, dispositions pour l’art de la
comédie. Un couple de bonnes gens possède une fille à marier, et celle-ci connaît un
brave garçon qui ferait un excellent parti,* s’il ne lui manquait les fonds nécessaires
pour donner à sa belle et, à ses parents les présents de noce de rigueur et pour tenir
table ouverte pendant une huitaine de jours. Un beau soir, le père et la mère, revenant
du bain, ne trouvent plus au logis la jeune demoiselle. Ils s’informent dans le quartier :