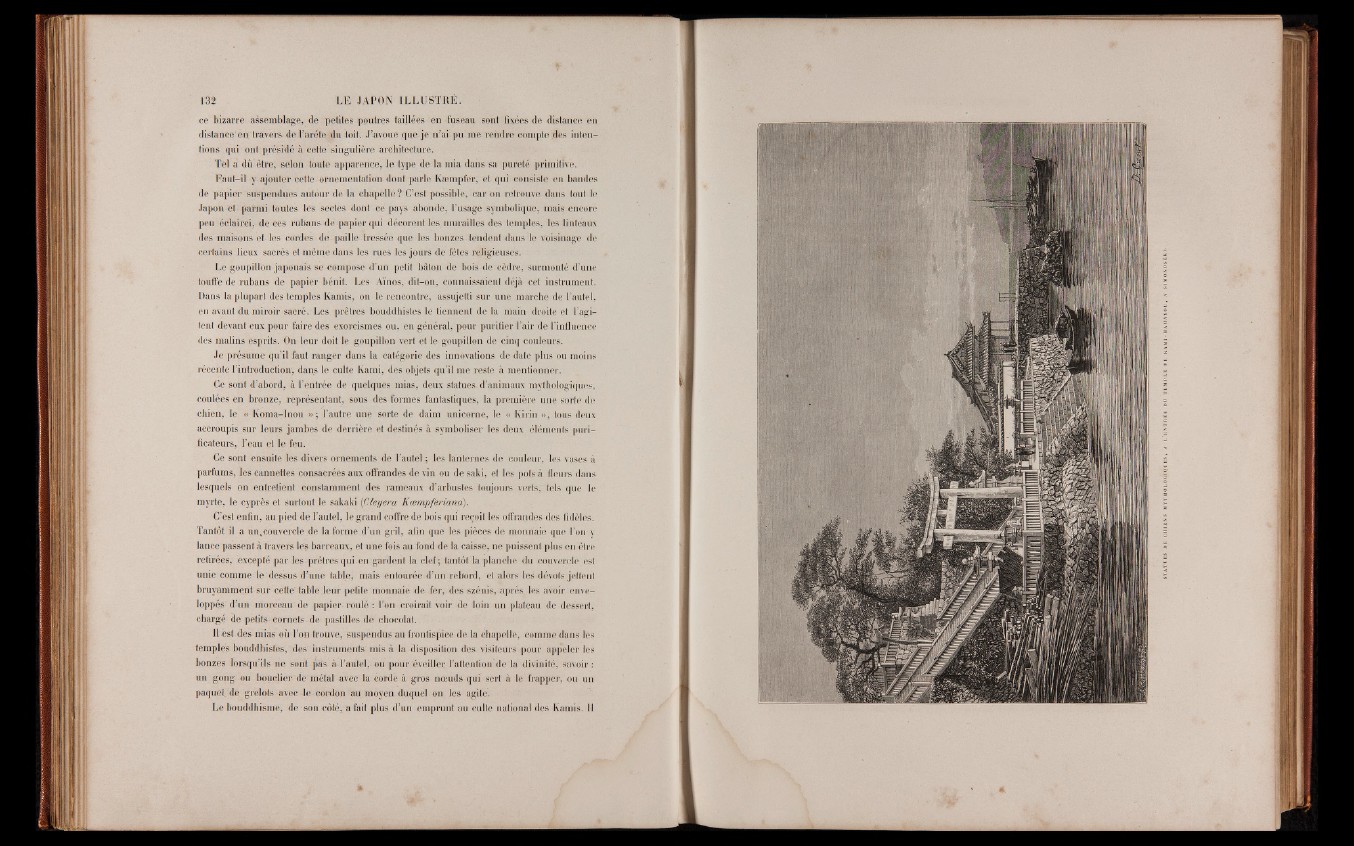
ce bizarre assemblage, de petites poutres taillées en fuseau sont fixées de distance en
distance en travers de l’arête du toit. J’avoue que je n’ai pu me rendre compte des intentions
qui ont présidé à cette singulière architecture.
Tel a du être, selon toute apparence, le type de la mia dans sa pureté primitive.
Fàüt-il y ajouter cette ornementation dont parle Kæmpfer, et qui consiste en bandes
de papier suspendues autour de la chapelle ? C’est possible, car on retrouve dans tout le
Japon et parmi toutes lés sectes dont ce pays abonde, l’usage symbolique, mais encore
peu éclairci, de ces rubans de papier qui décorent les. murailles des temples, les linteaux
des maisons et les cordes de paille tressée que les bonzes tendent dans le voisinage de
certains lieux sacrés et même dans les rues les jours de fêtes religieuses.
Le goupillon japonais se compose d’un petit bâton de bois de cèdre, surmonté d’une
touffe de rubans de papier bénit. Les Aïnos, dit-on, connaissaient déjà cet instrument.
Dans la plupart des temples Ivamis, on le rencontre, assujetti sur une marche de l’autel,
en avant du miroir sacré. Les prêtres bouddhistes le tiennent de la main droite et l’agitent
devant eux pour faire des exorcismes ou, en général, pour purifier l’air de l’influence
des malins esprits. On leur doit le goupillon vert et le goupillon de cinq couleurs.
Je présume qu’il faut ranger dans la catégorie des innovations de date plus ou moins
récente l’introduction, dans le culte Kami, des objets qu’il me reste à mentionner.
Ce sont d’abord, à l’entrée de quelques mias, deux statues d’animaux mythologiques,
coulées en bronze, représentant, sous des formes fantastiques, la première une sorte de
chien, le « Koma-Inou » ; l’autre une sorte de daim unicorne, le « Kirin % tous deux
accroupis sur leurs jambes de derrière et destinés à symboliser les deux éléments purificateurs,
l’eau et le feu.
Ce sont ensuite les divers ornements de l’autel ; les lanternes de couleur, les vases à
parfums, les cannettes consacrées aux offrandes de vin ou de saki, et les pots à fleurs dans
lesquels on entretient constamment des rameaux d’arbustes toujours verts, tels que le
myrte, le cyprès et surtout le sakaki (Cleyera Koempferiana).
C’est enfin, au pied de l’autel, le grand coffre de bois qui reçoit les offrandes des fidèles.
Tantôt il a un^couvercle de la forme d’un gril, afin que les pièces de monnaie que l’on v
lance passent à travers les barreaux, et une fois au fond de la caisse, ne puissent plus en être
retirées, excepté par les prêtres qui en gardent la clef; tantôt la planche du couvercle est
unie comme le dessus d’une table, mais entourée d’un rebord, et alors les dévots jettent
bruyamment sur cette table leur petite monnaie de fer, des szénis, après les avoir enveloppés:
d’un morceau de papier roulé : l’on croirait voir de loin un plateau de dessert,
chargé de petits cornets de pastilles de chocolat.
11 est des mias où l’on trouve, suspendus au frontispice de la chapelle, comme dans les
temples bouddhistes, des instruments mis à la disposition des visiteurs pour appeler les
bonzes lorsqu’ils ne sont pas à l’àutel, ou pour éveiller l’attention de la divinité, savoir:
un gong ou bouclier de métal avec la corde à gros noeuds qui sert à le frapper, ou un
paquet de grelots avec le cordon au moyen duquel on les agite.
Le bouddhisme, de son côté, a fait plus d’un emprunt au culte national des Kamis. Il