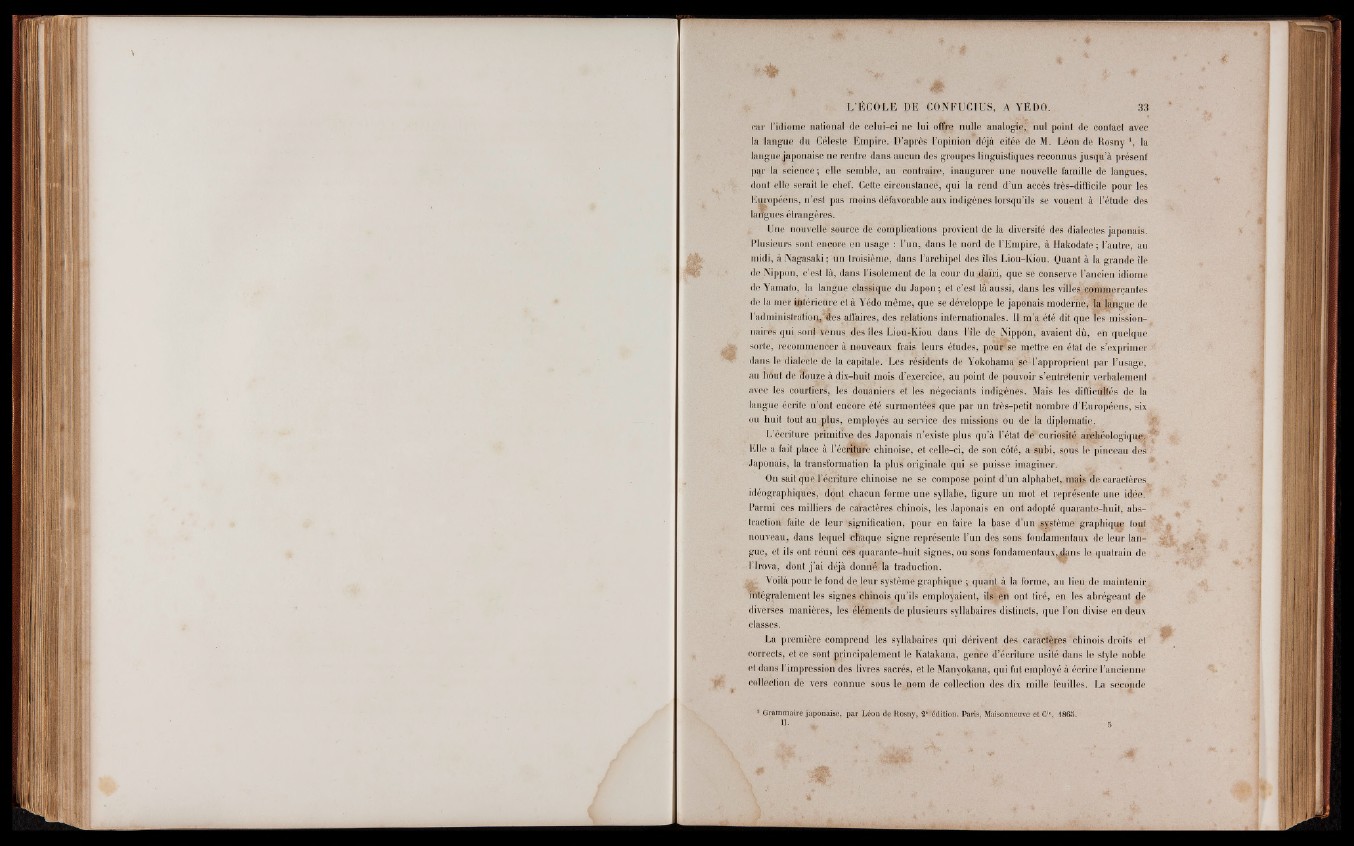
car l’idiome national de celui-ci ne lui offre nulle analogie'!: nul point de contact avec
la langue du Céleste Empire. D’après l’opinion déjà citée de M| Léon de Rosny l, la
langue japonaise ne rentre dans aucun des groupes linguistiques reconnus jusqu’à présent
par la science ; elle semble, au contraire, inaugurer une nouvelle famille de langues,
dont elle serait le chef. Cette circonstance, qui la rend d’un accès très-difficile pour les
Européens, n’est pas moins défavorable aux indigènes lorsqu’ils se vouent à l’étude des
langues étrangères.
Une nouvelle source de complications provient de la diversité des dialectes japonais.
Plusieurs sont encore en usage : l’un, dans le nord de l’Empire, à Hakodate ; l’autre, au
midi, à Nagasaki ; un troisième, dans l’archipel des îles Liou-Kiou. Quant à la grande île
de Nippon, c’est là, dans l’isolement de la cour du daïri, que se conserve l’ancien idiome
de Yamato, la langue classique du Japon; et c’est là aussi, dans les villes; commerçantes
de la mer intérieure et à Yédo même, que se développe le japonais moderne^la langue de
l’administration, île s affaires, des relations internationales. Il m’a été dit que les missionnaires
qui sont venus des îles Liou-Kiou dans l’île de Nippon, avaient dû, en quelque
sorte, recommencer à nouveaux frais leurs études, pour se mettre en état de s’exprimer
dans le dialecte de la capitale. Les résidents de Yokohama se l’approprient par l’usage,
au bôut de douze à dix-huit mois d’exerciée, au point de pouvoir s'entretenir verbalement
avec les courtiers, les douaniers et les négociants indigènes. Mais les difficultés de la
langue écrite n’ont encore été surmontées que par un très-petit nombre d’Européens, six
ou huit tout au plus, employés au service des missions ou de la diplomatie.
L’écriture primitive des Japonais n’existe plus qu’à l’état de curiosité archéologique:.
Elle a fait place à l’éccÿure chinoise, et celle-ci, de son côté, a subi, sous le pinceau des'
Japonais, la transformation la plus originale qui se puisse imaginer.
On sait que l'écriture chinoise ne se compose point d’un alphabet, mais de caractères
idéographiques, dont chacun forme une syllabe, figure un mot et représente une idée. ‘
Parmi ces milliers de caractères chinois, les Japonais en ont adopté quarante-huit, abstraction
faite de leur signification, pour en faire la base d’un .système graphiqqe toul
nouveau, dans lequel chaque signe représente l’un des sons fondamentaux de leur langue,
et ils ont réuni cês quarante-huit signes, ou sons fondamentaux,dans le quatrain de
l’Irova, dont j ’ai déjà donnera traduction.
& Voilà pour le fond de leur système graphique ; quant à la forme, au lieu de maintenir
intégralement les signes chinois qu’ils employaient, il& en ont tiré, en les abrégeant de
diverses manières, les éléments'de plusieurs syllabaires distincts, que l’on divise en deux
classes.
La première comprend les syllabaires qui dérivent des caractères chinois droits et '
corrects, et ce sont principalement le Katakana, genre d’écriture usité dans le style noble
et dans l’impression des livres sacrés, et le Manyokana, qui fut employé à écrire l’ancienne
collection de vers connue sous le jiom de collection des dix mille feuilles. La seconde
1 Grammaire japonaise, par Léon de Itdsny, S é d itio n . Paris, Maisonneuve et Ci0, 1865.
II.