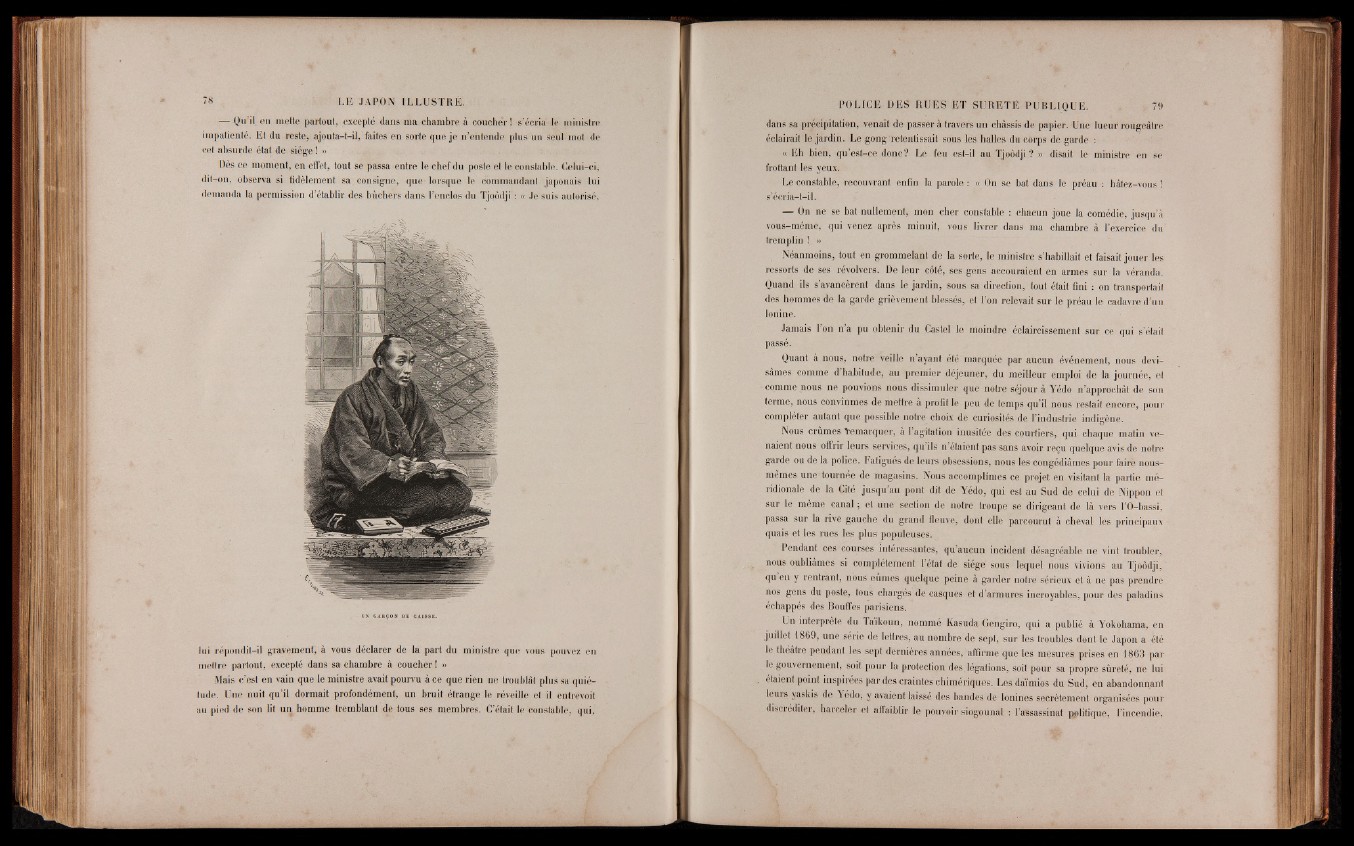
i l
LE JAPON IL LU STR E .
— Qu’il en mette partout, excepté dans ma chambre à coucher ! s’écria le ministre
impatienté. Et du reste, ajouta-t-il, faites en sorte que je n ’entende plus un seul mot de
cet absurde état de siège! »
Dès ce moment, en effet, tout se passa entre le chef du poste et le constable. Celui-ci,
dit-on, observa si fidèlement sa consigne, que lorsque le commandant japonais lui
demanda la permission d’établir des bûchers dans l’enclos du Tjoôdji : « Je suis autorisé,
Éf&
K É ily -V\;:
lisll
i l S ■Us
ON GARÇON DE CA
lui répondit-il gravement, à vous déclarer de la part du ministre que vous pouvez en
mettre partout, excepté dans sa chambre à coucher ! »
Mais c’est en vain que le ministre avait pourvu à ce que rien ne troublât plus sa quiétude.
Une nuit qu’il dormait profondément, un bruit étrange le réveille et il entrevoit
au pied de son lit un homme tremblant de tous ses membres. C’était le constable, qui,
i l
POLICE DES RUES ET SÛRETÉ PUBLIQUE. . 7!)
dans sa précipitation, venait de passér à travers un châssis de papier. Une lueur rougeâtre
éclairait le jardin. Le gong retentissait sous les halles du corps de garde :
« Eh bien, qu’est-ce donc? Le feu est-il au Tjoôdji? » disait le ministre en se
frottant les yeux.
Le constable, recouvrant enfin la parole : « On se bat dans le préau : hâtez-vous !
s’écria-t-il.
— On ne se bat nullement, mon cher constable : chacun joue la comédie, jusqu’à
vous-même, qui venez après minuit, voüs livrer dans ma chambre à l’exercice du
tremplin ! »
Néanmoins, tout en grommelant de la sorte, le ministre s’habillait et faisait jouer les
ressorts de ses révolvers. De leur côté, ses gens accouraient en armes sur la véranda.
Quand ils s’avancèrent dans le jardin, sous sa direction, tout était fini : on transportait
des hommes de la garde grièvement blessés, et Ton relevait sur le préau le cadavre d’un
lonine.
Jamais Ton n’a pu obtenir du Castel le moindre éclaircissement sur ce qui s’était
passé.
Quant à nous, notre veille n’ayant été marquée par aucun événement, nous devisâmes
comme d’habitude, au premier déjeuner, du meilleur emploi de la journée, et
comme nous ne pouvions nous dissimuler que notre séjour à Yédo n ’approchât de son
terme, nous convînmes de mettre a profit le peu de temps qu’il nous restait encore, pour
compléter autant que possible notre choix de curiosités de l’industrie indigène.
Nous crûmes Remarquer, à l’agitation inusitée des courtiers, qui chaque matin venaient
nous offrir leurs services, qu’ils n’étaient pas sans avoir reçu quelque avis de notre
garde ou de la police. Fatigués de leurs obsessions, nous les congédiâmes pour faire nous-
mêmes une tournée de magasins. Nous accomplîmes ce projet en visitant la partie méridionale
de la Cité jusqu’au pont dit de Yédo, qui est au Sud de celui de Nippon et
sur le même canal ; et une section de notre troupe se dirigeant de là vers l’O-bassi,
passa sur la rive gauche du grand fleuve, dont elle parcourut à cheval les principaux
quais et les rues les plus populeuses.
Pendant ces courses intéressantes, qu’aucun incident désagréable ne vint troubler,
nous oubliâmes si complètement l’état de siège' sous lequel nous vivions au Tjoôdji,
qu en y rentrant, nous eûmes quelque peine à garder notre sérieux et à ne pas prendre
nos gens du poste, tous chargés de casques et d’armures incroyables, pour des paladins
échappés des Bouffes parisiens.
Un interprète du Taïkoun, nommé Kasuda Gengiro, qui a publié à Yokohama, en
juillet 1869, une série de lettres, au nombre de sept, sur les troubles dont le Japon a été
le théâtre pendant les sept dernières années, affirme que les mesures prises en 1863 par
le gouvernement, soit pour la protection des,légations, soit pour sa propre sûreté, ne lui
étaient point inspirées par des craintes chimériques. Les daïmios du Sud, en abandonnant
leuis yaskis de Yédo, y avaient laissé des bandes de lonines secrètement organisées pour
discréditer, harceler et affaiblir le pouvoir siogounal : l’atSsassinat pplitique, l’incendie.