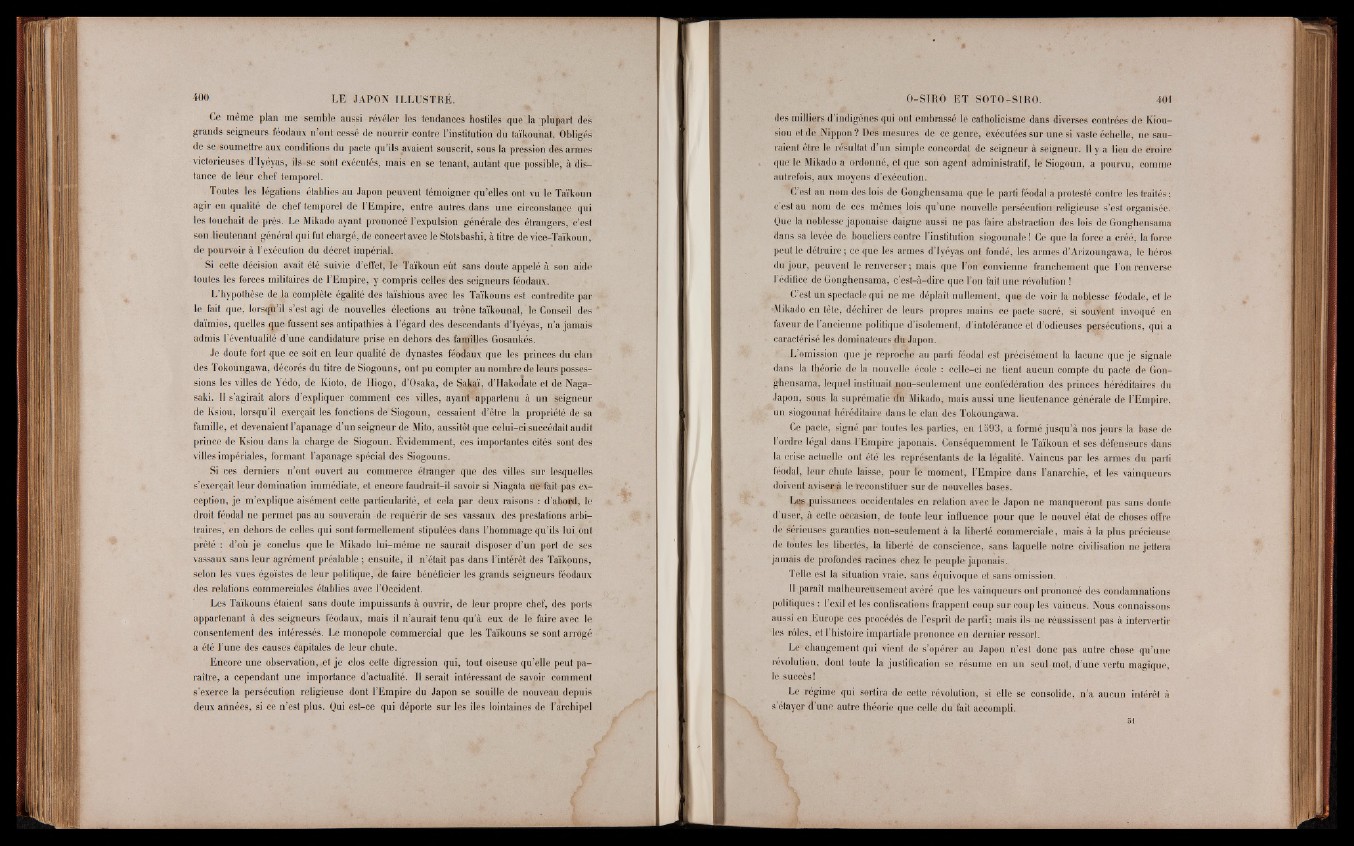
Ce même plan me semble aussi révéler les tendances hostiles que la plupart des
grands seigneurs féodaux n ’ont cessé de nourrir contre l’institution du taïkounat. Obligés
de se,soumettre aux conditions du pacte qu’ils avaient souscrit, sous la pression des armes
victorieuses d’Iyéyas, ils-se sont exécutés, mais en se tenant, autant que possible, à distance
de leur chef temporel.
Toutes les légations établies au Japon peuvent témoigner qu’elles ont vu le Taïkoun
agir en qualité de chef temporel de l’Empire, entre autres, dans une circonstance qui
les louchait de près. Le Mikado ayant prononcé l’expulsion générale des étrangers, c’est
son lieutenant général qui fut chargé, de concert avec le Stotsbashi, à titre de vice-Taïkoun,
de pourvoir à l’exécution du décret impérial.
Si cette décision avait été suivie d’effet, le Taïkoun eût sans doute appelé à son aide
toutes les forces militaires de l’Empire, y compris celles des seigneurs féodaux.
L’hypothèse de la complète égalité des taïshious avec les Taïkouns est contredite par
le fait que, lorsqu’il s’est agi de nouvelles élections au trône taïkounal, le Conseil des
daïmios, quelles que fussent ses antipathies à l’égard des descendants d’Iyéyas, n’a jamais
admis l’éventualité d’une candidature prise en dehors des familles Gosankés.
Je doute fort que ce soit en leur qualité de dynastes féodaux que les princes du clan
des Tokoungawa, décorés du titre de Siogouns, ont pu compter au nombre de leurs possessions
les villes de Yédo, de Kioto, de Hiogo, d’Osaka, de Sakaï, d’Hakodate et de Nagasaki.
Il s’agirait alors d’expliquer comment ces villes, ayant appartenu à un seigneur
de Ksiou, lorsqu’il exerçait les fonctions de Siogoun, cessaient d’être la propriété de sa
famille, et devenaient l’apanage d’un seigneur de Mito, aussitôt que celui-ci suçcédait audit
prince de Ksiou dans la charge de Siogoun. Évidemment, ces importantes cités sont des
villes impériales, formant l’apanage spécial des Siogouns.
Si ces derniers n’ont ouvert au commerce étranger que des villes sur lesquelles
s’exerçait leur domination immédiate, et encore faudrait-il savoir si Niagata ne^fait pas exception,
je m’explique aisément cette particularité, et cela par deux raisons : d’aho®d, le
droit féodal ne permet pas au souverain de requérir de ses vassaux des prestations arbitraires,
en dehors de celles qui sont formellement stipulées dans l’hommage qu’ils lui ont
prêté : d’où je conclus que le Mikado lui-même ne saurait disposer d’un port de ses
vassaux sans leur agrément préalable ; ensuite, il n’était pas dans l’intérêt des Taïkouns,
selon les vues égoïstes de leur politique, de faire bénéûcier les grands seigneurs féodaux
des relations commerciales établies avec l’Occident.
Les Taïkouns étaient sans doute impuissants à ouvrir, de leur propre chef, des ports
appartenant à des seigneurs féodaux, mais il n’aurait tenu qu’à eux de le faire avec le
consentement des intéressés. Le monopole commercial que les Taïkouns se sont arrogé
a été l’une des causes capitales de leur chute.
Encore une observation,,et je clos cette digression qui, tout oiseuse qu’elle peut paraître,
a cependant une importance d’actualité. Il serait intéressant de savoir comment
s’exerce la persécution religieuse dont l’Empire du Japon se souille de nouveau depuis
deux années, si ce n’est plus. Qui est-ce qui déporte sur les îles lointaines de l’archipel
des milliers d’indigënes qui ont embrassé le catholicisme dans diverses contrées de Kiou-
siou et de Nippon? Des mesures de ce genre, exécutées sur une si vaste échelle, ne sauraient
être le résultat d’un simple concordat de seigneur à seigneur. Il y a lieu de croire
que le Mikado a ordonné, et que son agent administratif, le Siogoun, a pourvu, comme
autrefois, aux moyens d’exécution.
C’est au nom des lois de Gonghensama que le parti féodal a protesté contre les traités;
c’est au nom de ces mêmes lois qu’une nouvelle persécution religieuse s’est organisée.
Que la noblesse japonaise daigne aussi ne pas faire abstraction des lois de Gonghensama
dans sa levée de boucliers contre l’institution siogounale! Ce que la force a créé, la force
peut le détruire ; ce que les armes d’Iyévas ont fondé, les armes d’Arizoungawa, le héros
du jour, peuvent le renverser; mais que l’on convienne franchement que l’on renverse
l’édifice de Gonghensama, c’est-à-dire que l’on fait une révolution !
, C’est un spectacle qui ne me déplaît nullement, que de voir la noblesse féodale, et le
•Mikado en tête, déchirer de leurs propres mains ce pacte sacré, si souvent invoqué en
faveur de l’ancienne politique d’isolement, d’intolérance et d’odieuses persécutions, qui a
caractérisé les dominateurs du Japon.
L’omission que je reproche au parti féodal est précisément la lacune que je signale
dans la théorie de la nouvelle école : celle-ci ne tient aucun compte du pacte de Gonghensama,
lequel instituait non-seulement une confédération des princes héréditaires du
Japon, sous la suprématie du Mikado, mais aussi une lieutenance générale de l’Empire,
un siogounat héréditaire dans le clan des Tokoungawa.
Ce pacte, signé par toutes les parties, en 1593, a formé jusqu’à nos jours la base de
l’ordre légal dans l’Empire japonais. Conséquemment le Taïkoun et ses défenseurs dans
la crise actuelle ont été les représentants de la légalité. Vaincus par les armes du parti
féodal, leur chute laisse,, pour le moment, l’Empire dans l’anarchie, et les vainqueurs
doivent aviser a le reconstituer sur de nouvelles bases.
Les puissances occidentales en relation avec le Japon ne manqueront pas sans doute
d’user, à cette occasion, de toute leur influence pour que le nouvel état de choses offre
de sérieuses garanties non-seulement à la liberté commerciale, mais à la plus précieuse
de toutes les libertés, la liberté de conscience, sans laquelle notre civilisation ne jettera
jamais de profondes racines chez le peuple japonais.
Telle est la situation vraie, sans équivoque et sans omission.
Il paraît malheureusement avéré que les vainqueurs ont prononcé des condamnations
politiques : l’exil et les confiscations frappent coup sur coup les vaincus. Nous connaissons
aussi en Europe ces procédés de l’esprit de parti; mais ils ne réussissent pas à intervertir
les rôles, et l’histoire impartiale prononce en dernier ressort.
Le changement qui vient de s’opérer au Japon n’est donc pas autre chose qu’une
révolution, dont toute la justification se résume en un seul mot, d’une vertu magique,
le succès!
Le régime qui sortira de cette révolution, si elle se consolide, n’a aucun intérêt à
s’étayer d’une autre théorie que celle du fait accompli.
ai