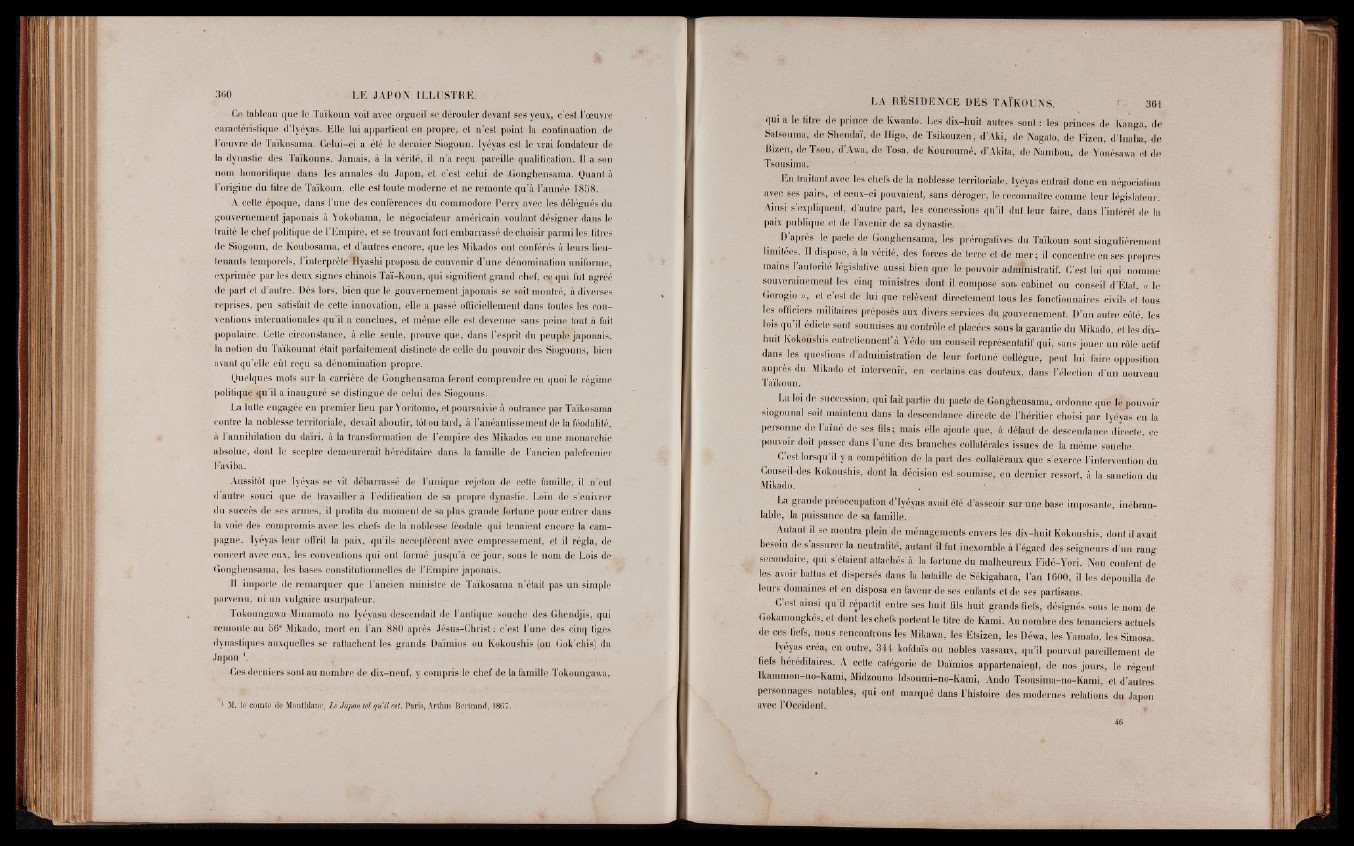
Cç tableau que le Taïkoun voit avec orgueil se dérouler devant ses yeux, c’est i ’oeuvre
caractéristique d’Iyéyas. Elle lui appartient en propre, et n’est point la continuation de
F oeuvre de Taïkosama. Celui-ci a été le dernier Siogoun. Iyéyas est le vrai fondateur de
la dynastie des Taïkouns. Jamais, à la vérité, il n’a reçu pareille qualification. Il a son
nom honorifique dans les annales du Japon, et c’est celui de .Gonghensama. Quant à
l’origine du titre de Taïkoun, elle est toute moderne et ne remonte qu’à l’année 1858.
A cette époque, dans l’une des conférences du commodore Perry avec les délégués du
gouvernement japonais à Yokohama, le négociateur américain voulant désigner dans le
traité le chef politique de l’Empire, et se trouvant fort embarrassé de choisir parmi les titres
de Siogoun, de Koubosama, et d’autres encore, que les Mikados ont conférés à leurs lieutenants
temporels, Finterprète^Hyashi proposa de convenir d’une dénomination uniforme,
exprimée par les deux signes chinois Taï-lvoun, qui signifient grand chef, ce qui fut agréé
de part et d’autre. Dès lors, bien que le gouvernement japonais se soit montré, à diverses
reprises, peu satisfait de cette innovation, elle a passé officiellement .dans toutes les conventions
internationales qu’il a conclues, et même elle est devenue sans peine tout à fait
populaire. Cette circonstance, à elle seule, prouve que, dans l’esprit du peuple japonais,
la notion du Taïkounat était parfaitement distincte de celle du pouvoir des Siogouns, bien
avant qu’elle eût reçu sa dénomination propre.
Quelques mots sur la carrière de Gonghensama feront comprendre en quoi le régime
politique qu’il a inauguré se distingue de celui des Siogouns.
La lutte engagée en premier lieu parYoritomo, et poursuivie à outrance par Taïkosama
contre la noblesse territoriale, devait aboutir, tôt ou tard, à l’anéantissement de la féodalité,
à l’annihilation du daïri, à la transformation de l’empire des Mikados en une monarchie
absolue, dont le sceptre demeurerait héréditaire dans la famille de l’ancien palefrenier
Faxiba.
Aussitôt que Iyéyas se vit débarrassé de l’unique rejeton de cette famille, il n’eut
d’autre souci que de travaillera l’édification de sa propre dynastie. Loin de s’enivrer
«lu succès de ses armes, il profita du moment de sa plus grande fortune pour entrer dans
la voie des compromis avec les chefs de la noblesse féodale qui tenaient encore la campagne.
Iyéyas leur offrit la paix, qu’ils acceptèrent avec empressement, et il régla, de
concert avec eux, les conventions qui ont formé jusqu’à ce, jour, sous le nom de Lois de
Gonghensama, les bases constitutionnelles de l’Empire japonais.
Il importe de remarquer que l’ancien ministre de Taïkosama n’était pas un simple
parvenu, ni un vulgaire usurpateur.
Tokoungawa Minamoto no Iyéyasu descendait de l’antique souche des Ghendjis, qui
remonte au 56e Mikado, mort en Fan 880 après Jésus-Christ : c’est l’une des cinq liges
dynastiques auxquelles se rattachent les grands Daïmios ou Kokoushis (ou Gok’chis) du
Japon l.
Ges derniers sont au nombre de dix-neuf, y compris le chef de la famille Tokoungawa,
1 M. le comte de Montblanc, Le Japon tel qu il est. Paris, Arthus Berlrand, 1867.
qui a le titre de prince de Kwanto. Les dix-huit autres sont : les princes de Kanga, de
Satsouma, de Shendaï, de Higo, de Tsikouzen, d’Aki, de Nagato, de Fizen, d’Inaba, de
Bizen, deTsou, d’Awa, de Tosa, de Kouroumé, d’Akita, deNambou, de Yonésawa et de
Tsousima.
En traitant avec les chefs de la noblesse territoriale, Iyéyas entrait donc en négociation
avec ses pairs, et ceux-ci pouvaient, sans déroger, le reconnaître comme leur législateur.
Ainsi s’expliquent, d’autre part, les concessions qu’il dut leur faire, dans l’intérêt de la
paix publique et de l’avenir de sa dynastie.
D après le pacte de Gonghensama, les prérogatives du Taïkoun sont singulièrement
limitées. Il dispose, à la vérité, des forces de terre et de mer ; il concentre en ses propres
mains 1 autorité législative aussi bien que le pouvoir administratif. C’est lui qui nomme
souverainement les cinq ministres dont il compose' son. cabinet ou conseil d’État, « le
Gorogio », et c’est de lui que relèvent directement tous les fonctionnaires civils et tous
les officiers militaires préposés aux divers services du gouvernement. D’un autre côté, les
lois qu’il édicté sont soumises au contrôle et placées sous la garantie du Mikado, et les dix-
huit Kokoushis entretiennent'à Yédo un conseil représentatif qui, sans jouer un rôle actif
dans les questions d’administration de leur fortuné collègue, peut lui faire opposition
auprès du Mikado et intervenir, en certains cas douteux, dans l’élection d’un nouveau
Taïkoun.
La loi de succession* qui fait partie du pacte de Gonghensama, ordonne que le .pouvoir
siogounal soit maintenu dans la descendance directe de l’héritier choisi par Iyéyas en la
personne de l’ainé de ses fils; mais elle ajoute que, à défaut de descendance directe, ce
pouvoir doit passer dans l’une des branches collatérales issues de la même souche.
C est lorsqu il y a compétition de la part des collatéraux que s’exerce l’intervention du
Conseil-des Kokoushis, dont la décision est soumise, en dernier ressort, à la sanction du
Mikado.
La grande préoccupation d’Iyéyas avait été d’asseoir sur une base imposante, inébranlable,
la puissance de sa famille.
Autant il se montra plein de ménagements envers les dix-huit Kokoushis, dont il avait
besoin de s’assurer la neutralité, autant il fut inexorable à l’égard des seigneurs d’un rang
secondaire, qui s étaient attachés à la fortune du malheureux Fidé-Yori. Non content de
les avoir battus et dispersés dans la bataille dé Sékigahara, l’an 1600, il les dépouilla de
leurs domaines et en disposa en faveur de ses enfants et de ses partisans.
C est ainsi qu il répartit entre ses huit fils huit grands fiefs, désignés sous le nom de
Gokamongkés, et dont les chefs portent le titre de Kami. Au nombre des tenanciers actuels
de ces fiefs, nous rencontrons les Mikawa, les Etsizen, les Déwa, les Yamato, les Simosa.
Iyéyas créa, en outre, 344 kofdaïs ou nobles vassaux, qu’il pourvut pareillement de
fiefs héréditaires. A cette catégorie de Daïmios appartenaient, de nos jours, le régent
Ikammon-no-Kami, Midzouno Idsoumi-no-Kami, Ando Tsousima-no-Kami, et d’autres
personnages notables, qui ont marqué dans l’histoire des modernes relations du Japon
avec l’Occident.