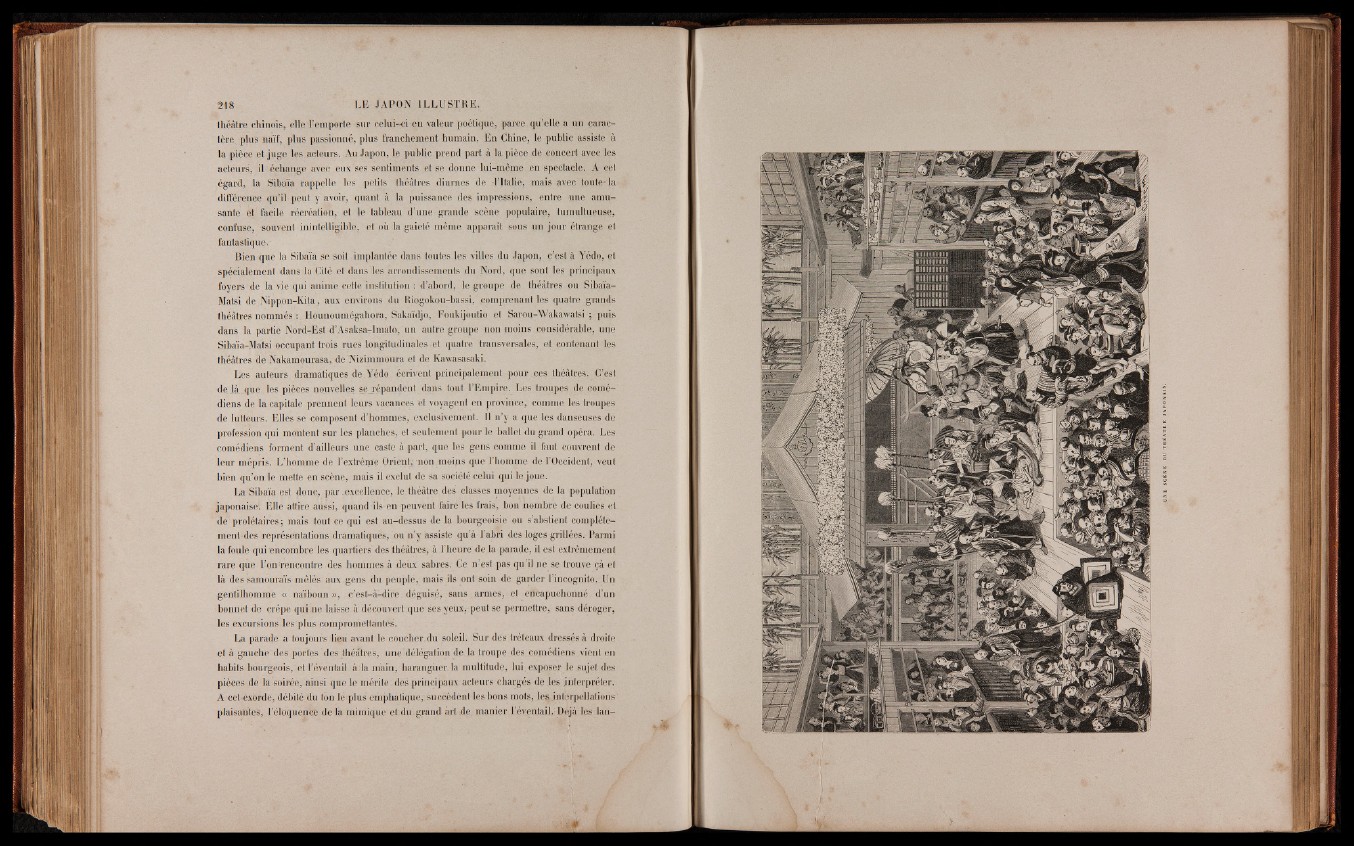
Ihéàtre chinois, elle l’emporte sur celui-ci en valeur poétique, parce qu’elle a un caractère
plus naïf, plus passionné, plus franchement humain, En Chine, le public assiste à
la pièce et juge les acteurs. Au Japon, le public prend part à la pièce de concert avec les
acteurs, il échange avec eux ses sentiments et se donne lui-même en spectacle. A cet
égard, la Sibaïa rappelle les petits théâtres diurnes de 4’Italie, mais avec toute-la
différence qu’il peut y avoir, quant à la puissance des impressions, entre une amusante
et facile récréation, et le tableau d’une grande scène populaire, tumultueuse,
confuse, souvent inintelligible, et où la gaieté même apparaît sous un jour étrange et
fantastique.
Bien que la Sibaïa se soit implantée dans toutes les villes du Japon, c’est à Yédo, et
spécialement dans la Cité et dans les arrondissements du Nord, que sont les principaux
foyers de la vie qui anime cette institution : d’abord, le groupe de théâtres Ou Sibaïa-
Matsi de Nippon-Kita, aux environs du Riogokou-bassi, comprenant les quatre grands
théâtres nommés::. Hounoumégahora, Sakaïdjo, Foukijoutio et Sarou-Wakawatsi ; puis
dans la partie Nord-Est d’Asaksa-Imato, un autre groupe non moins considérable, une
Sibaïa-Matsi occupant trois rues longitudinales et quatre transversales, et contenant les
théâtres de Nakamourasa, de Nizimmoura et de Kawasasaki.
Les auteurs dramatiques de Yédo écrivent principalement pour ces théâtres. C’est
de là que les pièces nouvelles se_répandent dans tout l’Empire. Les troupes de comédiens
de la capitale prennent leurs vacances et voyagent en province, comme les troupes
de lutteurs. Elles se composent d’hommes, exclusivement. Il n’v a que les danseuses de
profession qui montent sur les planches, et seulement pour le ballet du grand opéra. Les
comédiens forment d’ailleurs une caste à part, que les gens comme il faut couvrent de
leur mépris. L’homme de l’extrême Orient, non moips que l’homme de l’Occident, veut
bien qu’on le mette en scène, mais il exclut de sa société celui qui le joue.
La Sibaïa est donc, par .excellence, le théâtre de^ classes moyennes de la population
japonaise1. Elle attire aussi, quand ils en peuvent faire les frais, bon nombre de coulies et
de prolétaires ; mais tout ce qui est au-dessus de la bourgeoisie ou s’abstient complètement
des représentations dramatiques, ou n’y assiste qu’à l’abri des loges grillées. Parmi
la foule qui encombre les quartiers des théâtres, à l’heure de.la parade, il est extrêmement
rare que l’o n ‘rencontre des hommes à deux sabres. Ce. n?est pas qu’il ne se trouve çà et
là des samouraïs mêlés aux gens du peuple, mais ils ont soin de garder l’incognito. Un
gentilhomme « naïboun », c’est-à-dire déguisé,. sans . armes, et encapuchonné d’un
bonnet de crêpe qui ne laisse à découvert que ses yeux, peut se permettre, sans déroger,
les excursions les plus compromettantes.
La parade a toujours.lieu avant le coucher, du soleil. Sur des tréteaux dressés à droite
et à gauche des portes des théâtres, une délégation de la troupe des comédiens vient en
habits bourgeois, et l’éventail à la main, haranguer, la multitude, lui exposer le .sujet des
pièces de la soirée, ainsi que le mérite dés principaux acteurs chargés dè les interpréter.
A cet-èxorde, débité du ton le plus emphatique,, succèdënt les bons mots, le§ interpellations
plaisantes, l’éloquencë de là mimique et du grand art,de manier l’éventail. Dtljà les lan