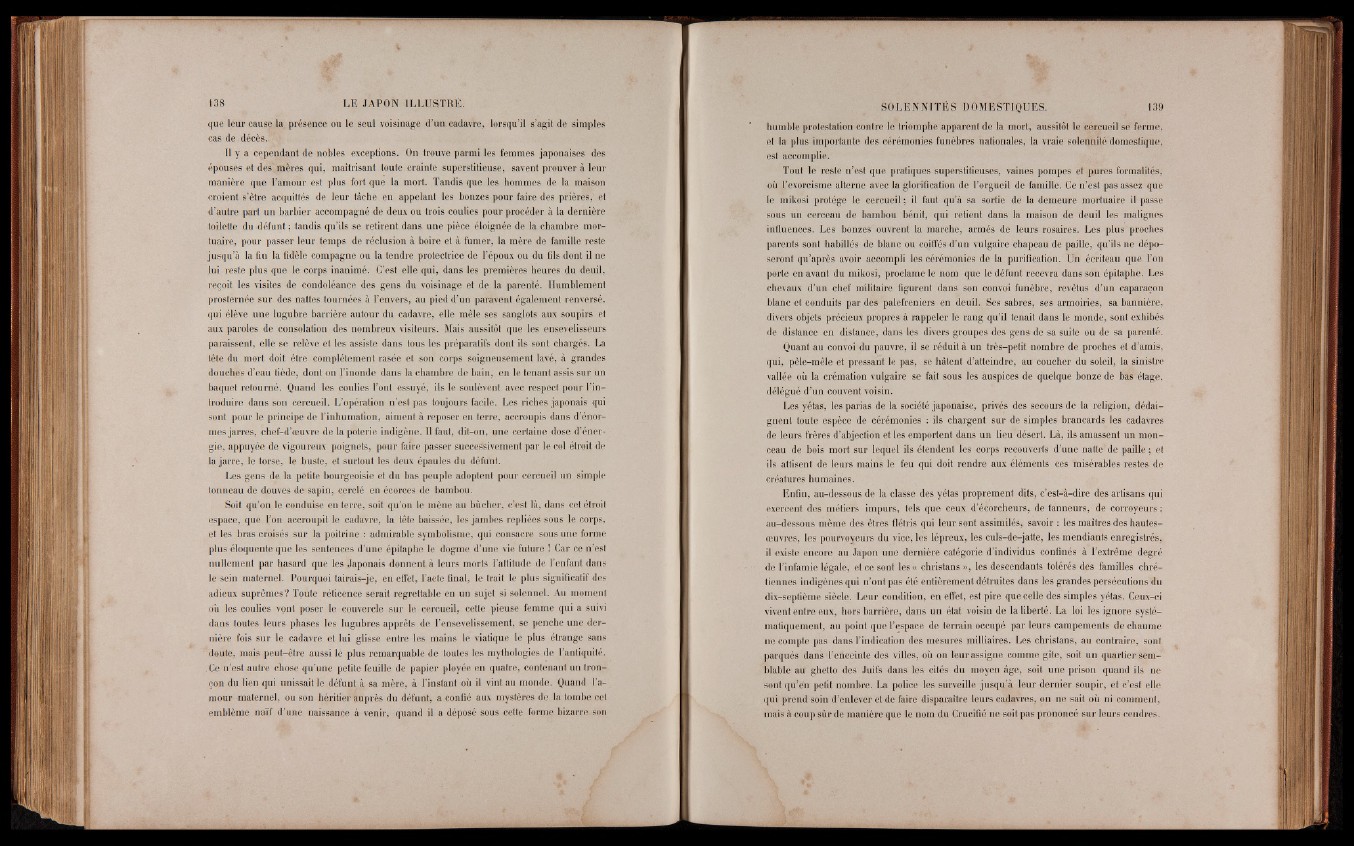
que leur cause la présence ou le seul voisinage d’un cadavre, lorsqu’il s’agit de simples
cas de décès. •' ^
Il y a cependant de nobles exceptions. On trouve parmi les femmes japonaises des
épouses et des mères qui, maîtrisant toute crainte superstitieuse, savent prouver à leur
manière que l'amour est plus fort que la mort. Tandis que les hommes de la maison
croient s’ètre acquittés de leur tâche en appelant les bonzes pour faire des prières,' et
d’autre part un barbier accompagné de deux ou trois coulies pour procéder à la dernière
toilette du défunt ; tandis qu’ils se retirent dans une pièce éloignée de la chambre mortuaire,
pour passer leur temps de réclusion à boire et à fumer, la mère de famille reste
jusqu’à la fin la fidèle compagne ou la tendre protectrice de l’époux ou du fils dont il ne
lui reste plus que le corps inanimé. C’est elle qui, dans les premières heures du deuil,
reçoit les visites de condoléance des gens du voisinage et de la parenté. Humblement
prosternée sur des nattes tournées à l’envers, au pied d’un paravent également renversé,
qui élève une lugubre barrière autour du cadavre, elle mêle ses sanglots aux soupirs et
aux paroles de consolation des nombreux visiteurs. Mais aussitôt que les ensevelisseurs
paraissent, elle se relève et les assiste dans tous les préparatifs dont ils sont chargés. La
tête du mort doit être complètement rasée et son corps soigneusement lavé, à grandes
douches d’eau tiède, dont on l’inonde dans la chambre de bain, en le tenant assis sur un
baquet retourné. Quand les coulies l’ont essuyé, ils le soulèvent avec respect pour l’introduire
dans son cercueil. L’opération n ’est pas toujours facile. Les riches japonais qui
sont pour le principe de l’inhumation, aiment à reposer en terre, accroupis dans d’énormes
jarres, chef-d’oeuvre de la poterie indigène. Il faut, dit-on, une certaine dose d’énergie,
appuyée de vigoureux poignets, pour faire passer successivement par le col étroit de
la jarre, le torse, le buste, et surtout les deux épaules du défunt.
Les gens de la pêtite bourgeoisie et du bas peuple adoptent pour cercueil un simple
tonneau de douves de sapin, cerclé en écorces de bambou.
Soit qu’on le conduise en terre, soit qu’on le mène au bûcher, ctest là, dans cet étroit
espace, que l’on accroupit le cadavre, la tête baissée, les jambes repliées sous le corps,
et les bras croisés sur la poitrine : admirable symbolisme, qui consacre sous une forme
plus éloquente que les sentences d’une épitaphe le dogme d’une vie future ! Car ce n’est
nullement par hasard que les Japonais donnent à leurs morts l’attitude de l’enfant dans
le sein maternel. Pourquoi tairais-je, en effet, l’acte final, le trait le plus significatif des
adieux suprêmes? Toute réticence serait regrettable en un sujet si solennel. Au moment
oîi les coulies vont poser le couvercle sur le cercueil, cette pieuse femme qui a suivi
dans toutes leurs phases les lugubres apprêts de l’ensevelissement, se penche une dernière
fois sur le cadavre et lui glisse entre les mains le viatique le plus étrange sans
doute, mais peut-être aussi le plus remarquable de toutes les mythologies de l’antiquité.
. Ce n’est autre chose qu’une petite feuille de papier ployée en quatre, contenant un tronçon
du lien qui unissait le défunt à sa mère, à l’instant où il vint au monde. Quand l’amour
maternel, ou son héritier auprès du défunt, a confié aux mystères de la tombe cet
emblème naïf d’une naissance à venir, quand il a déposé sous cette forme bizarre son
humble protestation contre le triomphe apparent de la mort, aussitôt le cercueil se ferme,
et la plus importante des cérémonies funèbres nationales, la vraie solennité domestique,
est accomplie.
Tout le reste n’est que pratiques superstitieuses, vaines pompes et pures formalités,
où l’exorcisme alterne avec la glorification de l’orgueil de famille. Ce n’est pas assez que
le mikosi protège le cercueil ; il faut qu’à sa sortie de la demeure mortuaire il passe
sous un cerceau de bambou bénit, qui retient dans la maison de deuil les malignes
influences. Les bonzes ouvrent la marche, armés de leurs rosaires. Les plus proches
parents sont habillés de blanc ou coiffés d’un vulgaire chapeau de paille, qu’ils ne déposeront
qu’après avoir accompli les cérémonies de la purification. Un écriteau que l’on
porte en avant du mikosi, proclame le nom que le défunt recevra dans son épitaphe. Les
chevaux d’un chef militaire figurent dans son convoi funèbre, revêtus d’un caparaçon
blanc et conduits par des palefreniers en deuil. Ses sabres, ses armoiries, sa bannière,
divers objets précieux propres à rappeler le rang qu’il tenait dans le monde, sont exhibés
de distance en distance, dans les divers groupes des gens de sa suite ou de sa parenté.
Quant au convoi du pauvre, il se réduit à un très-petit nombre de proches et d’amis,
qui, pêle-mêle et pressant le pas, se hâtent d’atteindre, au coucher du soleil, la sinistre
vallée où la crémation vulgaire se fait sous les auspices de quelque bonze de bas étage,
délégué d’un couvent voisin.
Les yétas, les parias de la société japonaise, privés des secours de la religion, dédaignent
toute espèce de cérémonies : ils chargent sur de simples brancards les cadavres
de leurs frères d’abjection et les emportent dans un lieu désert. Là, ils amassent un monceau
de bois mort sur lequel ils étendent les corps recouverts d’une natte de paille; et
ils attisent de leurs mains le feu qui doit rendre aux éléments ces misérables restes de
créatures humaines.
Enfin, au-dessous de la classe des yétas proprement dits, c’est-à-dire des artisans qui
exercent des métiers impurs, tels que ceux d ecorcheurs, de tanneurs, de corroyeurs ;
au-dessous même des êtres flétris qui leur sont assimilés, savoir : les maîtres des hautes-
oeuvres, les pourvoyeurs du vice, les lépreux, les culs-de-jatte, les mendiants enregistrés,
il existe encore au Japon une dernière catégorie d’individus confinés à l’extrême degré
de l’infamie légale, et ce sont les« christans», les descendants tolérés des familles chrétiennes
indigènes qui n’ont pas été entièrement détruites dans les grandes persécutions du
dix-septième siècle. Leur condition, en effet, est pire que celle des simples yétas. Ceux-ci
vivent entre eux, hors barrière, dans un état voisin de la liberté. La loi les ignore systématiquement,
au point que l’espace de terrain occupé p a rleu rs campements de chaume
ne compte pas dans l’indication des mesures milliaires. Les christans, au contraire, sont
parqués dans l’enceinte des villes, où on leur assigne comme gîte, soit un quartier semblable
au ghetto des Juifs dans les cités du moyen âge, soit une prison quand ils ne
sont qu’en petit nombre. La police les surveille jusqu’à leur dernier soupir, et c’est elle
qui prend soin d’enlever et de faire disparaître leurs cadavres, on ne sait où ni comment,
mais à coup sûr de manière que le nom du Crucifié ne soit pas prononcé sur leurs cendres.