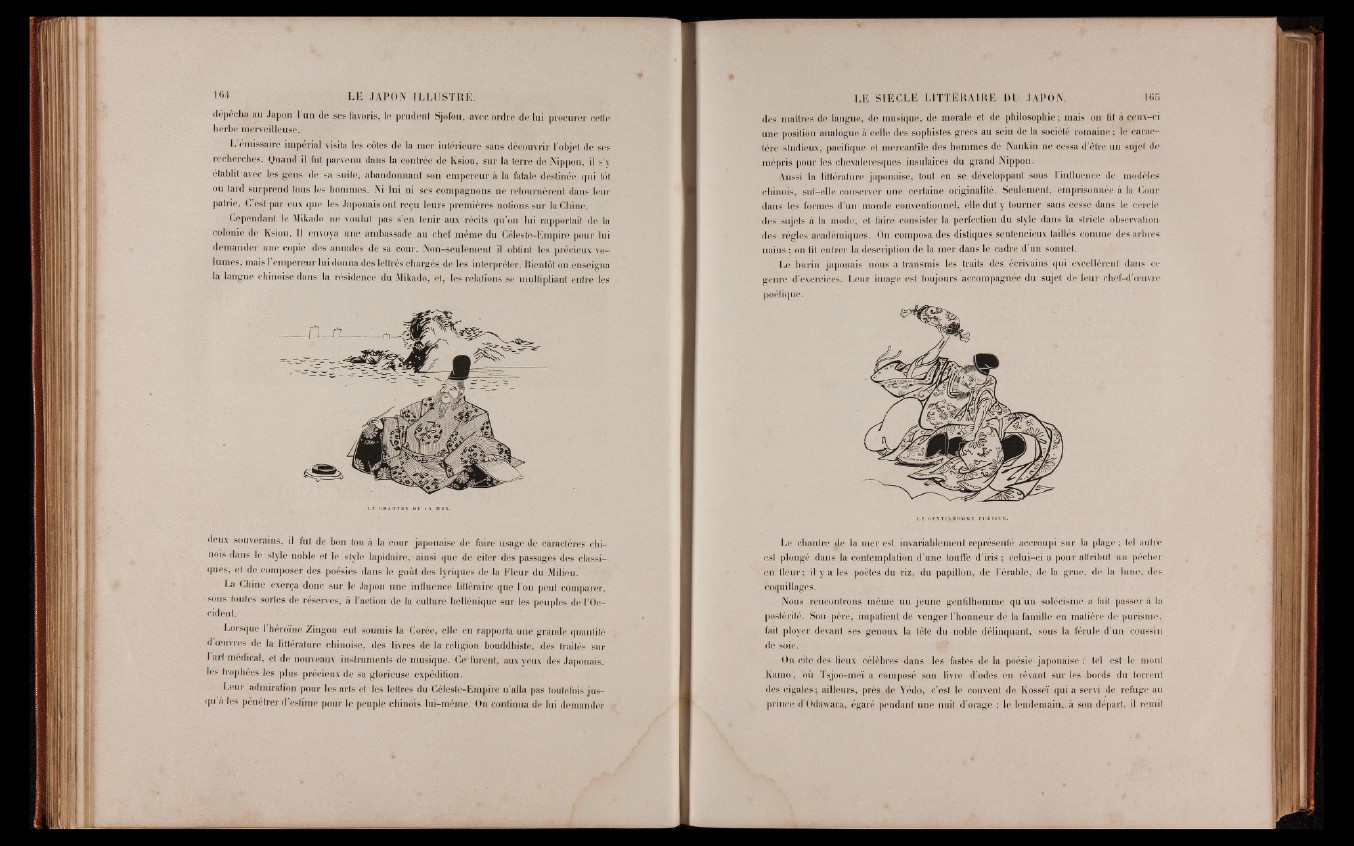
dépêcha au Japon l’un de ses favoris, le prudent Sjofou, avec ordre de lui procurer cette
herbe merveilleuse.
L émissaire impérial visita les côtes de la mer intérieure sans découvrir l’objet de ses
recherches. Quand il fut parvenu dans la contrée de Ksiou, sur la terre de Nippon, il s’y
établit avec les gens de sa suite, abandonnant son empereur à la fatale destinée qui tôt
ou tard surprend tous les hommes. Ni lui ni ses compagnons ne retournèrent dans leur
patrie. C’est par eux que les Japonais ont reçu leurs premières notions sur la Chine.
Cependant le Mikado ne voulut pas s’en tenir aux récits qu’on lui rapportait de la
colonie de Ksiou. II envoya une ambassade au chef même du Céleste-Empire pour lui
demander une copie des annales de sa cour. Non-seulement il obtint les précieux volumes,
mais l’empereur lui donna des lettrés chargés de les interpréter. Rientôt on enseigna
la langue chinoise dans la résidence du Mikado, et, les relations se multipliant entre les
LE CHANTRE DE LA MER.
deux souverains, il fut de bon ton à la cour japonaise de faire usage de caractères chinois
dans le style noble et le style lapidaire, ainsi que de citer des passages des classiques,
et de composer des poésies dans le goût des lyriques de la Fleur du Milieu
La Chine exerça donc sur le Japon une influence littéraire que l’on peut comparer,
* sous toutes sortes de réserves, à l’action de la culture hellénique sur les peuples de l’Occident.
Lorsque l’héroïne Zingou eut soumis la Corée, elle en rapporta une grande quantité
d oeuvres de la littérature chinoise, des livres de la religion bouddhiste, des traités sur
I art médical, et de nouveaux instruments de musique. Ce furent, aux yeux des Japonais,
les trophées les plus précieux de sa glorieuse expédition.
Leur admiration pour les arts et les lettres du Céleste-Empire n ’alla pas toutefois jus-
qu a les pénétrer d’estime pour le peuple chinois lui-même. On continua de lui demander
des maîtres de langue, de musique, de morale et de philosophie; mais on lit à ceux-ci
une position analogue à celle des sophistes grecs au sein de la société romaine; le caractère
studieux, pacifique et mercantile des hommes de Nankin ne cessa d’être un sujet de
mépris pour les chevaleresques insulaires du grand Nippon.
Aussi la littérature japonaise, tout en se développant sous l’influence de modèles
chinois, sut-elle conserver une certaine originalité. Seulement, emprisonnée à la Cour-
dans les formes d’un monde conventionnel, elle dut y tourner sans cesse dans le cercle
des sujets à la mode, et faire consister la perfection du style dans la stricte observation
des règles académiques. On composa des distiques sentencieux taillés comme des arbres
nains ; on fit entrer la description de la mer dans le cadre d’un sonnet.
Le burin japonais nous a transmis les traits des écrivains qui excellèrent dans ce.
genre d’exercices. Leur image est toujours accompagnée du sujet de leur chef-d’oeuvre
poétique.
Le chantre ÿe la mer est invariablement représenté accroupi sur la plage; tel autre
est plongé dans la contemplation d’une touffe d’iris ; celui-ci a pour attribut un pêcher
en fleur; il y a les poètes du riz, du papillon, de l’érable, de la grue, de la lune, des
coquillages.
Nous rencontrons même un jeune gentilhomme qu’un solécisme a fait passer à la
postérité. Son père, impatient de venger l’honneur de la famille en matière de purisme,
fait ployer devant ses genoux la tête du noble délinquant, sous la férule d’un coussin
de soie.
On cite des lieux célèbres dans les fastes de la poésie japonaise : tel est le mont
lxamo, où Tsjoo-meï a composé son livre d’odes en rêvant sur les bords du torrent
des cigales; ailleurs, près de Yédo, c’est le couvent de Kosseï q u ia servi de refuge au
prince d’Odawara, égaré pendant une nuit d’orage : le lendemain,, à son départ, il remit