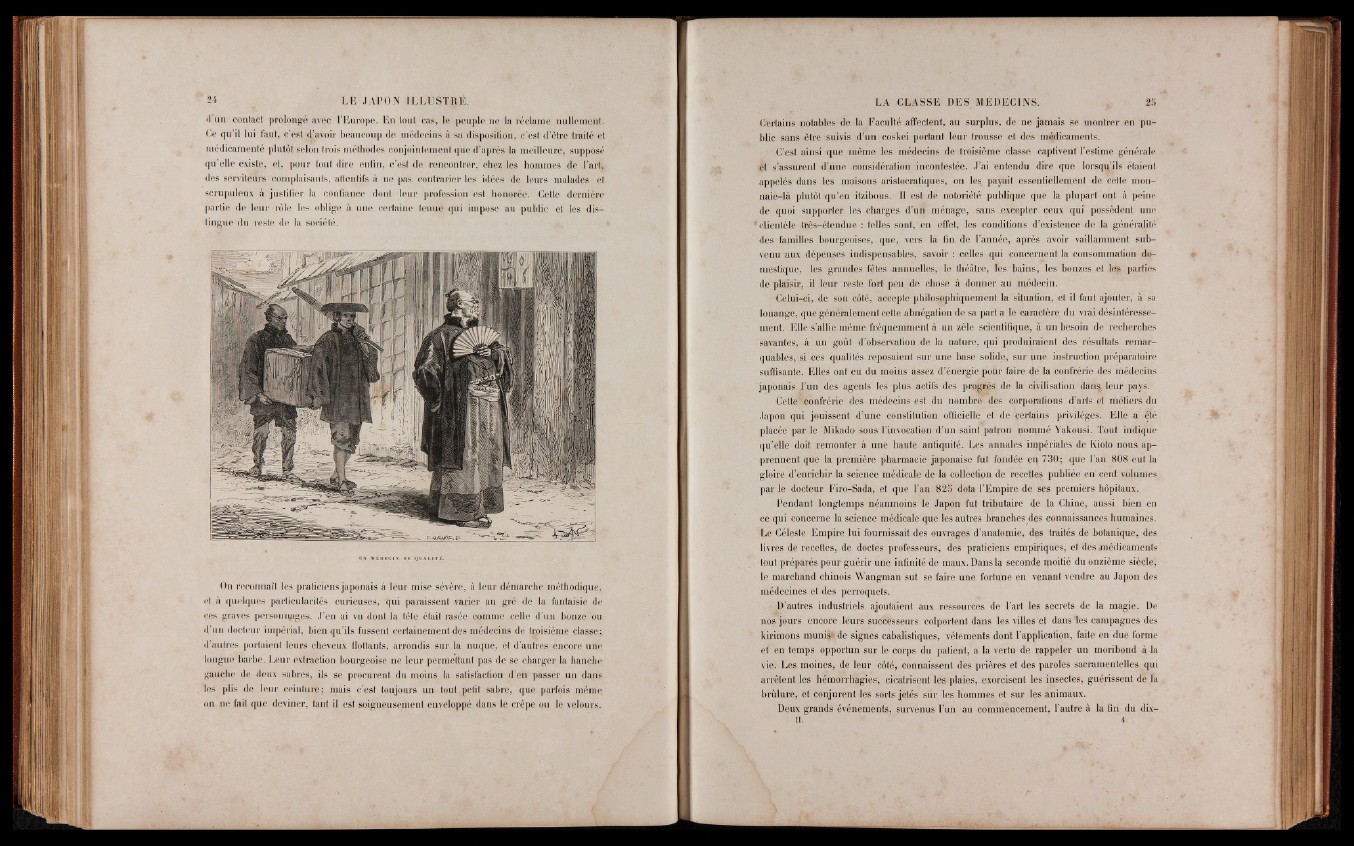
d'un contact prolongé avec l’Europe. En tout cas, le peuple ne la réclame nullement.
Ce qu’il lui faut, c’est d’avoir beaucoup de médecins à sa disposition, c’est d’être traité et
médicamenté plutôt selon trois méthodes conjointement que d’après la meilleure, supposé
qu’elle existe, et, pour tout dire enfin, c’est de rencontrer, chez les hommes de l’art,
des serviteurs complaisants, attentifs à ne pas contrarier les idées de leurs malades et
scrupuleux à justifier la confiance dont leur profession est honorée. Cette dernière
partie de leur rôle les oblige à une certaine tenue qui impose au public et les distingue
UN MÉDECIN DE QUALITÉ.
du reste de la société.
On reconnaît les praticiens japonais à leur mise sévère, à leur démarche méthodique,
et à quelques particularités curieuses, qui paraissent varier au gré de la fantaisie de
ces graves personnages-. J ’en ai vu dont la tête était rasée comme celle d’un bonze ou
d’un docteur impérial, bien qu’ils fussent certainement des médecins de troisième classe;,
d’autres portaient leurs cheveux flottants, arrondis sur la nuque, et d’autres encore une
longue barbe. Leur extraction bourgeoise ne leur permettant pas de se charger la hanche
gauche de deux sabres, ils se procurent du moins la satisfaction d’en passer un dans
les plis de leur ceinture; mais c’est toujours un tout petit sabre, que parfois même,
on ne fait que deviner, tant il est soigneusement enveloppé dans le crêpe ou le velours.
Certains notables de la Faculté affectent, au surplus, de ne jamais se montrer en public
sans être suivis d’un coskei portant leur trousse et des médicaments.
C’est ainsi que même les médecins de troisième classe captivent l’estime générale
et s’assurent d’une considération incontestée. J ’ai entendu dire que lorsqu’ils étaient
appelés dans les maisons aristocratiques, on les payait essentiellement de cette mon-
naie-là plutôt qu’en itzibous. Il est de notoriété publique que la plupart ont à peine
de quoi supporter les charges d’un ménage, sans excepter ceux qui possèdent une
clientèle très-étendue : telles sont, en effet, les conditions d’existence de la généralité
des familles bourgeoises, que, vers la fin de l’année, après avoir vaillamment subvenu
aux dépenses indispensables, savoir : celles qui concernent la consommation domestique,
les grandes fêtes annuelles, le théâtre, les bains, les bonzes et les parties
de plaisir, il leur reste fort peu de chose à donner au médecin.
Celui-ci, de son côté, accepte philosophiquement la situation, et il faut ajouter, à sa
louange, que généralement cette abnégation de sa part a le caractère du vrai désintéressement.
Elle s’allie même fréquemment à un zèle scientifique, à un besoin de recherches
savantes, à un goût d’observation de la nature, qui produiraient des résultats remarquables,
si ces qualités reposaient sur une base solide, sur une instruction préparatoire
suffisante. Elles ont eu du moins assez d’énergie pour faire de la confrérie des médecins
japonais J ’un des agents les plus actifs des progrès de la civilisation dan% leur pays.
Cette^confrérie des médecins est du nombre des corporations d’arts et métiers du
Japon qui jouissent d’une constitution officielle et de certains privilèges. Elle a été
placée par le Mikado sous l’invocation d’un saint patron nommé Yakousi. Tout indique
qu’elle doit remonter à une haute antiquité. Les annales impériales de Kioto nous apprennent
que la première pharmacie japonaise fut fondée en 730; que l’an 808 eut la
gloire d’enrichir la science médicale de la collection de recettes publiée en cent volumes
par le docteur Firo-Sada, et que l’an 825 dota l’Empire de ses premiers hôpitaux.
Pendant longtemps néanmoins le Japon fut tributaire de la Chine, aussi bien en
ce qui concerne la science médicale que les autres branches des connaissances humaines.
Le Céleste Empire lui fournissait des ouvrages d’anatomie, des traités de botanique, des
livres de recettes, de doctes professeurs, des praticiens empiriques, et des «médicaments
tout préparés pour guérir une infinité de maux. Dans la seconde moitié du onzième siècle,
le marchand chinois Wangman sut se faire une fortune en venant vendre au Japon des
médecines et des perroquets.
D’autres industriels ajoutaient aux ressources de l’art les secrets de la magie. De
nos jours encore leurs succèsseurs colportent dans les villes et dans le s campagnes des
kirimons munis** de signes cabalistiques, vêtements dont l’application, faite en due forme
et en temps opportun sur le corps du patient, a la vertu de rappeler un moribond à la
vie. Les moines, de leur côté, connaissent des prières et des paroles sacramentelles qui
arrêtent les hémorrhagies, cicatrisent les plaies, exorcisent les insectes, guérissent de la
brûlure, et conjurent les sorts jetés sur les hommes et sur les animaux.
Deux grands événements, survenus l’un au commencement, l’autre à la fin du dix