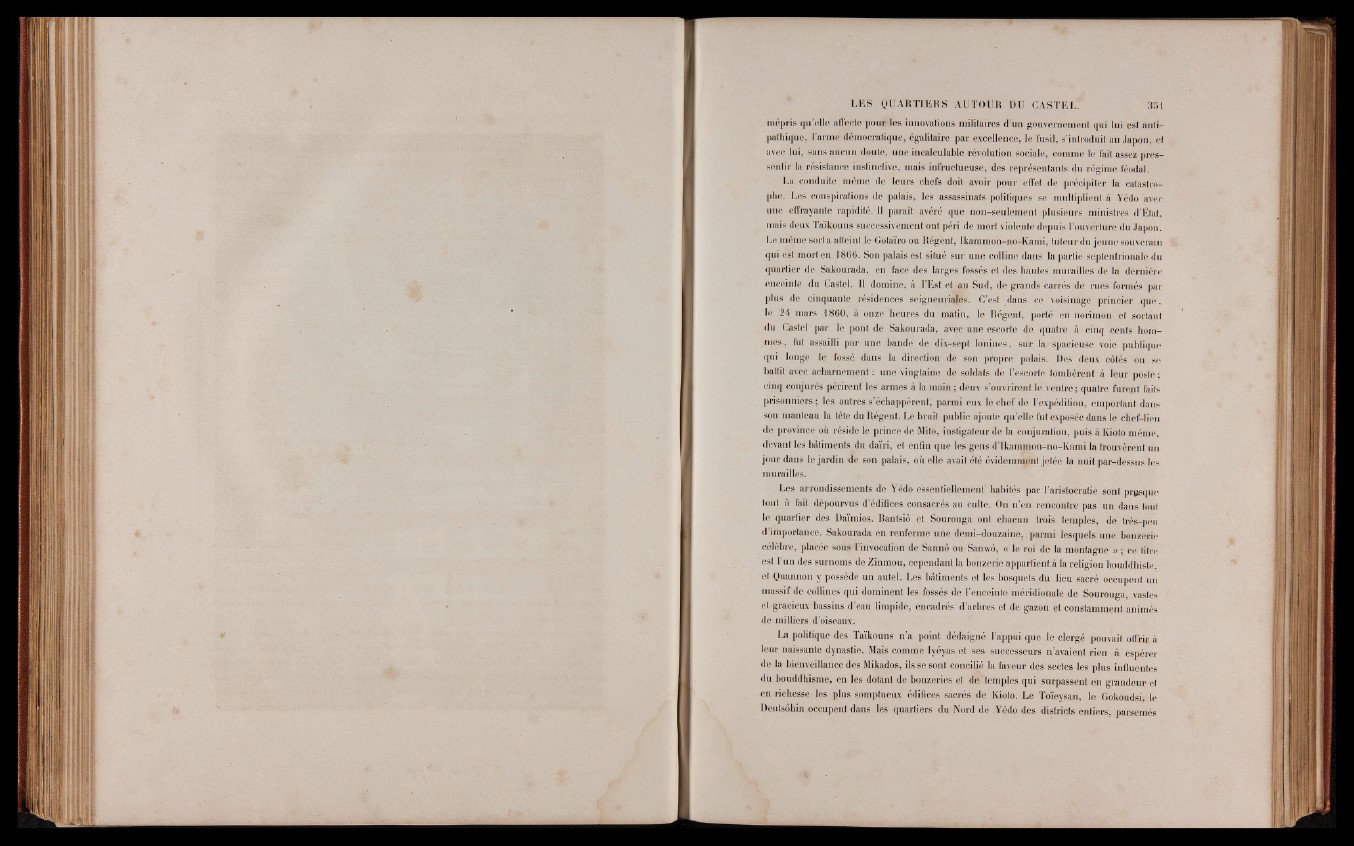
mépris qu’elle affeete pour les innovations militaires d’un gouvernement qui lui est antipathique,
l’arme démocratique, égalitaire par excellence, le fusil, s’introduit au Japon, et
avec lui, sans aucun doute, une incalculable révolution sociale, comme le fait assez pressentir
la résistance instinctive, mais infructueuse, des représentants du régime féodal.
La conduite même de leurs chefs doit avoir pour effet de précipiter la catastrophe.
Les conspirations de palais, les assassinats politiques se multiplient à Yédo avec
une effrayante rapidité. Il paraît avéré que non-seulement plusieurs ministres d’État,
mais deux Taïkouns successivement ont péri de mort violente depuis l’ouverture du Japon.
Le même sort a atteint le Gotairo ou Régent, Ikammon-no-Kami, tuteur du jeune souverain
qui est mort en 1866. Son palais est situé sur une colline dans la partie septentrionale du
quartier de Sakourada, en face des larges fossés et des hautes murailles de la dernière
enceinte du Castel. Il domine, à l’Est et au Sud, de grands carrés de rues formés par
plus de cinquante résidences seigneuriales. C’est dans ce voisinage princier qüe,
le 24 mars 1860, à onze’ heures du matin, le Régent, porté en norimon et sortant
du Castel par le pont de Sakourada, avec une escorte de quatre à cinq cents hommes,
fut assailli par une bande de dix-sept lonines, sur la, spacieuse voie publique
qui longe le fossé dans la direction de son propre palais. Des deux côtés on se
battit avec acharnement : une vingtaine de soldats de l’escorte tombèrent à leur poste ;
cinq conjurés périrent les armes à la main ; deux s’ouvrirent le ventre; quatre furent faits
prisonniers ; les autres s’échappèrent, parmi eux le chef de l'expédition* emportant dans
son manteau la tête du Régent. Le bruit public ajoute qu’elle fut exposée dans le chef-lieu
de province où réside le prince de Mito, instigateur de la conjuration, puis à Kioto même,
devant les bâtiments du daïri, et enfin que les gens d’Ikammon-no-Kami la trouvèrent un
jour dans le jardin de son palais, où elle avait été évidemment jetée la nuit par-dessus les
murailles.
Les arrondissements de Yédo essentiellement' habités par l’aristocratie sont presque
tout à fait dépourvus d’édifices consacrés au culte. On n ’en rencontre pas un dans tout
le quartier des Daïmios. Rantsiô et Sourouga ont chacun trois temples, de très-peu
d’importance. Sakourada en renferme une demi-douzaine, .parmi lesquels une bonzerie
célèbre, placée sous l’invocation de Sannô ou Sanwô, « le roi de la montagne» ; ce t i t r e
est l’un des surnoms de Zinmou, cependant la bonzerie appartient à la religion bouddhiste
et Quannon y possède un autel. Les bâtiments et les bosquets du lieu sacré occupent un
massif de collines qui dominent les fossés de l’enceinte méridionale de Sourouga, vastes
et gracieux bassins d’eau limpide, encadrés d’arbres et de gazon et constamment animés
de milliers d’oiseaux.
La politique des Taïkouns n ’a point dédaigné l’appui que le clergé pouvait offrir à
leur naissante dynastie. Mais comme Iyéyas et ses successeurs n’avaient rien à espérer
de la bienveillance des Mikados, ils se sont concilié la faveur des sectes les plus influentes
du bouddhisme, en les dotant de bonzeries et de temples qui surpassent en grandeur et
en richesse les plus somptueux édifices sacrés de Kioto. Le Toïeysan, le Gokoudsi, le
Dentsôhin occupent dans les quartiers du Nord de Yédo des districts entiers, parsemés