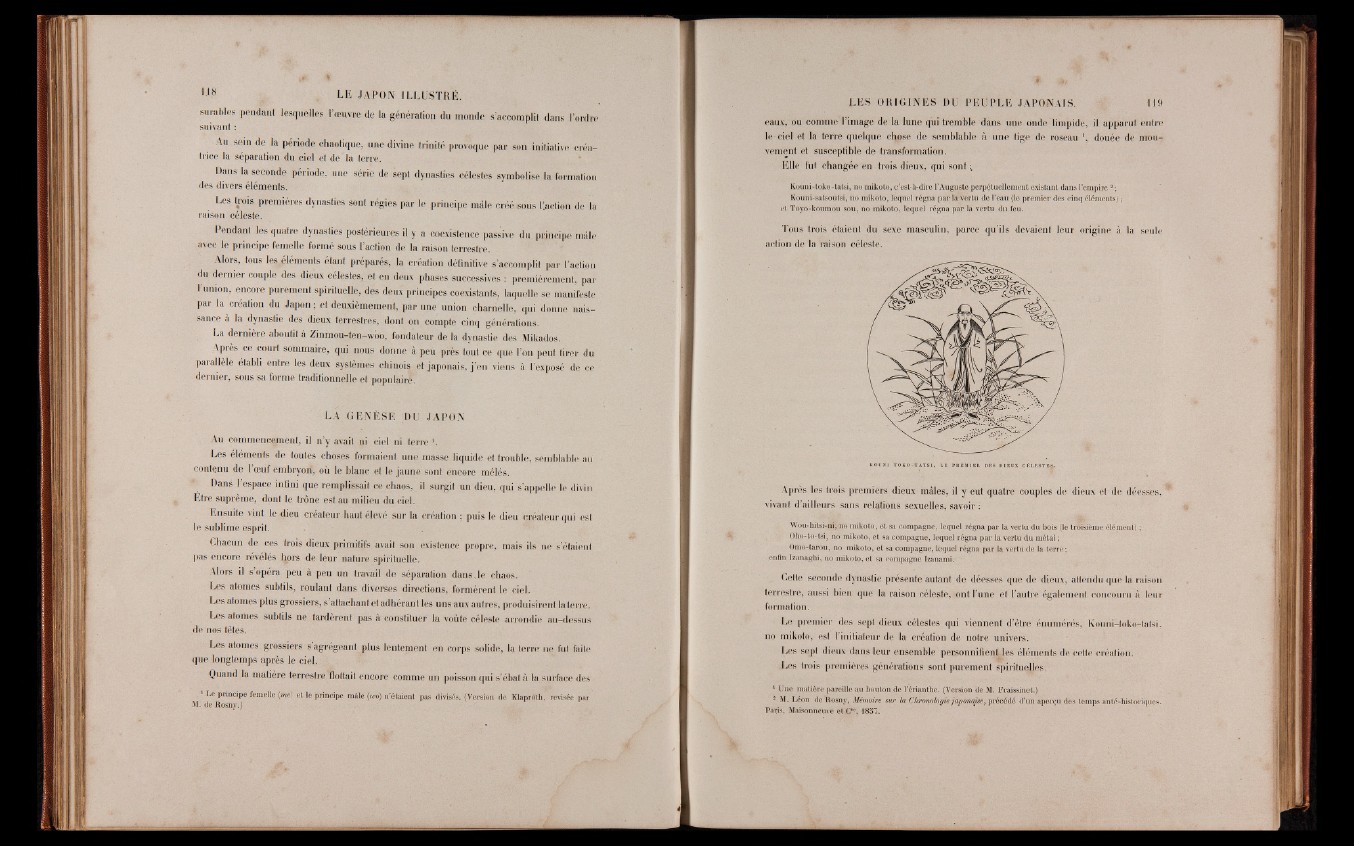
surables pendant lesquelles l’oeuvre de la génération du monde s’accomplit dans l’ordre
suivant :
Au sein de la période chaotique, une divine trinité provoque par son initiative créatrice
la séparation du ciel et de la terre.
Dans la seconde période, une série de jsept dynasties célestes symbolise la formation
des divers éléments.
Les trois premières dynasties sont régies par le principe mâle créé sous [’.action de la
raison céleste.
Pendant les quatre dynasties postérieures il y a coexistence passive du principe mâle
avec le principe femelle formé sous l’action de la raison terrestre.
Alors, tous les éléments étant préparés, la création délinilive s’accomplit par l’action
du dernier couple des dieux célestes, et en deux phases successives : premièrement, par
l’union, encore purement spirituelle, des deux principes coexistants, laquelle se manifeste
par la création du Japon ; et deuxièmement, par une union charnelle, qui donne naissance
à la dynastie des dieux terrestres, dont on compte cinq générations.
La dernière aboutit à Zinmou-ten-woo, fondateur de la dynastie des Mikados.
Après ce court sommaire, qui nous donne à peu près tout ce que l’on peut tirer du
parallèle établi entre les deux systèmes chinois et japonais, j ’en viens à l’exposé de ce
dernier, sous sa forme traditionnelle et populaire.
LA G EN È S E DU JAPON
Au commencement, il n ’y avait ni ciel ni terre 3
Les éléments de toutes choses formaient une masse liquide et trouble, semblable au
contenu de 1 oeuf embryon, où le blanc et le jaune sont encore mêlés.
Dans l’espace infini que remplissait ce chaos, il surgit un dieu, qui s’appelle le jr fv n l
Être suprême, dont le trône est au milieu du ciel.
Ensuite vint le dieu créateur haut élevé sur la création; puis le dieu créateur qui est
le sublime esprit.
Chacun de ces trois dieux primitifs avait son existence propre, mais ils ne s’étaient
pas encore révélés hors de leur nature spirituelle.
Alors il s’opéra peu à peu un travail de séparation dans,le chaos.
Les atomes subtils, roulant dans diverses directions, formèrent le ciel.
Les atomes plus grossiers, s’attachant et adhérant les uns aux autres, produisirent la terre.
Les atomes subtils ne tardèrent pas à constituer la voûte céleste arrondie au-dessus
de nos têtes.
Les atomes grossiers s’agrégeant plus lentement en corps solide, la terre ne fut faite
que longtemps après le ciel.
Quand la matière terrestre flottait encore comme un poisson qui s’ébat à la surface des
1 Le principe femelle (me) et le principe mâle (too) n’étaient pas divisés. (Version île Klaprôth, revisée par
M. de Rosny.)
eaux, ou comme l’image de la lune qui tremble dans une onde limpide, il apparut entre
le ciel et la terre quelque chose de semblable à une tige de roseau ‘, douée de mouvement
et susceptible de transformation.
Elle fut changée en trois dieux, qui sont
Kouni-loko-tatsi, no m ikoto, c ’est-à-dire l’Auguste perpétuellement existant dans l’empire 2;
Kouni-satsoutsi, no mikoto, lequel régna par la vertu de l’eau (le premier des cinq éléments) ;
et Toyo-koumou sou, no mikoto, lequel régna par la vertu du feu.
Tous trois étaient du se'xe masculin, parce qu’ils devaient leur origine à la seule
action de la raison céleste.
Après les trois premiers dieux mâles, il y eut quatre couples de dieux et de déesses,
vivant d’ailleurs sans relations sexuelles, savoir :
Wou-hitsi-ni, no mikoto, et sa compagne, lequel régna p ar la vertu du bois (le troisième
Oho-to-tsi, no mikoto, e t sa compagne, lequel régna p a r la vertu du métal ;
Omo-tarou, no mikoto, et sa compagne, lequel régna par la vertu de la terre;
enfin Izanaghi, no mikoto, et sa compagne Izanami.'
Cette seconde dynastie présente autant de déesses que de dieux, attendu que la raison
terrestre, aussi bien que la raison céleste, ont l’une et l’autre également concouru à leur
formation.
Le premier des sept dieux célestes qui viennent d’ètre énumérés, Kouni-toko-tatsi,
110 mikoto, est l’initiateur de la création de notre univers.
Les sept dieux dans leur ensemble personnifient.les éléments de cette création.
Les trois premières générations sont purement spirituelles.
1 Une matière pareille au bouto
2 M. Léon de Rosny, Mémoire t
Paris, Maisonneuve et Gle, 1857.
i de l’érianthe. (Version de M. Fraissinet.)
ir la Chronologie japonaise, précédé d’un aperçu des t