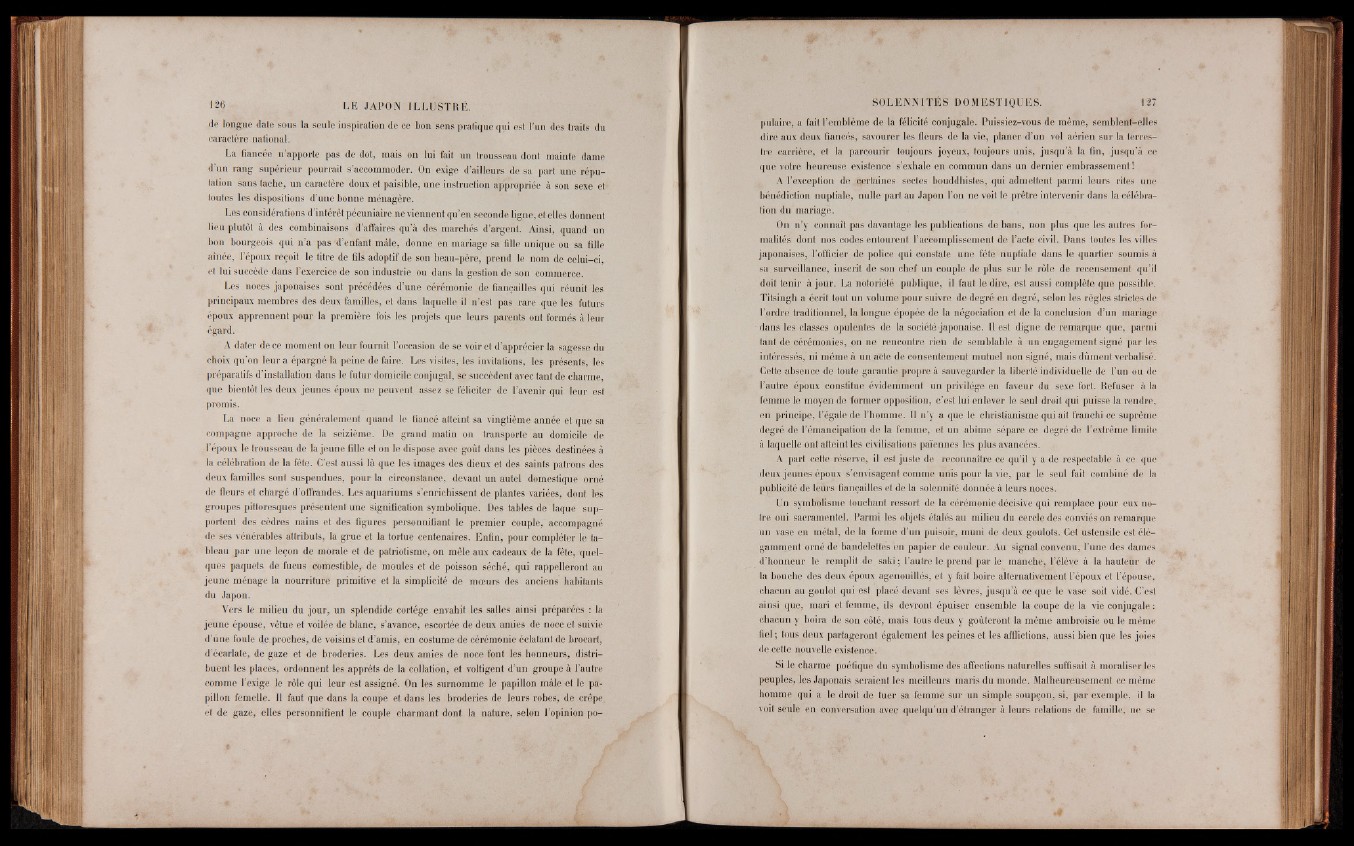
de longue date sous la seule inspiration de ce bon sens pratique qui est l’un des traits du
caractère national.
La fiancée n ’apporte pas de dot, mais on lui fait un trousseau dont mainte dame
d’un rang- supérieur pourrait s’accommoder. On exige d’ailleurs de sa part une réputation
sans tache, un caractère doux et paisible, une instruction appropriée à son sexe et
toutes les dispositions d’une bonne ménagère.
Les considérations d’intérêt pécuniaire ne viennent qu’en seconde ligne, et elles donnent
lieu plutôt à des combinaisons d’affaires qu’à des marchés d’argent. Ainsi, quand un
bon bourgeois qui n ’a pas d’enfant mâle, donne en mariage sa fille unique ou sa fille
aînée, l’époux reçoit le titre de fils adoptif de son beau-père, prend le nom de celui-ci,
et lui succède dans l’exercice de son industrie ou dans la gestion de son commerce.
Les noces japonaises sont précédées d’une cérémonie de fiançailles qui réunit les
principaux membres des deux familles, et dans laquelle il n’est pas rare que les futurs
époux apprennent pour la première fois les projets que leurs parents ont formés à leur
égard.
A dater de ce moment on leur fournit l’occasion de se voir et d’apprécier la sagesse du
choix qu’on leur a épargné la peine de faire. Les visites, les invitations, les présents, les
préparatifs d’installation dans le futur domicile conjugal, se succèdent avec tant de charme,
que bientôt les deux jeunes époux ne peuvent assez se féliciter de l’avenir qui leur est
promis.
La noce a lieu généralement quand le fiancé atteint sa vingtième année et que sa
compagne approche de la seizième. De grand matin on transporte au domicile de
l’époux le trousseau de la jeune fille et on le dispose avec goût dans les pièces destinées à
la célébration de la fête. C’est aussi là que les images des dieux et des saints patrons des
deux familles sont suspendues, pour la circonstance, devant un autel domestique orné
de fleurs et chargé d’offrandes. Les aquariums s’enrichissent de plantes variées, dont les
groupes pittoresques présentent une signification symbolique. Des tables de laque supportent
des cèdres nains et des figures personnifiant le premier couple, accompagné
de ses vénérables attributs, la grue et la tortue centenaires. Enfin, pour compléter le tableau
par une leçon de morale et de patriotisme, on mêle aux cadeaux de la fête, quelques
paquets de fucus comestible^ de moules et de poisson séché, qui rappelleront au
jeune ménage la nourriture primitive et la simplicité de moeurs des anciens habitants
du Japon.
Vers le milieu du jour, un splendide cortège envahit les salles ainsi préparées : la
jeune épouse, vêtue et voilée de blanc, s’avance, escortée de deux amies de noce et suivie
d’une foule de proches, de voisins et d’amis, en costume de cérémonie éclatant de brocart,
d’écarlate, de gaze et de broderies. Les deux amies de noce font les honneurs, distribuent
les places, ordonnent les apprêts de la collation, et voltigent d’un groupe à l’autre
comme l’exige le rôle qui leur est assigné. On les surnomme le papillon mâle et le papillon
femelle. Il faut que dans la coupe et dans les broderies de Jeurs robes, de crêpe
et de gaze, elles personnifient le couple charmant dont la nature, selon l’opinion populaire,
a fait l’emblème de la félicité conjugale. Puissiez-vous de même, semblent-elles
dire aux deux fiancés, savourer les fleurs de la vie, planer d’un vol aérien sur la terrestre
carrière, et la parcourir toujours joyeux, toujours unis, jusqu’à la fin, jusqu’à ce
que votre heureuse existence s’exhale en commun dans un dernier embrassement!
A l’exception de certaines sectes bouddhistes, qui admettent parmi leurs rites une
bénédiction nuptiale, nulle part au Japon l’on ne voit le prêtre intervenir dans la célébration
du mariage.
On n ’y connaît pas davantage les publications de bans, non plus que les autres formalités
dont nos codes entourent l’accomplissement de l’acte civil. Dans toutes les villes
japonaises, l’officier de police qui constate une fête nuptiale dans le quartier soumis à
sa surveillance, inscrit de son chef un couple de plus sur le rôle de recensement qu’il
doit tenir à jour. La notoriété publique, il faut le dire, est aussi complète que possible.
Titsingh a écrit tout un volume pour suivre de degré en degré, selon les règles strictes de
l’ordre traditionnel, la longue épopée de la négociation et de la conclusion d’un mariage
dans les classes opulentes de la société japonaise. 11 est digne de remarque que, parmi
tant de cérémonies, on ne rencontre rien de semblable à un engagement signé par les
intéressés, ni même à un acte de consentement mutuel non signé, mais dûment verbalisé.
Cette absence de toute garantie propre à sauvegarder la liberté individuelle de l’un ou de
l’autre époux constitue évidemment un privilège en faveur du sexe fort. Refuser à la
femme le moyen de former opposition, c’est lui enlever le seul droit qui puisse la rendre,
en principe, l’égale de l’homme. Il n ’y a que le christianisme qui ait franchi ce suprême
degré de l’émancipation de la femme, et un abîme sépare ce degré de l’extrême limite
à laquelle ont atteint les civilisations païennes les plus avancées.
A part cette réserve, il est juste de reconnaître ce qu’il y a de respectable à ce que
deux jeunes époux s’envisagent comme unis pour la vie, par le seul fait combiné de la
publicité de leurs fiançailles et de la solennité donnée à leurs noces.
Un symbolisme touchant ressort de la cérémonie décisive qui remplace pour eux notre
oui sacramentel. Parmi les objets étalés au milieu du cercle des conviés on remarque
un vase en métal, de la forme d’un puisoir, muni de deux goulots. Cet ustensile est élégamment
orné de bandelettes en papier de couleur. Au signal convenu, l’une des dames
d’honneur le remplit de saki; l’autre le prend par le manche, l’élève à la hauteur de
la bouche des deux époux agenouillés, et y fait boire alternativement l’époux et l’épouse,
chacun au goulot qui est placé devant ses lèvres, jusqu’à ce que le vase soit vidé. C’est
ainsi que, mari et femme, ils devront épuiser ensemble la coupe de la vie conjugale :
chacun y boira de son côté, mais tous deux y goûteront la même ambroisie ou le même
fiel ; tous deux partageront également les peines et les afflictions, aussi bien que les joies
de cette nouvelle existence.
Si le charme poétique du symbolisme des affections naturelles suffisait à moraliser les
peuples, les Japonais seraient les meilleurs maris du monde. Malheureusement ce même
homme qui a le droit de tuer sa femme sur un simple soupçon, si, par exemple, il la
voit seule en conversation avec quelqu’un d’étranger à leurs relations de famille, ne se