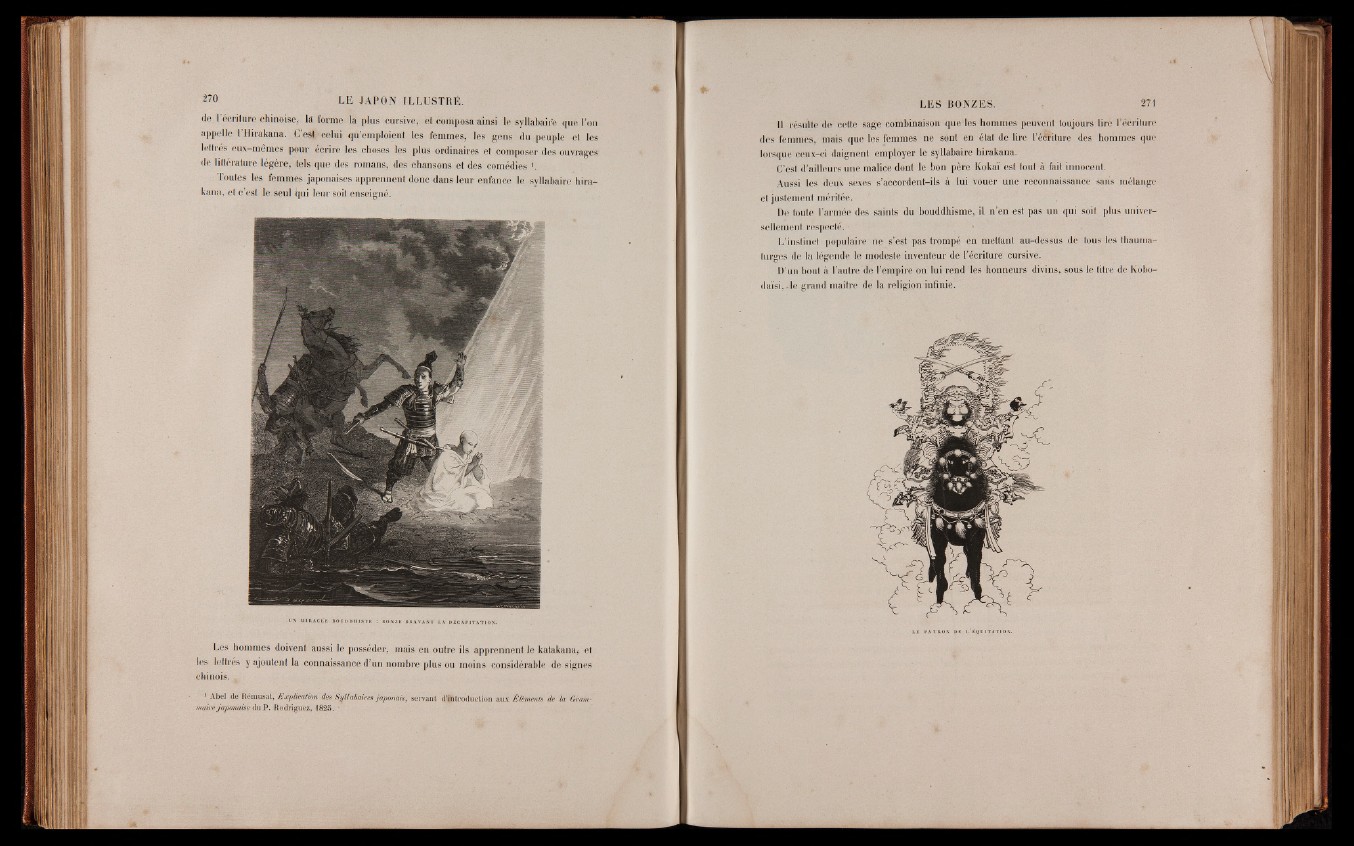
de 1 écrilure chinoise, la forme la plus cursive, et composa ainsi le syllabair’e que l’on
appelle THirakana. C’e s t’celui qu’emploient les femmes, les gens du peuple et les
lettrés eux-mêmes pour écrire les choses les plus ordinaires el composer des ouvrages
de littérature légère, tels que des romans, des chansons et des comédies l.
Toutes les femmes japonaises apprennent donc dans leur enfance le syllabaire hira-
kana, et c’est le seul qui leur soit enseigné.
Les hommes doivent aussi le posséder, mais en outre ils apprennent le katakana* et
les lettrés y ajoutent la connaissance d’un nombre plus ou moins considérable de signes
chinois, gi
1 Abel de Rémusat, Explication des Syllabaires japonais, servant d’introduction aux Éléments de la Grammaire
japonaise du P. Rodriguez, 1825. ■
11 résulte de cette sage combinaison que lés hommes peuvent toujours lire Técrilure
des femmes, mais que les femmes ne sont en état de lire l’éCTiture des hommes que
lorsque ceux-ci daignent employer le syllabaire hirakana.
C’est d’ailleurs une malice dont le bon père Kokaï est tout à fait innocent.
Aussi les deux sexes s’accordent-ils à lui vouer une reconnaissance sans mélange
et justement méritée. ' '
De foute l’armée des saints du bouddhisme, il n ’en est pas un qui soit plus universellement
respecté.
L’instinct populaire ne s’est pas trompé en mettant au-dpssus de tous les thaumaturges
de la légende le modeste inventeur de l’écriture cursive.
D’un bout à l’autre de l’empire on lui rend les honneurs divins, sous le titre de Kobo-
daïsi, le grand maître de la religion infinie.