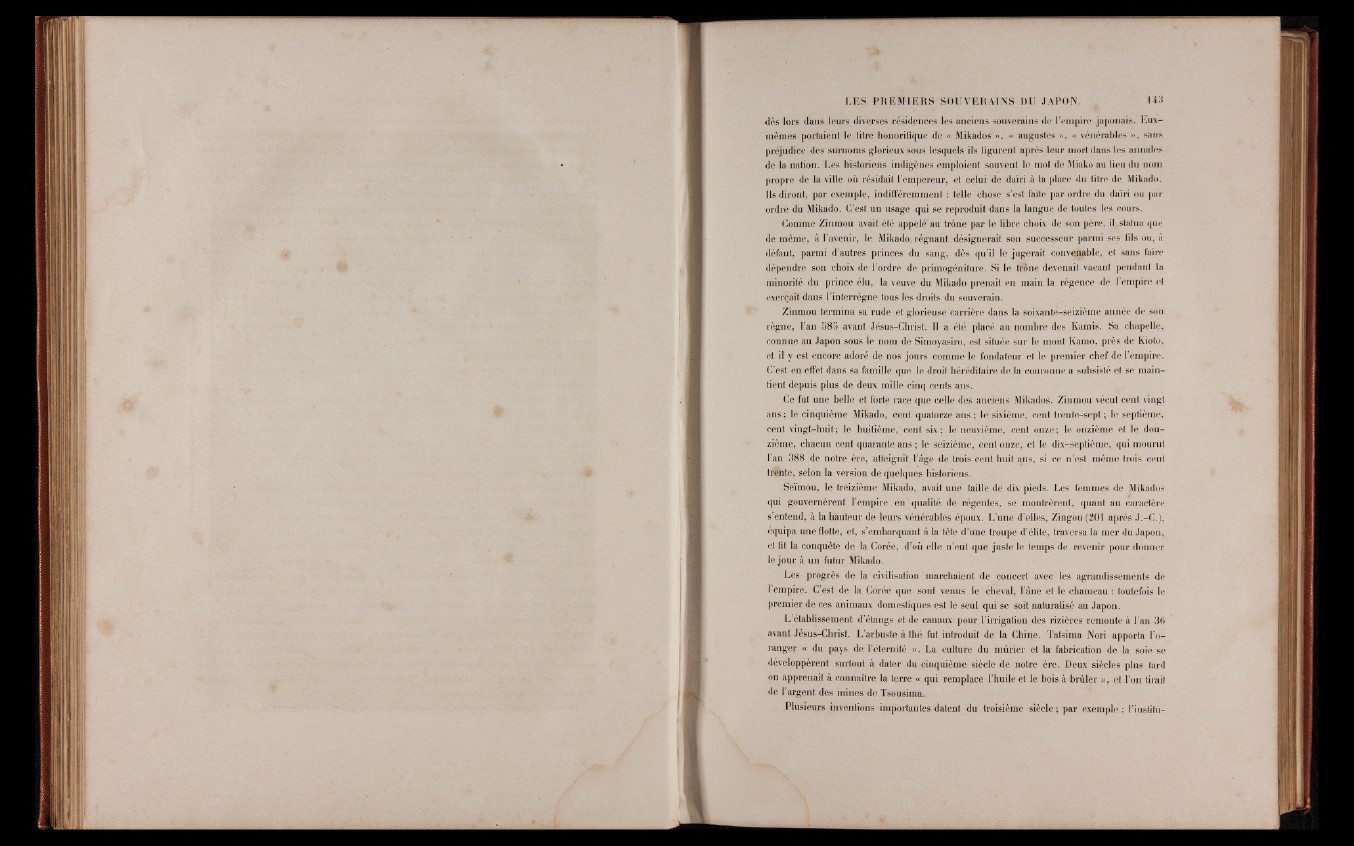
LES PR EM IER S SOUVERAINS DU JAPON. a 143
dès lors dans leurs diverses résidences les anciens souverains de l’empire japonais. Eux-
mêmes portaient le titre honorifique de « Mikados », « augustes », « vénérables », sans
préjudice des surnoms glorieux sous lesquels ils figurent après leur mort dans les annales
de la nation. Les historiens indigènes emploient souvent le mot de Miako au lieu du nom
propre de la ville où résidait l’empereur, et celui de daïri à la place du titre de Mikado.
Ils diront, par exemple, indifféremment : telle chose s’est faite par ordre du daïri ou par
ordre du Mikado. C’est un usage qui se reproduit dans la langue de toutes les cours.
Comme Zinmou avait été appelé au trône par le libre choix de son père, il statua que
de même, à l’avenir, le Mikado régnant désignerait son successeur parmi ses fils ou, à
défaut, parmi d’autres princes du sang, dès qu’il le jugerait convenable, et sans faire
dépendre son choix de l’ordre de primogéniture. Si le trône devenait vacant pendant la
minorité du prince élu, la veuve du Mikado prenait en main la régence de l’empire et
exerçait dans l’interrègne tous les droits du souverain.
Zinmou termina sa rude et glorieuse carrière dans la soixante-seizième année de son
règne, l’an 585 avant Jésus-Ghrist. Il a été placé au nombre des Kamis. Sa chapelle,
connue au Japon sous le nom de Simoyasiro, est située sur le mont Kamo, près de Kioto,
et il y est encore adoré de nos jours comme le fondateur et le premier chef de l’empire.
C’est en effet dans sa famille que le droit héréditaire de la couronne a subsisté et se maintient
depuis plus de deux mille cinq cents ans.
Ce fut une belle et forte race que celle des anciens Mikados. Zinmou vécut cent vingt
ans ; le cinquième Mikado, cent quatorze ans ; le sixième, cent trente-sept ; le septième,
cent vingt-huit; le huitième, cent six; le neuvième, cent onze; le onzième et le douzième,
chacun cent quarante ans ; le seizième, cent onze, et le dix-septième, qui mourut
l’an 388 de notre ère, atteignit l’âge de trois cent huit ans, si ce n’est même trois cent
trente, selon la version de quelques historiens.
Seïmou, le treizième Mikado, avait une taille de dix pieds. Les femmes de Mikados
qui gouvernèrent l’empire en qualité de régentes, se montrèrent, quant au caractère
s’entend, à la hauteur de leurs vénérables époux. L’une d’elles, Zingou (201 après J.-C.),
équipa une flotte, et, s’embarquant à la tête d’une troupe d’élite, traversa la mer du Japon,
et fit la conquête de la Corée, d’où elle n ’eut que juste le temps de revenir pour donner
le jour à un futur Mikado.
Les progrès de la civilisation marchaient de concert avec les agrandissements de
l’empire. C’est de la Corée que sont venus le cheval, l’âne et le chameau : toutefois le
premier de ces animaux domestiques est le seul qui se soit naturalisé au Japon.
L’établissement d’étangs et de canaux pour l’irrigation des rizières remonte à l’an 36
avant Jésus-Christ. L’arbuste à thé fut introduit de la Chine. Tatsima Nori apporta l’oranger
« du pays de l’éternité ». La culture du mûrier et la fabrication de la soie se
développèrent surtout à dater du cinquième siècle de notre ère. Deux siècles plus tard
on apprenait à connaître la terre « qui remplace l’huile et lé bois à brûler », et l’on tirait
de l’argent des mines de Tsousima.
Plusieurs inventions importantes datent du troisième siècle ; par exemple : l’institu—