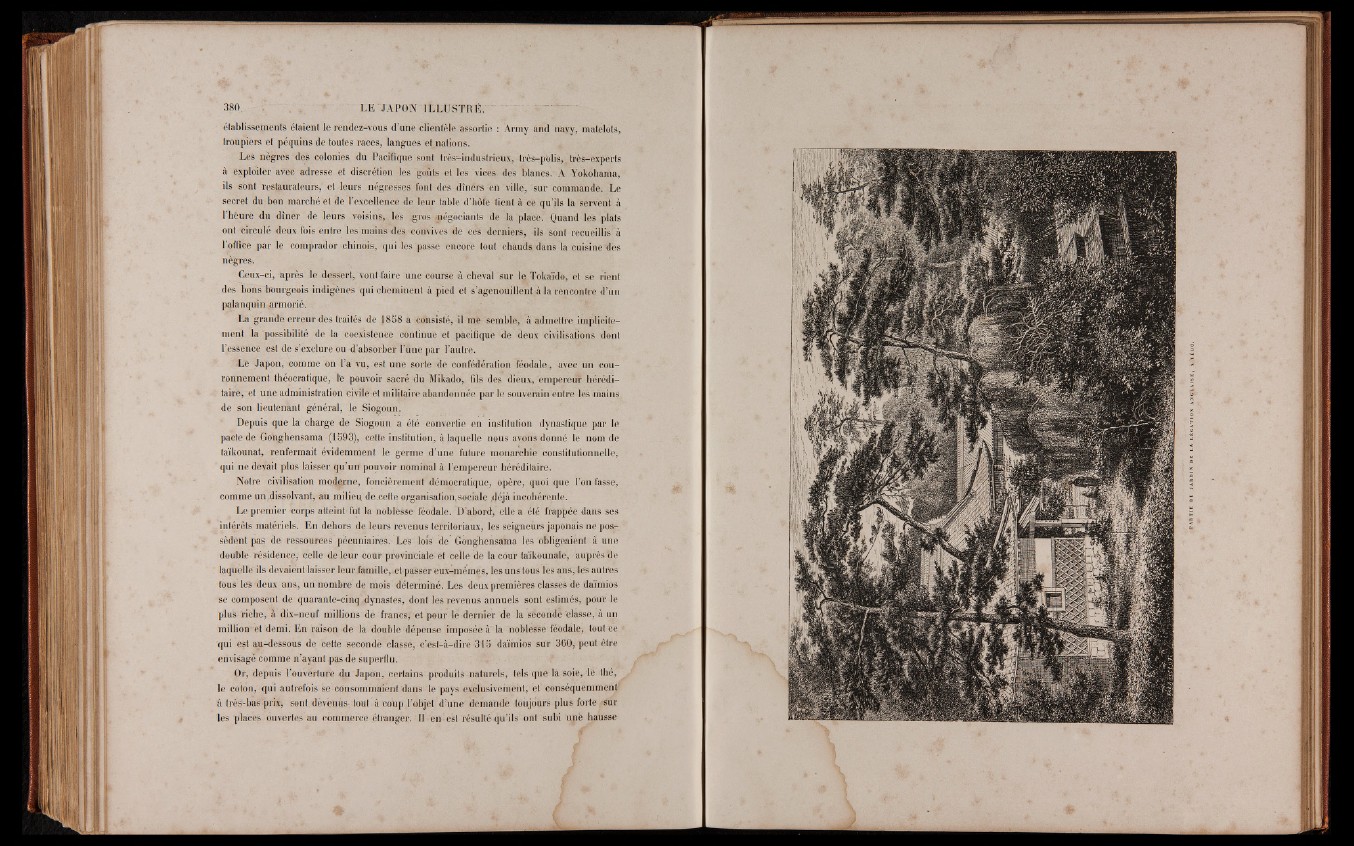
établissements étaient le rendez-vous d’une clientèle assortie : Àrmy and nayy, matelots,
troupiers et péquins de toutes races, langues et nations.
Les nègres des colonies du Pacifique sont très-industrieux, très—polis, très-experts
à exploiter avec adresse, et discrétion les goûts et les vices dés blancs'. A Yokohama,
ils sont restaurateurs, et leurs négresses font dés-dinérs en ville, sur commande. Le
secret du bon marché et de l’excellence de leur table d’hôte tient à ce qu’ils la servent à
l’hèuré du dîner de leurs voisins* les .gros négociants de la place. Quand les plats
ont circulé deux fois entre les mains des convives de eès derniers* ils sont recueillis à
l'office par le comprador chinois, qui les passe encore tout chauds dans la cuisine des
nègres.
Ceux-ci, après le dessert, vont faire une course à cheval sur le Tokaïdo, et se rient
des bons bourgeois indigènes qui cheminent à pied et s’agenouillent à la rencontre d’un
palanquin armorié.
La grande erreur des traités de 1858 a consisté, il me semble, à admettre implicitement
la possibilité de la coexistence continue et pacifique de deux civilisations dont
l’essence est de s’exclure ou d’absorber l'une par l’autre.
•Le Japon, comme on l’a vu, est une sorte de confédération féodale* avec un couronnement
théocratique, te pouvoir sacré du Mikado, fils des dieux, empereur héréditaire,
et une administration civile et militaire abandonnée par le souverain entre lès mains
de son lieutenant général, le Siogoun.
Depuis que la charge de Siogoün a été convertie en institution dynastique par le
pacte de Gonghensama (1593), cette institution, à laquelle nous avons donné le nom de
taïkounat, renfermait évidemment le germe d’une future monarchie constitutionnelle,
qui ne devait plus laisser qu’un pouvoir nominal à ((empereur héréditaire.
Notre civilisation moderne, foncièrement démocratique, opère, quoi que l’on fasse,
comme un dissolvant, au milieu de.cette organisation,sociale 4éjà incohérente.
Le premier corps atteint fut la noblesse féodale. D'abord, elle a été frappée dans ses
intérêts matériels. En dehors de leurs revenus territoriaux, les seigneurs japonais né possèdent
pas 4e ressources pécuniaires. Les lois de Gonghensdma les obligeaient à une
double résidence, celle de leur cour provinciale ët celle de la cour taïkOunale* auprès de
laquelle ils devaient laisser leur famille, et passer eux-mêmes, les uns tous les ans, les autres
tous les deux ans, un nombre de mois déterminé. Les deux premières classes de daïmios
se composent de quarante-cinq dynastes, dont les revenus annuels sont estimés, pour 1e
plus riche, à dix-neuf millions de francs,'et pour le dernier de la seconde classé, à un
million et demi. En raison de la double dépense imposée à la noblesse féodale* tout ce '
qui est au-dessous de Cette seconde classé, c’êst-à-dire 315 daïmios sur 360* peut être
envisagé comme n ’ayant pas de superflu.
Or, depuis l’ouverture du Japon, certains produits naturels, tels que la soie, lé thé,
lè coton, qui autrefois se consommaient dans le pays exclusivement, et conséquemment"
à très-bas prix* sont devenus tout à coup l’objet d’une' demande toujours plus forte rsur
les places ouvertes au commerce étranger. Il e n :est résulté qu’ils ont subi une hausse