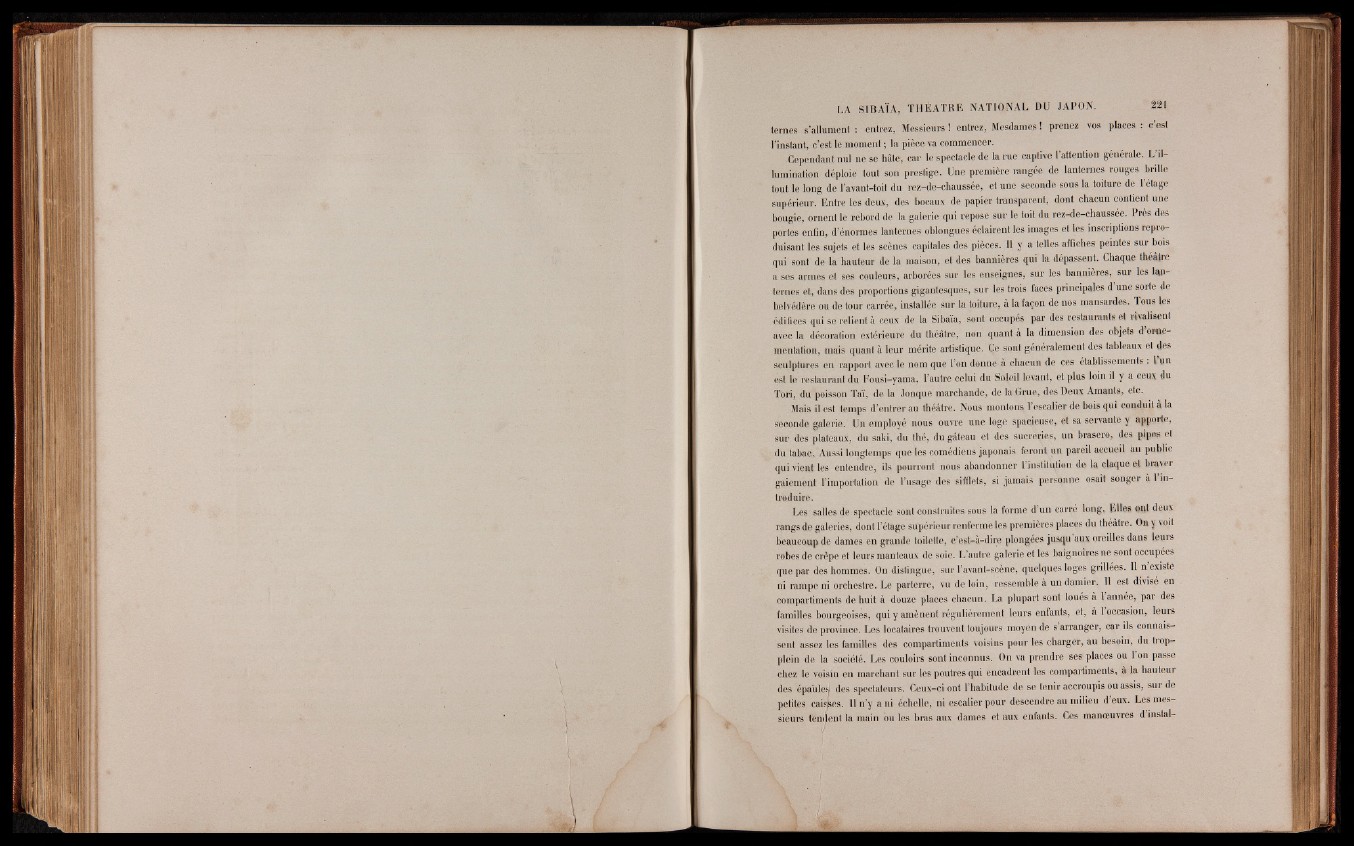
1 1
a l l f i
i l i t
ternes s’allument : entrez, Messieurs ! entrez, Mesdames ! prenez vos places : c’est
l’instant, c’est le moment ; la pièce va commencer.
Cependant nul ne se hâte, car le spectacle de la rue captive l’attention générale. L’illumination
déploie tout son prestige. Une première rangée de lanternes rouges brille
tout le long de l’avant-toit du rez-de-chaussée, et une seconde sous la toiture de l’étage
supérieur. Entre les deux, des bocaux de papier transparent, dont chacun contient une
bougie, ornent le rebord de la galerie qui repose sur le toit du rez-de-chaussée. Près des
portes enfin, d’énormes lanternes oblongues éclairent les images et les inscriptions reproduisant
les sujets et les scènes capitales des pièces. Il y a telles affiches peintes sur bois
qui sont de la hauteur de la maison, et des bannières qui la dépassent. Chaque théâtre
a ses armes et ses couleurs, arborées sur les enseignes, sur les bannières, sur les lanternes
et, dans des proportions gigantesques, sur les trois faces principales d une sorte de
belvédère ou de tour carrée, installée sur la toiture, à la façon de nos mansardes. Tous les
édifices qui se relient à ceux de la Sibaïa, sont occupés par des restaurants et rivalisent
avec la décoration extérieure du théâtre, non quant à la dimension des objets d ornementation,
mais quant à leur mérite artistique. Ce sont généralement des tableaux et des
sculptures en rapport avec le nom que Ton donne à chacun de ces établissements : 1 un
est le restaurant du Fousi-yama, l’autre celui du Soleil levant, et plus loin il y a ceux du
Tori, du poisson Taï, de la Jonque marchande, de la Grue, des Deux Amants, etc.
Mais il est temps d’entrer au théâtre. Nous montons l’escalier de bois qui conduit à la
seconde galerie. Un employé nous ouvre une loge spacieuse, et sa servante y apporte,
sur des plateaux, du saki, du thé, du gâteau et des sucreries, un brasero, des pipes et
du tabac, Aiissi longtemps que les comédiens japonais feront un pareil accueil au public
qui vient les entendre, ils pourront nous abandonner l’institution de la claque et braver
gaiement l’importation de l’usage des sifflets, si jamais personne osait songer à l’in-
troduire.
Les salles de spectacle sont construites sous la forme d’un carré long, Elles f»nt deux
rangs de galeries, dont l’étage supérieur renferme les premières places du théâtre. On y voit
beaucoup de dames en grande toilette, c’est-à-dire plongées jusqu aux oreilles dans leurs
robes de crêpe et leurs manteaux de soie. L’autre galerie et les baignoires ne sont occupées
que par des hommes. On distingue, sur l’avant-scène, quelques loges grillées. Il n existe
ni rampe ni orchestre. Le parterre, vu de loin, ressemble à un damier. Il est divisé en
compartiments de huit à douze places chacun. La plupart sont loués à 1 année, par des
familles bourgeoises, qui y amènent régulièrement leurs enfants, et, à 1 occasion, leurs
visites de province. Les locataires trouvent toujours moyen de s’arranger, car ils connaissent
assez les familles des compartiments voisins pour les charger, au besoin, du trop-
plein de la société. Les couloirs sont inconnus. On va prendre ses places ou l’on passe
chez le voisin en marchant sur les poutres qui encadrent les compartiments, à la hauteur
des épauled des spectateurs. Ceux-ci ont l’habitude de se tenir accroupis ou assis, sur de
petites caisses. 11 n ’y a ni échelle, ni escalier pour descendre au milieu d eux. Les messieurs
temlent la main ou les bras aux dames et aux enfants. Ces manoeuvres d instab*